
Au cœur de controverses contemporaines, face à la permanence et aux transformations de l’antisémitisme et aux utilisations frauduleuses de l’accusation d’antisémitisme afin de faire taire la solidarité avec le peuple palestinien, l’ouvrage de Mark Mazower Antisémitisme : Métamorphoses et controverses (éd. La Découverte), vient à point nommé offrir une ample réflexion sur le sujet. Nathan Patron-Altan revient ici plus particulièrement sur la seconde partie de l’ouvrage et les luttes définitionnelles de l’antisémitisme menées par certaines institutions.
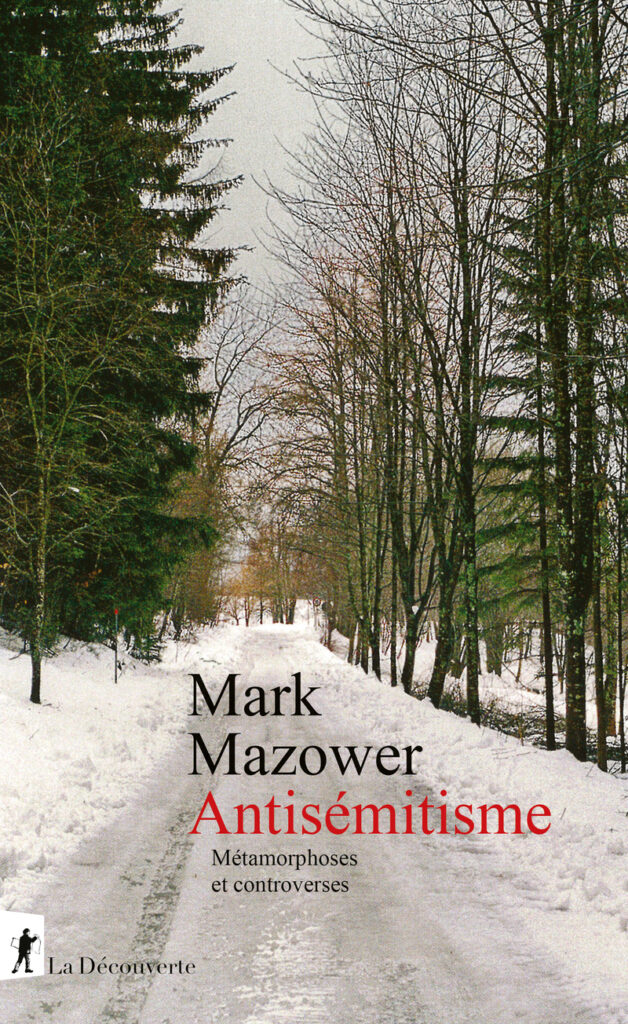
Par Nathan Patron-Altan
Faire l’histoire de l’antisémitisme contre son approche victimaire par les historiens et les gouvernements israéliens
Dans Antisémitisme : Métamorphoses et controverses[1], Mark Mazower a pour objectif de remettre en cause, à la fois d’un point de vue historique et politique, l’axiome de la sinat Yisrael (la « haine éternelle d’Israël »), qui postule que l’antisémitisme serait immuable et incurable. Ce qui relevait autrefois d’une expression théologique a progressivement été transformé en un principe fondateur, repris aussi bien par une certaine historiographie israélienne que par la politique de l’État d’Israël.
Dans la première partie du livre, Mazower cherche donc à recontextualiser l’antisémitisme de l’affaire Dreyfus à l’après-Shoah, en montrant que ses formes, ses manifestations et son intensité varient selon les périodes. Il insiste sur l’importance des contextes géographiques, démographiques et sociologiques pour comprendre ces évolutions. Par ailleurs, il souligne que le judaïsme, longtemps centré en Europe jusqu’au judéocide, s’est déplacé vers deux nouveaux pôles principaux, Israël et les États-Unis, qui regroupent aujourd’hui la majorité des communautés juives mondiales.
Mazower souligne que, dans ces nouvelles aires géographiques, la condition des Juifs change profondément par rapport à leur situation européenne traditionnelle. Aux États-Unis, ils s’intègrent dans un système marqué par un binarisme racial où ils ne sont plus perçus comme une minorité stigmatisée, mais trouvent une place relativement favorable au sein de la majorité blanche. En Palestine/Israël, le mouvement est encore plus radical. Les Juifs, longtemps minoritaires en Europe, deviennent une majorité démographique et politique.
Ces bouleversements, auxquels s’ajoute la baisse significative de l’antisémitisme traditionnel relevée par de nombreux sociologues, transforment en profondeur la notion même d’antisémitisme. Celui-ci acquiert désormais de nouvelles réalités et définitions, souvent discordantes. Autrement dit, les cadres conceptuels élaborés pour penser l’antisémitisme ne correspondent plus véritablement à sa manifestation concrète dans les sociétés contemporaines. C’est précisément cette discordance entre réalités et définitions de l’antisémitisme qui constitue le cœur de la seconde partie de l’ouvrage de Mazower, et qui fait l’objet de la présente recension.
Dans le prélude, de cette seconde partie, Mazower revient sur le contexte états-uniens. Il rappelle qu’aux États-Unis, l’expérience juive évolue de manière paradoxale par rapport à l’antisémitisme et au sionisme. Dans la première moitié du XXᵉ siècle, alors que l’antisémitisme est encore fort, notamment avec l’essor du Ku Klux Klan, les discriminations dans l’éducation, le logement et les loisirs, et des affaires comme Leo Frank ou l’affaire Rosenberg, les Juifs états-uniens restent majoritairement peu sionistes. Les organisations comme l’American Jewish Committee (AJC), représentant les élites assimilées, privilégient l’intégration et la loyauté envers les États-Unis, et craignent que le sionisme n’entraîne des accusations de double allégeance.
Même après la création d’Israël en 1948, l’adhésion initiale est limitée et marquée par des tensions, illustrées par le bras de fer entre Ben Gourion et l’AJC lors de la loi de 1952 sur les statuts de l’Organisation sioniste mondiale et de l’Agence juive. Son leader, Jacob Blaustein, plaide pour l’ajout d’une clause stipulant que l’État d’Israël ne doit pas être défini comme « la création de tout le peuple juif », ainsi que le prévoyait la loi, mais seulement comme un État, « qui ne représente que ses propres habitants ».
Cependant, à partir des années 1950-1970, alors que l’antisémitisme décline rapidement et que les Juifs accèdent à des positions sociales et économiques jusque-là interdites, le sionisme connaît un soutien spectaculaire, après la guerre des Six Jours en 1967. Cette nouvelle posture se traduit par une mobilisation philanthropique et politique massive, et l’AJC abandonne son non-sionisme historique. Ainsi, paradoxalement, c’est au moment où l’antisémitisme décline et que la sécurité sociale et culturelle des Juifs états-uniens est plus assurée que le sionisme devient le plus fort, alors qu’il était limité lorsque l’antisémitisme était menaçant.
De la théorie du « nouvel antisémitisme » à son institutionnalisation et son internationalisation
Pour résoudre ce paradoxe, les historiens Henry Feingold et Edward Shapiro soulignaient que ces craintes étaient en partie alimentées par les organisations juives (l’ADL, l’AJC, etc.) elles-mêmes, dont la raison d’être dépendait de la perception d’une menace persistante. C’est dans ce contexte que les deux anciens dirigeants de l’ADL, Arnold Forster et Benjamin Epstein, publient en 1974 The New Anti-Semitism, proposant une redéfinition de l’antisémitisme, d’après laquelle celui-ci ne résiderait plus seulement dans la haine traditionnelle des Juifs, mais dans l’hostilité envers l’Etat d’Israël. La gauche radicale, les campus et les minorités racisées[2] étaient identifiés comme de nouveaux vecteurs d’antisémitisme. Cette démarche posait les bases d’une orthodoxie nouvelle selon laquelle toute opposition à Israël pouvait être interprétée comme une forme d’hostilité envers les Juifs.
La redéfinition de l’antisémitisme comme hostilité envers Israël est d’abord initiée par l’État israélien lui-même, afin de justifier « publiquement » ses politiques coloniales, présentées comme défensives et vitales, contre le supposé antisémitisme génocidaire des Palestiniens. Mazower insiste sur le terme « publiquement », car il montre que, en privé, les dirigeants sionistes reconnaissaient que l’opposition politique des Palestiniens à Israël n’avait rien d’antisémite. À titre d’exemple, on peut citer la différence de discours de Ben Gourion lorsque publiquement, à la veille de la crise de Suez en 1956, il qualifiait Nasser et les Arabes de nouveau Hitler et de nazis, tandis que, la même année, Nahum Goldmann rapporte que Ben Gourion lui confiait :
« Nous sommes originaires d’Israël, c’est vrai, mais cela remonte à deux mille ans : en quoi cela les concerne-t-il ? Il y a eu l’antisémitisme, les nazis, Hitler, Auschwitz, mais est-ce leur faute ? Ils voient une seule chose : nous sommes venus et avons volé leur pays. Pourquoi accepteraient-ils cela ?[3] ».
Mazower ajoute que, même quand elle prend la forme d’une rhétorique éliminationniste, l’hostilité arabe demeure avant tout une lutte pour la terre. Il est ainsi pervers d’associer la résistance palestinienne à la colonisation à de l’antisémitisme alors que cette dernière s’entreprend au nom du judaïsme. Cette confusion est d’ailleurs entretenue par l’État d’Israël lui-même qui instaure des dispositifs tels qu’une Commission ou un Institut du peuple juif ou encore adopte une loi fondamentale le définissant comme « l’État-nation du peuple juif » en 2018.
Par ailleurs, c’est Natan Sharansky, ministre israélien des Affaires de la diaspora puis président de l’Agence juive, qui joue un rôle central dans la diffusion de la définition du « nouvel antisémitisme », tout en popularisant le concept de « peoplehood » (l’unité du peuple juif). Il crée à cette fin un Forum contre l’antisémitisme, qui affirme que l’État d’Israël allait mener une contre-offensive coordonnée contre la gauche communiste et pro-palestinienne. La lutte contre le « nouvel antisémitisme » s’internationalise et s’institutionnalise, sous l’impulsion des initiatives du gouvernement israélien en concert avec les organisations juives nationales.
Cette stratégie s’internationalise notamment grâce au soutien de responsables états-uniens, qui intègrent la lutte contre l’antisémitisme dans leurs politiques de promotion de la démocratie. En 2004, le secrétaire d’État états-unien Colin Powell annonce, lors d’une conférence contre l’antisémitisme à Berlin réunissant 55 pays, la mise en place par l’OSCE d’une structure administrative chargée de recenser les incidents antisémites et de conseiller les États membres sur les réformes législatives et éducatives nécessaires. Cette initiative crée une bureaucratie internationale consacrée à la surveillance et à la répression de l’antisémitisme, désormais considéré comme un enjeu de politique globale et de sécurité des Juifs et d’Israël.
Aux États-Unis, le Congrès adopte la même année le Global Anti-Semitism Review Act, instaurant le Bureau du délégué spécial chargé de surveiller et combattre l’antisémitisme. Cette loi étend la définition de l’antisémitisme aux « propos diffamatoires sur Israël », ce qui implique que les diplomates états-uniens doivent défendre exceptionnellement un autre État. Cette redéfinition transforme la lutte contre l’antisémitisme, qui n’est plus limitée aux préjugés raciaux ou religieux traditionnels, mais devient une protection diplomatique de l’État israélien et, indirectement, des positions états-uniennes qui le soutiennent.
À la fin des années 1990 et au début des années 2000, l’idée de promouvoir une définition standardisée de l’antisémitisme est devenue un objectif stratégique pour le gouvernement israélien et plusieurs organisations juives internationales. Cette initiative s’inscrivait dans un contexte de débat croissant sur la nature et la portée des actes antisémites, en particulier en Europe. Un événement déclencheur fut la suspension par l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC) d’un rapport censé montrer que de nombreux incidents antisémites impliquaient de jeunes musulmans.
Ce contretemps mit en lumière l’absence d’une définition commune et la difficulté de comparer les données statistiques entre pays, en raison de divergences sur la qualification des actes comme raciaux, religieux ou politiques, notamment lorsqu’ils étaient liés à Israël ou au conflit au Moyen-Orient. Face à cette incertitude, des experts états-uniens, comme Kenneth Stern de l’American Jewish Committee, furent sollicités pour élaborer des lignes directrices claires. Le résultat fut une définition brève, accompagnée d’exemples, destinée initialement à un usage administratif interne plutôt qu’à une diffusion publique.
Deux logiques expliquent l’émergence de cette démarche. D’une part, des raisons techniques et bureaucratiques. Avec l’essor du traitement statistique et informatisé des crimes de haine, il devenait nécessaire de disposer de catégories fixes et comparables. D’autre part, une raison idéologique selon laquelle les groupes dominants cherchent à fixer le sens des termes afin de légitimer certaines interprétations et d’en exclure d’autres.
Dans ce contexte, la définition standardisée de l’antisémitisme servait non seulement à mesurer des incidents, mais aussi à définir des opinions politiques comme inacceptables, en particulier celles critiquant Israël. La lutte contre l’antisémitisme s’éloignait ainsi du cadre général de la lutte contre le racisme et s’articulait de plus en plus autour de la défense d’Israël, de la délégitimation de la gauche critique et de la surveillance des musulmans, suspectés d’être les « nouveaux antisémites ».
La première tentative de l’EUMC fut finalement nuancée et abandonnée, car la définition de Stern posait un problème dès qu’elle abordait des questions liées à Israël. Les institutions européennes restèrent méfiantes et l’EUMC elle-même ne l’adopta jamais officiellement. Mais les promoteurs de cette définition, comprenant que le soutien d’Israël ou d’une organisation juive seule ne suffirait pas à lui donner une légitimité internationale, cherchèrent alors des institutions intergouvernementales capables de valider leur initiative.
Certains représentants d’organisations juives états-uniennes disposaient d’un statut d’observateurs ou de postes officiels au sein d’organismes comme l’OSCE ou l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA). Fondée en 1998 pour l’éducation sur la Shoah, l’IHRA n’avait jamais eu besoin d’une définition formelle de l’antisémitisme, mais le lobbying en faveur de la définition de Stern aboutit en 2016 à son adoption par les membres de l’IHRA, donnant ainsi naissance à la définition dite « de l’IHRA », désormais en vigueur. Le problème est que cette définition associe les critiques les plus radicales d’Israël à de l’antisémitisme.
Instrumentalisation de la lutte contre l’antisémitisme et application de la nouvelle définition de l’antisémitisme
La définition de l’IHRA a d’abord été mise à l’épreuve sur les campus états-uniens, qui furent de véritables laboratoires permettant d’en mesurer la portée répressive. En 2006, Yale lança la première initiative universitaire états-unienne consacrée à l’antisémitisme. Officiellement présenté comme un centre de recherche, l’Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy (ISGAP) affiche en réalité un objectif militant : « lutter contre l’antisémitisme sur le champ de bataille des idées ». En réalité, ce centre est financé par le gouvernement israélien et compte dans ses instances des personnalités proches de l’appareil sécuritaire et diplomatique israélien, comme Natan Sharansky et Sima Vaknin-Gil, ancienne responsable du ministère des Affaires stratégiques. Ainsi, l’organisation apparaît comme un acteur hybride, à mi-chemin entre recherche académique et instrument de politique d’influence.
La création d’organisations comme l’ISGAP s’inscrit dans une stratégie plus large de l’État d’Israël visant à défendre son image internationale. Dès 2017, Vaknin-Gil expliquait à la Knesset que la diplomatie israélienne avait échoué à redorer la réputation du pays, et qu’il fallait désormais endiguer les critiques en qualifiant notamment le mouvement BDS de menace existentielle et en cherchant à l’interdire sous prétexte d’antisémitisme. Cela revenait à investir massivement la sphère culturelle, universitaire et intellectuelle internationale afin de contrer l’influence des militants pro-palestiniens. Dans cette stratégie, les universités deviennent des « deuxièmes fronts » d’un conflit politique, selon l’expression de Sharansky, qui allait même jusqu’à comparer, après le 7 octobre, les étudiants pro-israéliens à une « infanterie ».
Mark Mazower décrit l’augmentation de pratiques d’intimidation qui ciblent des enseignants et des étudiants pro-palestiniens. Dès les années 1980, certaines organisations comme l’ADL avaient déjà tenté de dresser des listes noires assimilant l’antisionisme à de l’antisémitisme, mais ces méthodes choquaient encore à l’époque et furent officiellement désavouées. Aujourd’hui, elles se sont banalisées et et s’affirment désormais de manière pleinement assumée, comme le montrent les diffusions en ligne de listes, les campagnes sur les réseaux sociaux, les camions qui circulent autour des campus avec les noms d’enseignants, voire les collaborations directes entre militants et services de police ou de renseignement. L’ADL va même jusqu’à publier un « Campus Antisemitism Report Card », qui attribue des notes aux universités, mais selon une méthodologie jugée partiale et alarmiste par des étudiants eux-mêmes.
Cette stratégie ne concerne pas que les campus. Dans plusieurs pays, la définition de l’IHRA est devenue un instrument commode pour afficher une posture morale ou éviter la controverse. Au Royaume-Uni, elle a été utilisée en 2017-2018 contre la direction du Parti travailliste, accusé d’antisémitisme pour avoir exprimé des réserves sur cette définition et ses exemples. En Europe, des études israéliennes, publiées par +972 Magazine, montrent qu’entre 2017 et 2023, elle a été mobilisée presque exclusivement contre des personnalités critiques d’Israël.
L’Allemagne constitue le cas le plus emblématique. Marquée par son passé et sa volonté affichée de rupture avec l’histoire antisémite du pays, la classe politique a fait de la sécurité d’Israël une « raison d’État » et a adopté officiellement la définition de l’IHRA. Des commissaires spécialisés ont été nommés pour lutter contre l’antisémitisme. Mais, alors que les statistiques policières montrent que la majorité des violences antijuives proviennent de l’extrême droite, ces responsables préfèrent cibler les militants pro-palestiniens.
Le livre de Mazower constitue une étude particulièrement salutaire au débat public français sur les nouvelles définitions et réalités de l’antisémitisme, où les recherches sur la question demeurent rarement traduites ou diffusées hors du champ militant. En ce sens, il contribue à donner une visibilité inédite aux enjeux soulevés par les nouvelles définitions de l’antisémitisme et par leurs instrumentalisations, jusqu’ici surtout portés par des militants souvent disqualifiés comme « trop extrémistes » ou « pas assez universitaires ». On peut également regretter que l’ouvrage se concentre principalement sur le contexte états-unien, même si les parallèles avec la situation française apparaissent clairement aux lecteurs familiers de ces débats[4].
Notes
[1] Mark Mazower. Antisémitisme. Métamorphoses et controverses. Traduit de l’anglais par Marc Saint-Upéry. Paris, La Découverte, 2025
[2] Mazower consacre des pages particulièrement pertinentes au sujet de l’antisémitisme des personnes noires, qu’il convient plutôt de comprendre comme une méfiance générale des Noirs envers les Blancs, les Juifs étant proche de ce groupe socio-racial. Il analyse également un ressentiment spécifique envers les Juifs, qui se perçoivent autant, voire davantage, comme victimes que les Noirs, alors qu’ils ne subissent pas le même type de racisme dans le contexte états-unien : la souffrance juive étant socialement reconnue, contrairement à celle des Noirs. Le point le plus important de ces pages, et qui mérite véritablement réflexion, concerne la différence d’approche face au racisme entre communautés juives et noires. L’effritement de l’alliance historique entre les Juifs et les Noirs ne peut se réduire à de simples préjugés mutuels. Il explique surtout par la transformation sociale des Juifs états-uniens, passés d’une position de « démunis » à celle de « nantis », et par les divergences idéologiques qui en résultent. Les organisations juives privilégiaient une approche libérale centrée sur l’égalité formelle devant la loi, tandis que les organisations noires revendiquaient une justice sociale et économique plus radicale et matérialiste. La fracture dépasse donc les tensions intercommunautaires pour refléter les façons dont la société états-unienne de la fin du XXᵉ siècle affrontait l’héritage historique de discrimination raciale et l’inégale répartition du pouvoir et des ressources. (p.196-210)
[3] Antisémitisme. Métamorphoses et controverses, p.166
[4] On pourra lire en anglais sur le même sujet : Antony Lerman. Whatever happened to antisemitism ? Redefinition and the Myth of the « Collective Jew », Pluto Press, Londres, 2022,
°°°
Source: https://www.contretemps.eu/antisemitisme-livre-mark-mazower/
URL de cet article: https://lherminerouge.fr/antisemitisme-metamorphoses-et-controverses-un-livre-de-mark-mazower-editions-la-decouverte-contretemps-3-10-25/
