
Dans le Limousin, l’annonce récente de la naissance de quatre louveteaux exacerbe les craintes des éleveurs du plateau de Millevaches. Des solutions de coexistence sont proposées, mais le dialogue reste compliqué.
Par Lisa DOUARD et Valérie TEPPE (photographies).
Plateau de Millevaches (Limousin), reportage
« S’il y a un loup qui nous observe, il doit être par là-bas. Lâchés, les chiens courent dans cette direction », décrit Loïc Defossez, en pointant un bosquet du bout de son bâton. Le trentenaire est l’un des rares bergers du plateau de Millevaches. Il veille sur plus de 400 brebis d’un groupement pastoral en estive à 900 mètres d’altitude. Là-haut, sur ce territoire rural entre la Haute-Vienne, la Creuse et la Corrèze, la bête peut être partout et suscite toutes les suppositions.
Carmen Munoz Pastor et Vincent Primault suivent sa trace depuis 2021. Les deux naturalistes de l’association Carduelis, installée dans la région, compilent leurs recherches dans un carnet désormais bien épais. Dates des attaques, secteurs visités, découverte d’un premier individu abattu par des louvetiers en mai 2023 et, depuis l’été 2024, suivi d’un couple qui constitue sa meute. « Le Limousin est le dernier endroit où le loup a été éradiqué dans les années 1930. On ne pensait pas qu’il ferait son retour de notre vivant. C’est historique ce qui se passe », se réjouissent les deux spécialistes, qui le savent en sursis.
Des naissances rares
Début août, la révélation par les services de l’État de la présence de quatre louveteaux nés au printemps a ravivé les appréhensions de toute part. « On a très peur du braconnage. Ce n’est pas un fantasme, on sait qu’ils sont recherchés », indiquent les naturalistes, selon qui ces naissances sont « exceptionnelles » pour la conservation de l’espèce.
Les louveteaux sont issus d’un croisement entre deux lignées — germano-polonaise côté père, italo-alpine côté mère —, ce n’était pas arrivé depuis plus d’un siècle en France.

Pour les éleveurs, les jeunes loups représentent une menace supplémentaire pour leur activité, alors que sept individus ont été identifiés dans la zone (dont un mâle solitaire). Une trentaine d’exploitants bénéficient actuellement d’autorisations préfectorales de tirs de défense simple, pouvant être délivrés dans le cas de troupeaux susceptibles de faire office de proies.
Lire aussi : Tuer le loup : « Une solution simpliste à un problème complexe »
Quatorze ont été remis la veille de l’annonce des naissances — des autorisations « sans aucun lien avec la découverte de louveteaux », précise la préfecture — et attaqués en justice par l’Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas), qui dénonce une systématisation de l’approche létale ne laissant « aucune chance de survie » à la meute. Des alternatives à l’abattage existent en effet, dénoncent depuis des années les écologues.
Un recours que des éleveurs vivent comme une nouvelle atteinte à leur profession. « On a l’impression d’arriver au cœur d’une impasse. C’est presque allé trop loin », considère l’une d’entre eux.
90 bêtes tuées ou blessées en six mois
Depuis un an, les attaques d’animaux surviennent de nuit comme de jour. D’après les chiffres de la préfecture de Corrèze, entre janvier et juin, la responsabilité du loup est « non écartée » dans 14 des 31 constats réalisés par l’Office français de la biodiversité (OFB) sur la période.
Environ 90 bêtes auraient été tuées ou blessées (puis euthanasiées) par un loup durant le premier semestre, contre 153 sur l’année 2024.

Arnaud Simons a décidé de ne plus laisser ses animaux seuls. Éleveur d’ovins à Peyrelevade depuis trente-cinq ans, victime de prédation en 2021 et 2024, il fait partie du groupement pastoral de trois élevages qui emploie Loïc Defossez et une autre bergère.
Ses brebis sont surveillées en journée, puis enfermées avec des patous dans un parc électrifié la nuit. « Ce triptyque est ce qu’il y a de mieux pour limiter les dégâts, mais n’est pas infaillible. Pendant des décennies, on a pu travailler sans menace permanente. La cohabitation est compliquée, je ne vous le cache pas », témoigne-t-il.

Tous les éleveurs du secteur sont loin d’être aussi bien protégés que lui. Ceux qui sont en « cercle 1 », où la prédation est « avérée », bénéficient d’aides au gardiennage ou de subventions pour l’achat de chiens. Des demandes d’aides « en net augmentation », constate la préfecture : pour 2025, 47 dossiers ont été déposés et sont en cours d’instruction, contre 35 en 2024.
La Confédération paysanne, « ni pro-loup, ni anti-loup, mais pro-éleveur », dont fait partie Arnaud Simons, réclame notamment un élargissement de ce cercle à l’ensemble du parc naturel régional des Millevaches (PNR), et un financement à 100 % des protections. « On pense à ça toute la journée, c’est une grosse logistique pour nous. Avant l’installation de ce dispositif, je pouvais avoir débauché à 19 heures. Ça coupe toute vie sociale, voilà le prix de la tranquillité », ajoute l’éleveur de Peyrelevade.
Des éleveurs découragés
Malgré les aides de l’État, complétées par un accompagnement du PNR (aide administrative, prêt de matériel, diagnostic des risques, chantier participatif d’installation de clôtures…), la charge de travail supplémentaire décourage un certain nombre d’agriculteurs.
« À plusieurs, ils peuvent s’adapter, mais ceux qui sont seuls, comme moi, le loup va finir de nous rendre la vie difficile », déplore une membre de l’Association pour la défense des éleveurs de Mille Sources. Cette Corrézienne, qui souhaite garder l’anonymat, s’est dotée de clôtures électriques et de plusieurs chiens de protection depuis une attaque en 2021.
« C’est plus complexe que ce que l’on nous dit. Il y a toujours un reste à charge, des papiers en plus à faire. Notre territoire a la particularité d’avoir des lots dispersés, ce n’est pas toujours possible de rassembler les bêtes », continue-t-elle.
Les éleveurs de bovins ne sont pas non plus concernés par les aides de l’État. Six bovins de moins de 6 mois ont toutefois été tués ou blessés en 2025, selon la préfecture. « L’année prochaine, sept loups seront formés aux attaques de bétail. Je ne sais pas comment on va vivre avec », s’inquiète celle qui n’est « pas pour flinguer les loups qui restent au fond de la forêt », mais se dit favorable à « prélever ceux qui s’en prennent aux troupeaux de manière récurrente ».

Dans les Alpes et le Jura, des volontaires de l’association Férus se proposent de veiller ponctuellement sur les animaux. « Cela ne remplace pas un vrai berger, mais cela peut soulager les éleveurs. C’est une aide à inscrire dans un ensemble », insiste Bérengère Yar, animatrice dans la région. Elle a contacté certaines fermes du plateau de Millevaches et n’a essuyé que des refus.
Un dialogue miné par les conflits
« En Limousin, cela a du mal à prendre. Personne n’a envie de se lancer, par crainte d’être considéré comme un traître ou un collabo pro-loup », regrette-t-elle. Même si Férus assure que ce dispositif Pastoraloup a fait ses preuves, les éleveurs semblent sceptiques. « Vous croyez vraiment qu’ils vont trouver beaucoup de bénévoles pour passer des nuits blanches à garder les moutons des paysans ? Soyons sérieux », rejette Daniel Couderc, le président de la chambre d’agriculture de la Corrèze (syndiqué à la FDSEA, le syndicat productiviste), joint par téléphone.
Les syndicats majoritaires, FDSEA, Jeunes agriculteurs (JA) et Coordination rurale (CR), refusent toute alternative à l’abattage des prédateurs. Sous leur pression, la diffusion d’un documentaire de Carduelis sur le loup qu’ils jugeaient « provocateur » a été annulée dans un lycée agricole de Corrèze.
« Notre position est claire depuis des années : le loup n’est pas compatible avec l’élevage en plein air. Qu’il soit mis dans un parc animalier, mais certainement pas en liberté au milieu des troupeaux », s’agace Daniel Couderc, dont le syndicat a boycotté la « Cellule loup » organisée sous l’égide du préfet, considérant qu’elle « ne sert qu’à compter les cadavres ». Le 7 août, un rassemblement contre le loup a attiré plus de 500 éleveurs, élus, chasseurs devant la mairie de Millevaches. Les discussions entre « pro » et « anti » n’ont pas évolué depuis.

« Le manque de dialogue crée des préjugés et des oppositions. C’est classique dans un territoire où le loup s’installe, constate Jessica Hureaux, chargée de mission grands prédateurs pour le parc naturel régional depuis 2021. Mieux on connaîtra les loups en présence, mieux on accompagnera les éleveurs. Mais tout le monde se méfie de tout le monde, donc on a du mal à capter les informations. Aujourd’hui, les conflits sont au cœur de la problématique et ralentissent le travail. »
Le retour de l’espèce était prévisible, la région coche de nombreux critères pour qu’elle s’y installe : présence de proies, population peu dense, nombreuses zones-refuges boisées…
Carmen Munoz Pastor et Vincent Primault imaginaient la création d’un « pôle technique » qui regrouperait des spécialistes du loup, des agents de l’OFB, du PNR et des éleveurs, pour étudier le comportement des individus en présence, suivre leurs déplacements et ainsi déployer des dispositifs de protection mieux adaptés sur le terrain, mais les naturalistes attendent toujours un tête-à-tête avec le préfet de Corrèze qu’ils ont sollicité.
Dans certaines régions européennes, comme les Abruzzes en Italie, le grand prédateur est intégré dans le quotidien des bergers depuis des années et est devenu un argument touristique. « C’est une question de volonté politique. Dans notre pays, elle ne va pas dans le sens de la préservation de la biodiversité », jugent-ils.
Sur l’écran de leur ordinateur, de très récents clichés des louveteaux photographiés dans la forêt limousine défilent. On les voit marcher dans les pas de leur mère, les uns à la suite des autres. « Il ne se passe plus une journée sans que l’on nous demande de leurs nouvelles. Nous, on estime que c’est une chance de les avoir sur notre territoire. On vit un moment historique, alors donnons les moyens aux éleveurs de se protéger et préservons ces animaux fabuleux », plaident les deux passionnés.
Bientôt, les jeunes s’aventureront loin de la tanière pour suivre les adultes. « La saison de la chasse débute dans deux semaines, cela ouvre le champ des possibles, se soucient Carmen Munoz Pastor Pastor et Vincent Primault. Pour l’instant, la meute a réussi à passer entre les mailles de tous les filets. Mais là, ça devient vraiment flippant. »
L’activité d’élevage sur le plateau de Millevaches est essentiellement ovin et bovin. Les prairies occupent plus d’un tiers de la superficie du territoire. Au loin, les monts du Cantal.
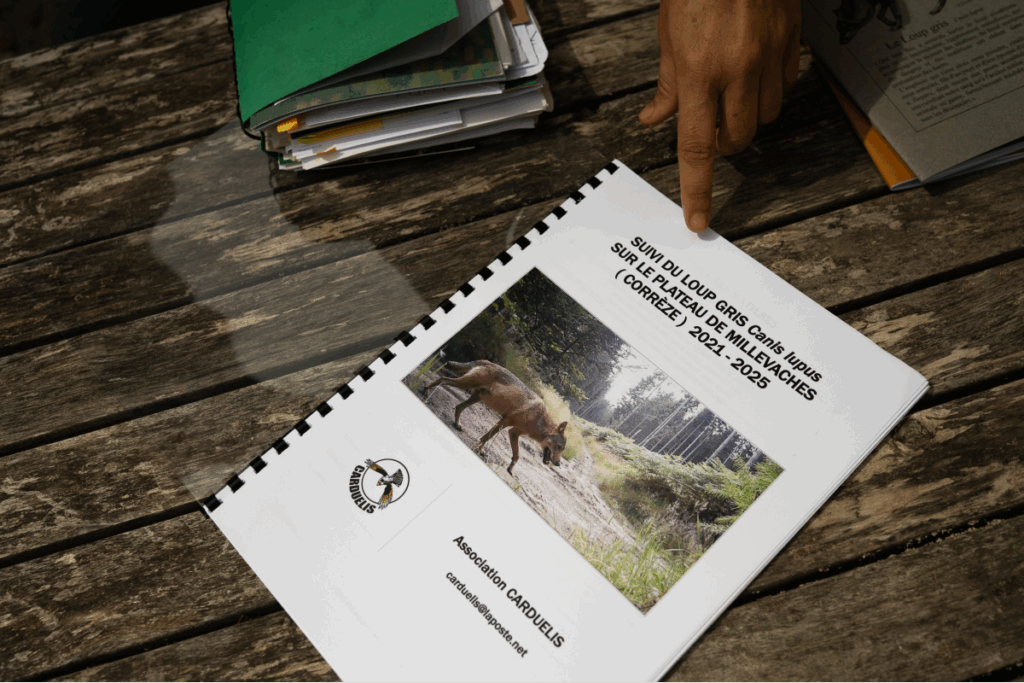
°°°
Source: https://reporterre.net/L-arrivee-du-loup-sur-le-plateau-de-Millevaches-seme-la-discorde
URL de cet article:https://lherminerouge.fr/larrivee-du-loup-sur-le-plateau-de-millevaches-seme-la-discorde-reporterre-29-09-25/
