
Beaucoup a été écrit sur l’imaginaire révolutionnaire des Gilets jaunes, leurs références à 1789, leurs pratiques non conventionnelles. Le mouvement a massifié une culture de l’insurrection, jusqu’alors confinée aux marges. Mais sur celles-ci, bien peu se sont penchés. C’est le cas d’Arthur Pouliquen : dans Le monde ou rien (Cerf, 2025), il dissèque la mouvance « autonome », cette nébuleuse de gauche révolutionnaire adepte de la confrontation directe. Les Gilets jaunes ont fourni aux « autonomes » une assise plus large et prolétarienne ; à leur tour, les « autonomes » ont apporté aux Gilets jaunes une pratique insurrectionnelle, entretenue de longue date.
NDLR : Arthur Pouliquen est également l’auteur de George Sorel, le mythe de la révolte (Cerf, 2023). Retrouve ici son entretien avec LVSL à propos de cet ouvrage.
Par Arthur POULIQUEN
Le jaune est une couleur chaude
Début novembre 2018 la France entre en ébullition. Des millions de citoyens participent au mouvement national des Gilets jaunes (GJ). Des petites agglomérations aux grandes villes, les ronds-points sont occupés et des actions de péage gratuit mises en place, avec un soutien massif parmi les conducteurs. Beaucoup arborent le gilet déjà utilisé en mars par des opposants à la ligne à grande vitesse Paris-Rennes. Le mouvement part de revendications portant sur le prix de l’essence et la réduction de vitesse sur certaines routes. Surtout, il s’organise en ligne, au travers de vidéos, de groupes Facebook et de pétitions, et passe à peu près totalement sous le radar des autorités, dépassées par la vague. Les réseaux militants ne sont pas mieux lotis.
« Le mot d’ordre était bel et bien la démolition en règle de l’Empire »
Dans leur immense majorité ils imaginent tout d’abord que l’appel va rester cantonné aux réseaux sociaux. Ensuite, constatant la force et la pérennité de la mobilisation dans le pays, ils tergiversent : ne s’agit-il pas d’un soulèvement poujadiste, portant sur des thèmes libéraux, voire réactionnaires ? Les organisations d’extrême droite appellent à le rejoindre, les policiers sont applaudis, politiciens et grands médias multiplient les déclarations empathiques… Les « gauchistes » ne se sentent décidément pas à leur aise. Ils en regretteraient presque les timides manifestations syndicales.
Puis, fin novembre, le mouvement prend une autre tournure. Les points de blocage se multiplient. Les occupations s’enracinent, se défendent : autour des barricades, on chante dans la nuit, on se bat à l’aurore. Des manifestations déboulent dans les grandes villes. Les revendications s’élargissent au coût de la vie, à la critique du gouvernement. Chaque samedi s’annonce comme un nouvel « acte » émeutier d’une ampleur inégalée. Les organisations patronales ou conservatrices se désolidarisent. Et la répression commence. Car l’inflexion de la doctrine française de maintien de l’ordre entamée en 2016 conduit à de durs chocs, qui génèrent de nombreux blessés graves.
Le 24 novembre, les points chauds se multiplient, les GJ marchent sur les Champs-Élysées. La casse agit comme un déclic libérateur[1]. Du moins fait-elle le tri : nombre d’autonomes changent de regard sur les évènements et commencent à rejoindre le mouvement. Un nombre croissant de militants d’extrême gauche suit, malgré des réticences. Quelques-uns s’y joignent, principalement pour chasser leurs adversaires nationalistes.

Le 1er décembre, un nouveau cap est franchi. Des affrontements d’une rare intensité se déclarent en divers points du territoire, et particulièrement sur la capitale. La bataille se concentre autour des symboles du pouvoir : l’Arc de Triomphe est le théâtre d’une émeute gigantesque. Publié sur Lundi matin quelques jours après les évènements, un témoignage à chaud en propose cette analyse : « Ainsi donc, Paris fut victime de hordes de casseurs venus des profondeurs d’on ne sait quel Enfer, et les braves gardiens de l’Ordre auraient à se plaindre de “violences en marge d’une manifestation”. Pour pouvoir être à la marge, il aurait déjà fallu qu’il y ait eu manifestation… Ce dont il s’agit bien ici en réalité – et il n’en fut jamais autrement – c’est d’une insurrection, car si tout un chacun ne se sentait pas nécessairement le courage ou la force de manier le pavé, le mot d’ordre était bel et bien la démolition en règle de l’Empire. »[2]
Durant les mois qui suivent, ce mouvement d’une forme nouvelle constitue le principal fait de la vie politique française. Son impact sur l’autonomie est immédiatement historique. Car sans se revendiquer de cette expérience (les références mobilisées tiennent plutôt de la Révolution de 1789), le mouvement est décentralisé, hostile à toute récupération, et pratique l’action directe[3]. Les GJ amènent aux autonomes une composante nouvelle, nettement plus prolétarienne – pères et mères de familles nombreuses, ouvriers intérimaires, aides à domicile, maçons, les profils d’hommes et de femmes se renouvellent.
Plus âgés, plus marqués par la vie, et peu au fait des subtiles fractures idéologiques, ces nouveaux manifestants amènent un sang neuf bien que la plupart se démobilisent au fil des mois. Les autonomes doivent aussi composer avec un folklore fait de drapeaux français et de revendications confuses, de symboles patriotes ou révolutionnaires amalgamés, qui les oblige à modifier leurs lignes rouges. Même la couleur jaune traditionnellement associée aux syndicats traîtres se teinte désormais d’une aura révolutionnaire.
La temporalité du mouvement est importante : les GJ apparaissent dans une période de reflux. Les autonomes sont découragés par les campagnes d’expulsion de la ZAD et les premiers mois du quinquennat d’Emmanuel Macron. Puis leur influence (et celle de l’extrême gauche) va croissante début 2019, à mesure que les GJ se réduisent à leur noyau dur, avec des rendez-vous hebdomadaires drainant de moins en moins de monde. Les appels nationaux conduisent à une concentration des forces dans une ville lors de manifestations plus classiques que l’occupation des ronds-points. L’épuisement guette. Le contre-sommet organisé en août pour répondre au G7 de Biarritz est un échec. Un camp situé à Urugne, sur la côte basque, rassemble GJ, altermondialistes et internationaux dans l’ancienne colonie de vacances Nestlé. Les coalitions Alternative G7 et G7 EZ en charge de l’organisation proposent « legal team », cantines solidaires et autres espaces détente, mais le faible nombre de participants et l’importance du dispositif policier rendent l’initiative inoffensive.
Lors de l’hiver 2018-2019, la violence des affrontements à Paris comme dans nombre de préfectures et sous-préfectures indique pourtant une situation pré-insurrectionnelle. Participants et observateurs, autonomes et services de renseignement ne s’y trompent pas. Mais ce constat tranche vivement avec l’absence totale des armes : malgré des épisodes extrêmement tendus, tels que le pillage et l’incendie d’une voiture de l’armée à Paris le 1er décembre, la France ne bascule pas dans la guerre civile : aucune fusillade n’est enregistrée.
Les millions d’armes à feu présentes sur le territoire national restent dans leurs armoires fortes[4]. La forme déstructurée du mouvement et, surtout, son déclin progressif que tous constatent enterrent les projets les plus résolus. Malgré la présence de nombreux manifestants très déterminés, parmi lesquels divers activistes, chasseurs et anciens militaires, la « dernière jacquerie » modère son niveau de violence. Et les autonomes qui y participent massivement suivent la tendance générale bien plus qu’ils ne la dirigent[5].
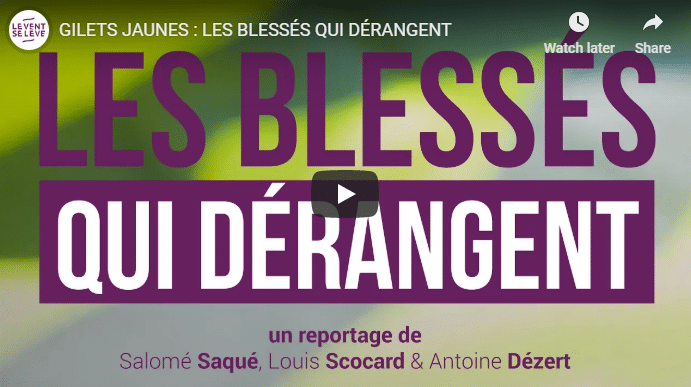
Tout au plus ont-ils un rôle d’inspiration, associés à l’idée fantasmagorique de « black blocs » craints puis espérés, prêts à rejoindre les émeutiers pour tenir en respect la police. Certains de leurs slogans anti-police et quelques techniques de manifestation basiques se diffusent effectivement. Des pratiques s’internationalisent presque immédiatement : les « cacatovs », ces bocaux remplis d’excréments apparus comme projectiles dans les révoltes d’Amérique latine, ou les nuées de parapluies que les protestataires honk-kongais utilisent pour se protéger des tirs sont vite adoptés dans les rues françaises. Mais le principal apport des autonomes tient plutôt à leur expérience face à la répression.
En effet, après une brève période de tolérance, les peines de prison s’abattent par centaines sur des GJ qui manifestent parfois pour la première fois de leur existence, en tout cas fort démunis face à la justice. De ce point de vue, les autonomes participent avec de nombreux autres militants d’extrême gauche à ce travail ingrat d’explication, de collecte de fonds, de recherche d’avocats, de suivi des comparutions puis, le cas échéant, d’envoi de courriers et de mandats aux prisonniers, d’accompagnement des familles… Les structures « antirep » sous forme de Défenses collectives (DefCo) ou d’assemblées de ville sont réactivées. Avec une réelle efficacité locale, quoique les pratiques divergent : faut-il systématiquement envisager une défense politique, « de rupture », ou se contenter de proposer des conseils juridiques ?
Lundi matin[6], Nantes révoltée, Rouen dans la rue, Cerveaux non disponibles et d’autres médias en ligne de tendance communiste libertaire ou « insur » couvrent les évènements. Quelques groupes autonomes essaient de structurer a minima la révolte en diffusant textes d’analyse et conseils pratiques. Des journaux spécifiques apparaissent, comme Jaune, tendance « autonomie prolétarienne », ainsi qu’une pléthore de canards locaux. Des réflexions sont publiées à chaud pour saisir la portée de l’épisode vécu, par exemple avec l’ouvrage Soulèvement qui replace les GJ dans un contexte global[7].
La critique « antitech » trouve une nouvelle jeunesse à la faveur du confinement.
Hors des autonomes, des observateurs extérieurs, sondeurs, policiers, politiques ou universitaires, constatent la tendance. La sociologue de la violence en politique Isabelle Sommier tente un bilan comptable : « Les différents épisodes contestataires mobilisent des acteurs anciens (autonomes, syndicats, agriculteurs) et nouveaux. Les autonomes, en développement depuis les années 2000 […], arrivent en tête des 835 faits [recensés], ils sont les principaux auteurs des violences qu’a connues la mobilisation contre la loi Travail ». Ainsi, les autonomes « connaissent une montée en puissance certaine, en particulier depuis 2016 ; on en comptait 150 lors du 1er mai 2017, 1200 l’année suivante, et 1500 lors de l’acte 18 des Gilets jaunes le 16 mars 2019. »[8]
Covid, scrutin, spleen
La séquence ouverte par cette révolte en jaune ne se clôt qu’avec le COVID19. Après plusieurs mois d’inquiétude et de confusion, en mars 2020, la France se confine. La pandémie frappe l’ensemble des aspects de la vie courante. Elle s’accompagne de restrictions des libertés publiques plébiscitées au nom de la sauvegarde de la santé des plus fragiles. Cette soudaine rupture avec la normalité est envisagée de manière assez différente par les différents groupes militants. Sans surprise, comme pour le reste de la population, elle est globalement très mal vécue.
Une anxiété mêlée d’ennui prévaut. Dans les villes, des Brigades de solidarité populaire (BSP) sont lancées dès la fin mars à l’initiative d’autonomes qui importent le modèle milanais. Des BSP fleurissent un peu partout sur le territoire, dans le Sud, à Grenoble, dans plusieurs arrondissements de Paris et de sa banlieue ainsi qu’en Suisse et en Belgique, dans des régions francophones où s’exportent nombre de projets autonomes. Les brigadistes organisent la collecte et la diffusion de masques ou de vivres. Leur succès tient à cette dimension pratique, facilement reproductible – et aussi, il est vrai, au fait qu’il s’agisse d’une des rares activités proposées durant la période.
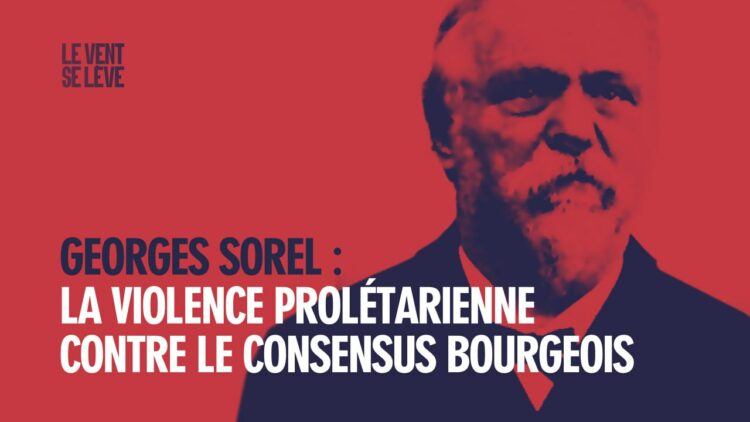
Les autonomes des champs sont mieux lotis que leurs camarades des villes. La vie de village est moins affectée par les restrictions. Mais la perspective de nouvelles mesures de contrôle des populations inquiète. La critique « antitech » trouve alors une nouvelle jeunesse. Des sabotages d’antennes 5G ont lieu sur tout le territoire pendant le confinement, particulièrement dans le Jura et la région grenobloise, et agitent beaucoup les services de renseignement. À défaut de bloquer les flux de marchandises et de capitaux, est-il possible de couper ceux des données, vitaux pour l’économie contemporaine ? Début avril 2020, en Isère, c’est un laboratoire de recherche scientifique qui est la proie des flammes. Relayés sur quelques sites anarchistes, ces sabotages impliquant des moyens assez limités ne sont pourtant guère médiatisés.
Ailleurs, une tendance isolée maintient une position de rupture radicale avec la gauche. Elle axe sa critique sur le traitement de la pandémie (et de ses opposants), refuse le consensus et voit d’un bon œil les manifestations qui éclosent contre le pass sanitaire.
Un Manifeste conspirationniste, diffusé fin janvier 2022 au moment du « convoi de la liberté » réunissant ex-GJ et militants anti-vaccins, commente, ironique : « Comme en 1914, le spectacle le plus désopilant nous est offert par tous ces radicaux qui ne peuvent s’avouer qu’ils sont passés dans le camp gouvernemental. En 1914, on avait bien rigolé de voir les tenants anarchistes de la “guerre sociale” convertis dans l’instant à la guerre au boche. Aujourd’hui, les radicaux d’hier sont pour le confinement, à condition qu’il soit autogéré. Contre le “pass sanitaire” tant que tout le monde ne l’aura pas. Pour les “vaccins”, par solidarité, mais sans trop savoir que penser de ce qu’il y a dedans ni de ceux qui les produisent. Il y en a même qui poussent le goût du paradoxe jusqu’à juger l’obligation vaccinale infantilisante et demander en conséquence “plus de pédagogie”. »[9]
La revue Entêtement dont le premier numéro sort également en janvier 2022 diffuse ces positions. Après les divisions de la ZAD, la séquence du COVID19 laisse donc des séquelles. Bien des locaux ont mis la clé sous la porte. Des collectifs se sont faits et défaits. Et des amitiés se brisent : les « appelistes » se déchirent entre « conspirationnistes » revendiqués, hostiles à toute compromission, et partisans d’un agrandissement du front écologiste, dans lequel beaucoup se fondent.
La republication de l’Appel en 2023 est l’occasion pour Julien Coupat de solder les comptes avec certains de ses anciens camarades. Par une étrange facétie de l’histoire, sa trajectoire rappelle ici celle de Debord. Sa préface à l’Appel formule une série de critiques très personnelles, en rupture avec la dimension collective (et gratuite) du texte initial. L’étiquette « appeliste », quoiqu’encore décriée, est l’enjeu d’une rude concurrence : qui est légitime pour s’en revendiquer ? « La vérité est que la meilleure critique desdits “appelistes”, là où ils existent, se trouve dans l’Appel lui-même. Qui sait lire ne peut sincèrement croire que les promoteurs du néo-activisme écologiste seraient, dans leur fuite en avant désespérée, des “appelistes”. Non plus que tel site racoleur pour universitaires en déroute que la crainte de déplaire, la terreur de prendre le mauvais parti, a rendu virtuose dans l’art de ne rien dire, mais sur un ton de défi. Ou ces relaxés de l’anti-terrorisme qui, du fond de leur village, protestent à présent dans les journaux de leur “respect des institutions”. »[10]
La fin du premier quinquennat d’Emmanuel Macron est ressentie par beaucoup d’autonomes comme une période de spleen. Le potentiel insurrectionnel des GJ semble effacé par l’interminable séquence de la pandémie. Ensuite, la campagne électorale ne donne pas lieu à de grandes contestations. L’excitation de 2017, avec sa marginalisation inédite des deux partis ayant jusqu’alors régenté la vie politique sous la Cinquième république, retombe. Tout au plus Lundi matin annonce-t-il une curieuse candidature collective, le « mouvement Akira », présenté le 19 septembre 2022 par un groupe masqué lors d’un happening parisien dans la cour du musée Carnavalet. De mystérieuses affiches « Rejoins la révolution » complètent le dispositif. Le ton grandiloquent du communiqué, relayé par quelques médias, suscite les ricanements de la plupart des militants. Trop prétentieux pour les radicaux, trop ésotérique pour le commun ? Suivent quelques justifications laborieuses. L’initiative ne prend pas, et le soufflé retombe.
Notes :
[1] Anonyme, Beau comme une insurrection impure, préface à l’édition italienne des trois livres du CI, 19 janvier 2019.
[2] « À nos ennemis », Lundi matin n°168, publié en ligne le 7 décembre 2018.
[3] Julien Allavena, L’hypothèse autonome, 2020.
[4] « France : 15 millions d’armes à feu », Le 1 n°199, 25 avril 2018. Ce chiffre (estimation cumulée des armes légales et extralégales) ferait de la France l’un des pays européens au plus haut taux d’armes par habitants – alors même que la législation y est particulièrement contraignante, comparée à ses voisins.
[5] Pris au dépourvu, les services de renseignement surestiment par habitude le rôle des réseaux militants préconstitués. Parfois avec des conséquences tragi-comiques, comme l’arrestation musclée de Julien Coupat et de l’un de ses proches le 8 décembre (plusieurs milliers d’arrestations « préventives » sont réalisées ce jour-là), occupés à manger des croissants…
[6] « Gilets Jaunes. Un assaut contre la société », Lundi matin papier n°4, avril 2019.
[7] Mirasol, Soulèvement. Premiers bilans d’une vague mondiale, 2020.
[8] Isabelle Sommier et al., Violences politiques en France, 2021, p.339. Le comptage des « autonomes » est discutable mais la tendance croissante est assez nette. De tels travaux académiques servent de base au rapport parlementaire sur « l’activisme violent », présenté en novembre 2023, et dont la conclusion propose de nouvelles mesures répressives.
[9] Anonyme, Manifeste conspirationniste, 2022, p.38.
[10] Op. cit., p.10.
°°°
Source: https://lvsl.fr/les-gilets-jaunes-et-la-culture-de-linsurrection-retour-sur-les-autonomes/
URL de cet article: https://lherminerouge.fr/les-gilets-jaunes-et-la-culture-de-linsurrection-retour-sur-les-autonomes-lvsl-29-10-25/
