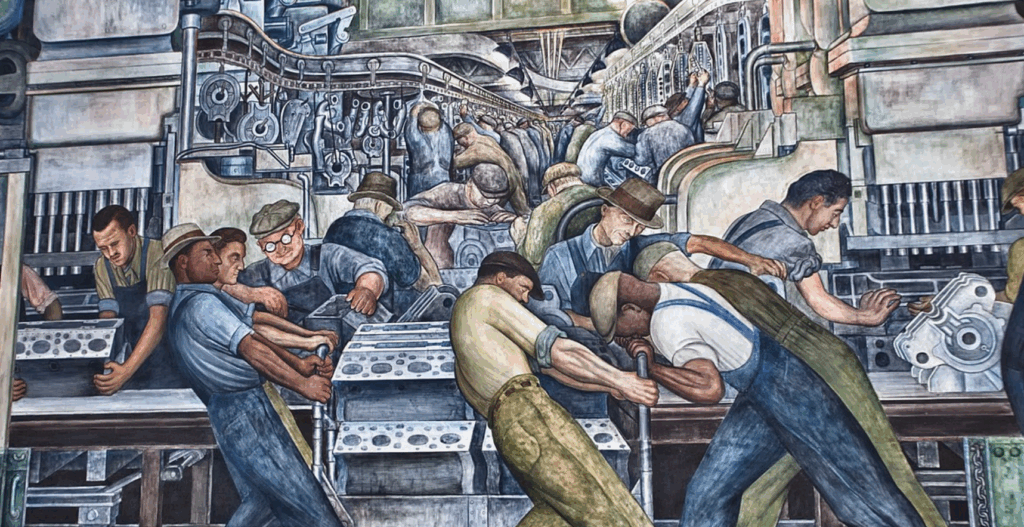
La critique de l’exploitation peut-elle se passer de la théorie marxiste de la valeur ? Sur le livre d’Ulysse Lojkine
Simon Verdun propose dans ce texte une lecture critique serrée de l’ouvrage d’Ulysse Lojkine, Le fil invisible du capital (éditions La Découverte) dont Contretemps a déjà publié un extrait. Il soutient notamment que la théorie marxiste de la valeur est nécessaire à la fois pour analyser d’une manière conséquente l’exploitation et pour lutter politiquement contre elle.
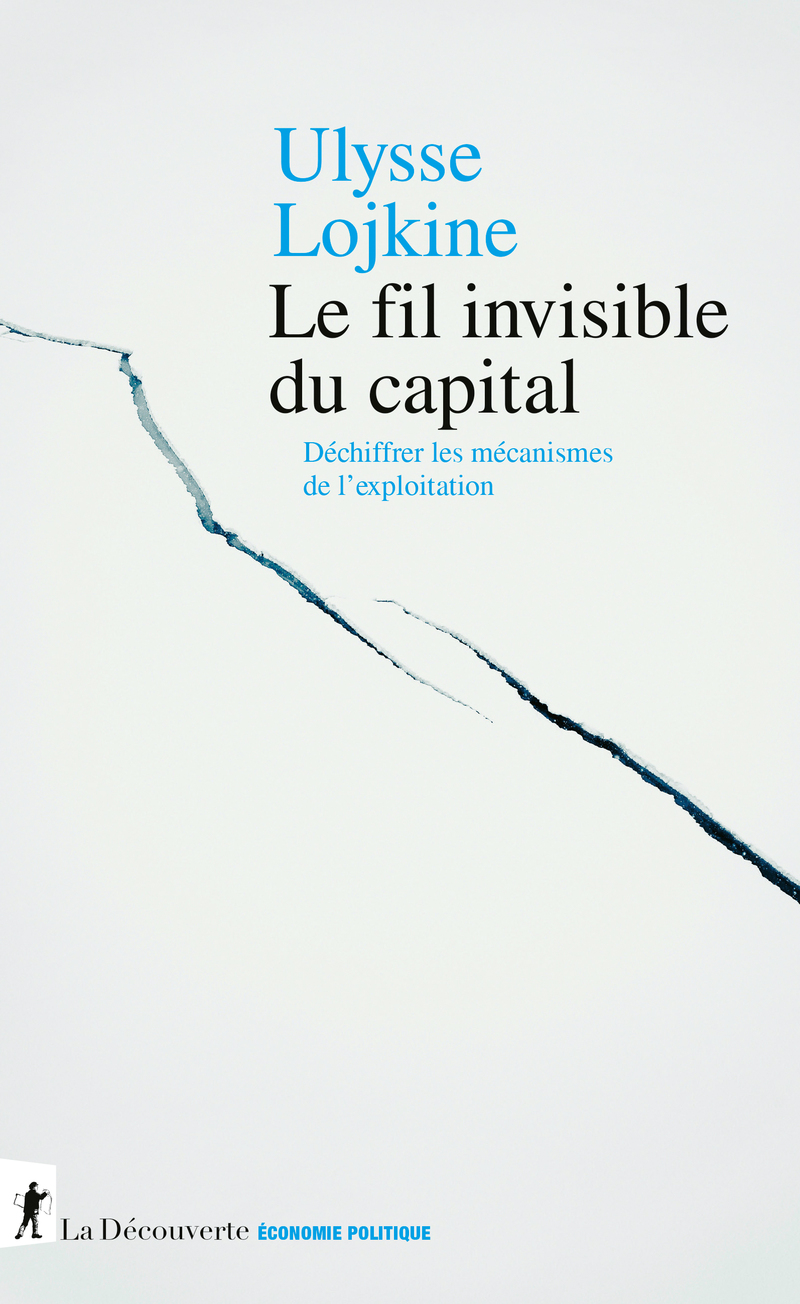
Ulysse Lojkine, Le fil invisible du capital. Déchiffrer les mécanismes de l’exploitation, Paris, La Découverte, 2025, 256 pages.
Par Simon VERDUN.
Introduction
En avril 2025, l’économiste et philosophe Ulysse Lojkine a publié aux éditions La Découverte son livre Le Fil invisible du capital. Déchiffrer les mécanismes de l’exploitation, issu de son travail de thèse. Sans méconnaître les mérites indéniables de l’ouvrage – qui s’appuie sur une littérature économique et philosophique impressionnante, enrichie de références juridiques et d’actualité, et qui dresse un tableau saisissant de l’exploitation capitaliste à l’échelle mondiale –, notre article se concentrera sur quelques critiques touchant au cœur du projet de l’auteur : l’ambition de Lojkine d’élaborer une théorie de l’exploitation affranchie de la théorie de la valeur de Marx. C’est donc la question de la fidélité – ou non – à la théorie économique de Marx qui est ici en jeu, d’autant que Lojkine présente lui-même son approche comme une possible amélioration de celle établie par l’auteur du Capital :
« … en répondant aux objections [adressées à la théorie de Marx], on les absorbe aussi ; ce qui ne tue pas rend plus fort, et en même temps que la théorie de Marx est défendue, elle est insensiblement transformée. » (Ulysse Lojkine, Le Fil invisible du capital, La Découverte, Paris, 2025, p. 26).
Il nous semble au contraire que cette transformation est loin d’être aussi insensible que ce qui est annoncé. Car dans son travail, Lojkine ôte en fait toute portée « explicative » (sur la formation des prix et des revenus capitalistes, du profit notamment) à la théorie de la valeur de Marx, pour lui conférer une fonction uniquement « descriptive ». Ainsi, la référence à la théorie de la valeur de Marx ne sert à l’auteur que comme un prétexte pour fonder une « comptabilité en travail » censée rendre visible les mécanismes de l’exploitation, et dont nous verrons qu’elle ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes. Mais fondamentalement, au terme du premier chapitre du Fil invisible, il ne subsiste plus aucun des concepts spécifiques à la théorie économique de Marx, étant bien sûr entendu qu’il ne suffit pas qu’une théorie reconnaisse le caractère nécessaire de l’exploitation en régime capitaliste pour qu’elle puisse être qualifiée de « marxiste » (dans une certaine mesure Ricardo reconnaît que les profits ont pour origine l’appropriation du travail non-payé, de même que Smith dans quelques passages de la Richesse des nations). C’est particulièrement le cas pour le concept cardinal de la théorie économique de Marx : la « survaleur » (ou « plus-value »), comme appropriation du produit de valeur du travail non payé et qui constitue chez Marx la source des profits capitalistes, n’a plus aucun sens dans la conceptualité proposée par Lojkine puisque sa pertinence tombe en même temps qu’est dénié tout caractère « explicatif » à la théorie de la valeur.
Qu’il y ait rupture ou révision n’est pas un mal en soi pour un chercheur et la question demeure néanmoins de savoir si la révision théorique proposée par Lojkine de la théorie marxiste permet d’aller plus loin que cette dernière, en bref, si elle constitue une théorie de l’exploitation qui devrait être préférée à celle défendue par les marxistes, comme l’auteur l’affirme. À cette question, il nous semble précisément qu’il convient de répondre par la négative.
Nous verrons en quoi le refus de l’auteur à donner une portée « explicative » à la théorie de la valeur de Marx au profit d’une approche « purement comptable » du travail participé et approprié a nécessairement une incidence sur sa théorie de l’exploitation, qui demeure du même coup équivoque. Mais cette équivocité a une conséquence particulièrement fâcheuse d’un point de vue marxiste, puisqu’elle conduit Lojkine à relativiser ce qui était justement central dans l’argumentation de Marx : l’existence d’un antagonisme de classe fondamental entre prolétaires et détenteurs des moyens de production. Chez Marx, parce que le profit capitaliste sous sa forme la plus simple de profit industriel n’est que de la survaleur provenant du travail gratuit des prolétaires, il importe peu que le capitaliste soit petit ou gros pour qu’il soit immédiatement considéré comme exploiteur : il l’est dès lors qu’il réalise un profit, compte tenu de sa place dans les rapports de production. Dans le cas où Marx examine le cas de la péréquation des taux de profit, où la survaleur globale se trouve répartie équitablement entre les capitalistes des différentes branches, c’est l’existence de la survaleur qui fonde la complicité objective de classe de l’ensemble des capitalistes, indépendamment de leurs poids ou de leurs différences d’activité : tous se partagent le produit de valeur du prolétariat exploité dans son ensemble, indépendamment de l’importance de leurs avances ou de leurs secteurs d’activité.
La théorie de Lojkine aboutit selon nous à une conclusion complètement inverse : ce ne serait pas la position de classe dans les rapports de production qui suffirait à déterminer le statut d’exploiteur de l’agent, mais son niveau de revenu rapporté à sa participation, indépendamment de la nature de ce revenu (puisque la question de leur origine est de toute façon laissée de côté). Autrement dit, Lojkine en vient à considérer que certains petits capitalistes pourraient non seulement ne pas être des exploiteurs, mais devraient même être considérés comme des « exploités », dès lors que leurs profits restent en deçà d’un certain seuil, c’est-à-dire inférieurs à la quantité de « travail » qu’ils accomplissent eux-mêmes. C’est à cette conclusion, qui participe nécessairement à fonder l’existence d’un intérêt commun entre prolétaires et petits capitalistes, que nous nous opposons, et nous chercherons à montrer qu’elle découle nécessairement de l’abandon de la théorie de la valeur de Marx.
Cet abandon a une autre conséquence, que nous ne pouvons d’indiquer brièvement ici : non seulement l’approche comptable de Lojkine, parce qu’elle délaisse le terrain explicatif de l’origine des revenus, ne peut pas parvenir à formuler une théorie univoque de l’exploitation, mais elle conduit nécessairement son auteur à des solutions purement réformistes dans le dernier chapitre programmatique de l’ouvrage (« Les mécanismes de l’égalité », p. 199-235) : appel au prétendu « État social », mécanismes redistributifs, hausse générale des salaires[1], planification de certains secteurs, ou encore « algorithmes d’appariement » des agents vers certaines activités.
S’il y a exploitation dès lors que les quantités de travail appropriées par les agents individuels sont supérieures aux quantités de travail qu’ils fournissent, comme le soutient Lojkine, alors la seule façon de combattre l’exploitation est de faire en sorte que les revenus des agents soient en proportion du « travail » qu’ils abattent réellement, indépendamment de leur position de classe et donc indépendamment de toute considération sur la nature exacte de leur « travail » (la distinction travail productif/improductif de Marx est nécessairement abandonnée en même temps que sa théorie de la valeur). Indiquons cependant que la théorie de la valeur de Marx n’a pas seulement pour objectif de fournir une explication de l’origine des revenus et de la formation des prix relatifs (ce que Lojkine appelle l’aspect « quantitatif » de la théorie marxienne de la valeur), elle cherche également à expliquer l’existence même de la forme-valeur, de la forme marchandise des produits du travail, dès lors qu’existent certaines conditions de production et que le travail social doit se valider par la vente (ce que Lojkine appelle son aspect « qualitatif » et qu’il déclare encore laisser de côté, p. 30, note 1). La réponse fondamentale des marxistes au phénomène de l’exploitation en régime capitaliste est donc bien différente d’une simple redistribution des revenus ou d’aménagements institutionnels censés limiter ses effets. Elle consiste au contraire dans l’abolition de la forme-valeur des produits du travail, dans la destruction des rapports mercantiles, au moyen d’une planification centralisée de l’intégralité du travail social, qui demeure, selon Marx, le seul moyen pour se débarrasser définitivement de l’économie marchande et de l’exploitation dont elle est inséparable.
Ceci étant dit, passons maintenant à l’examen du projet théorique de l’auteur avant d’aborder nos points critiques.
La raison d’être de la « comptabilité en travail » de Lojkine : l’exploitation en régime non-marchand et marchand
L’auteur commence par une définition tout à fait claire de la notion d’exploitation. Il y a exploitation au sens économique du terme dès lors qu’il y a appropriation nette du travail d’autrui, à condition que cette appropriation se fonde sur un « rapport de pouvoir asymétrique » qui oblige de fait certains à travailler pour d’autres.
« … le capitalisme est structurellement un système d’exploitation de certains groupes sociaux par d’autres, au sens d’une appropriation du travail d’autrui combiné à une relation de pouvoir asymétrique. » (p. 9)
Selon l’auteur, je m’approprie du travail d’autrui lorsque je reçois certains produits ayant nécessité une certaine quantité de travail dépensée par d’autres : je suis donc « appropriateur net », c’est-à-dire exploiteur, lorsque la totalité ou une partie des marchandises ou services que je reçois de la société ont nécessité une quantité de travail plus importante que celle que je lui ai fourni en retour, par mon propre travail. Pour statuer sur le fait que tel individu est un exploiteur ou un exploité il faut donc, selon Lojkine, comparer le temps de travail participé de cet agent au temps de travail incorporé que cet individu reçoit, que ce soit sous la forme d’une somme de marchandises déterminées, ou que ce soit sous la forme d’une valeur d’échange, d’un revenu.
« … un capitaliste « idéal » – détenteur des moyens de production qui ne travaille pas lui-même – touche un profit monétaire qui lui confère un pouvoir d’achat et donc d’appropriation du travail d’autrui. C’est un exploiteur. Inversement, les salariés produisent plus qu’ils ne touchent – l’écart étant justement constitué par les profits. Leur travail approprié est inférieur à leur travail fourni : ce sont des exploités. » (p. 23-24)
Cette considération sur le « capitaliste « idéal » » semble à première vue indiquer que pour Lojkine c’est la position de classe, le fait d’être un détenteur de moyens de production réalisant un profit, qui fait du capitaliste un exploiteur, chose tout à fait conforme à l’analyse marxiste. Nous verrons par la suite que c’est en réalité un peu plus compliqué que cela pour l’auteur, qui admettra par la suite que le capitaliste peut « travailler lui-même » et qu’il peut donc, par conséquent, ne pas être un « appropriateur net », même s’il réalise un profit.
Dans la société non-marchande féodale que Lojkine prend pour exemple, dans laquelle le rapport d’exploitation fondamental est le système de la corvée seigneuriale, l’auteur remarque avec justesse qu’il est facile de déterminer qui exploite le travail de qui et dans quelle proportion. Nous n’avons en effet affaire ici qu’à un transfert de produits en nature depuis le serf jusqu’au seigneur, et il est donc aisé de convertir directement ces différentes quantités de valeurs d’usage en temps de travail (par exemple, en nombre de mois dans l’année) que le serf consacre exclusivement au service de son protecteur et maître.
Mais l’évidence de cette situation s’évanouit presque complètement dans le mode de production marchand développé, c’est-à-dire dans le capitalisme. La distinction évoquée par Marx entre les « deux parties de la journée de travail » est toute virtuelle, et aucun prolétaire peut évidemment savoir quelle fraction de sa journée de travail correspond au temps de travail « pour soi » et au temps de travail où il travaille pour constituer le profit du patron. La catégorie de salaire elle-même masque totalement cette idée d’un temps de travail qui ne serait pas payé : le travailleur est payé pour ses 8 ou ses 10 heures, et rien ne lui indique, évidemment, sur sa feuille de paye qu’il a travaillé gratuitement pour un autre.
De la même manière, et contrairement à ce qu’il se passait dans le système de la corvée seigneuriale où les produits du travail se présentaient directement sous la forme tangible et rassurante de valeurs d’usage, dans la société marchande ces produits du travail sont devenus marchandises, c’est-à-dire valeurs. Ce qui revient aux différentes parties se présente désormais sous la forme métamorphosée de valeurs d’échange, quantités d’argent, en somme, sous la forme de revenus, fractions du chiffre d’affaire total dans lequel il est devenu bien difficile de reconnaître la forme cristallisée d’un travail dépensé.
Pour reprendre le raisonnement très juste de l’auteur, cela signifie que la dissolution des rapports anciens et de l’échange inégal en nature a laissé place à un échange tout aussi inégal, mais qui se dissimule et se dérobe lui-même à notre regard, à la faveur de la forme neuve prise par le produit du travail dans la société marchande : la valeur d’échange. Le phénomène de l’exploitation, la différence entre travail approprié et travail dépensé, qui s’étalait sans pudeur dans les anciennes sociétés non-marchandes, est devenu invisible dans la société marchande développée, la société capitaliste. Or pour l’auteur, ce qui est devenu invisible, nécessairement à la faveur des exploiteurs et de leur ordre inique, réclame d’être rendu visible. Le parallèle employé par Lojkine avec la corvée féodale a donc une fonction autre que celle de faire seulement sentir la différence de forme entre deux types de rapports recouvrant en définitive la même substance. La corvée féodale, la transparence caractéristique de ses rapports, est le symbole de ce qui a été perdu avec le passage à la société marchande : la possibilité de traquer et de suivre, quasiment à la trace, les formes de manifestation naturelle d’un surtravail incapable de se travestir, la possibilité d’établir la franche et indiscutable limite (rêve de comptable !) entre bénéficiaires et débiteurs nets.
La lancinante question prononcée dès le début de l’ouvrage et qui détermine tout le projet de recherche de l’auteur (« qui exploite qui ? », « qui travaille pour qui ? », p. 20) apparaissait sans mystère dans la corvée féodale. Il en va tout autrement lorsque le produit du travail « pour soi » et du « surtravail » se représente sous la forme de valeur d’échange, d’une masse monétaire, en bref, lorsqu’il prend l’apparence du revenu. La corvée féodale est donc, pour l’auteur, la forme simple de manifestation du surtravail à laquelle il faut revenir pour faire apparaître une réalité qui, dans la société marchande, demeure soustraite à nos sens.
Il ne s’agit ni plus ni moins que de la question de la possibilité de fixer, à côté de la mesure extérieure de la valeur comme prix ou valeur d’échange, « les principes d’une « comptabilité en travail » qui complète la comptabilité en nature et la comptabilité en argent » (p. 13), et que l’auteur juge susceptible de révéler les quantités de travail représentées dans les revenus des différents agents économiques, afin de les mettre en balance avec leurs contributions en travail réalisé. C’est maintenant le projet d’une telle comptabilité qu’il nous faut examiner.
La comptabilité en travail
Voici donc posés les termes du problème : il faut, pour l’auteur, parvenir à instaurer « les principes d’une « comptabilité en travail » » susceptible de « [compléter] la comptabilité en nature et la comptabilité en argent » (p. 13), en somme donc, réussir à découvrir les principes d’une conversion des valeurs d’échange (des prix) en quantités de travail.
Ce qui est au cœur de la démarche est donc l’idée qu’il serait possible de passer, de façon non équivoque, d’une certaine quantité de valeur d’échange à une certaine quantité de travail. C’est cette même idée d’une conversion possible et univoque entre prix et quantités de travail qui est présente derrière l’idée que derrière des flux de valeurs d’échange se cachent des flux de travail qu’il serait pratiquement possible de déterminer (« … mesurer à titre descriptif les flux de travail entre les participants d’une économie capitaliste », p. 30). Esquissant ce projet d’une convertibilité des valeurs d’échange en quantité de travail, Lojkine en arrive logiquement à se demander :
« Pour affirmer que l’appropriation de valeur marchande est toujours une appropriation du travail, ne faut-il pas adhérer à la croyance naïve selon laquelle c’est le travail incorporé dans une marchandise qui ferait son prix ? […] il n’y a nul besoin de postuler une théorie particulière des prix pour défendre les principes d’une « comptabilité en travail » qui complète la comptabilité en nature et la comptabilité en argent, et dont l’un des résultats est de confirmer que la propriété lucrative et sa concentration aux mains d’une classe implique bien l’appropriation par celle-ci d’une part du travail social. » (p. 13-14)
Deux choses doivent être remarquées ici. Il est possible de voir dans cette mention d’une « croyance naïve » une allusion à la théorie ricardienne de la valeur, et, d’une façon qui deviendra plus évidente dans le chapitre 1 du Fil invisible, au procédé simplificateur qui sera celui de Marx dans les deux premiers livres du Capital. Pour le dire brièvement, Ricardo, dans les Principes de l’économie politique et de l’impôt, part du principe selon laquelle les valeurs d’échange des marchandises sont déterminées directement par les quantités de travail qu’elles incorporent. C’est du moins ce que Ricardo défend au début de ses Principes, mais il découvre peu à peu que cette loi ne peut pas être vérifiée dès lors que l’on prend en compte un autre principe, celui du postulat de l’égalisation des taux de profit du fait de la concurrence que se livrent entre eux les différents capitaux. Puisque chaque capital investi réclame de toucher le taux de profit moyen (dans l’hypothèse d’une mobilité parfaite des capitaux entre les branches), les différentes marchandises doivent se vendre à ce que Ricardo appelle leurs « coûts de production » (les « prix de production » chez Marx), soit un montant représentant par la somme des avances totales du capitaliste plus le taux de profit général. Ces prix de production (et encore davantage les prix de marché, les prix empiriques) représentent donc des prix nécessairement distincts de ceux auxquelles les marchandises s’échangeraient si les prix étaient déterminés directement par les quantités de travail.
C’est cette théorie « naïve » des prix, c’est-à-dire de la détermination des prix par les quantités de travail, que Lojkine rejette avec raison : pour le dire de façon ramassée, il devient impossible dans les faits de relier une valeur d’échange, un prix, à une certaine quantité de travail univoque puisque les prix des marchandises ne peuvent pas s’établir pas en fonction des quantités de travail qui sont dépensées pour leur production. Cela signifie très concrètement qu’il est possible que deux marchandises au prix identique renferment en réalité des quantités de travail incorporées tout à fait différentes, et inversement, que des quantités de travail identiques incorporées dans plusieurs marchandises reçoivent des prix différents. La perspective de Marx dans le livre I, où celui-ci suppose que les valeurs d’échange correspondent directement aux quantités de travail n’est donc pas directement applicable, comme le remarque l’auteur. S’il en était ainsi, la monnaie vaudrait comme un simple voile et il suffirait d’appliquer un coefficient de conversion à une certaine masse monétaire pour redécouvrir derrière elle les quantités de travail correspondantes, comme Lojkine l’analyse au début du chapitre 1 en supposant une économie uniquement agricole où le blé serait la marchandise unique (p. 25).
On aurait cependant tort de comprendre la référence à une telle « croyance naïve » un simple rejet de la conception ricardienne entendue en son sens simpliste. Lojkine va en fait beaucoup plus loin : il prétend réaliser son projet d’une comptabilité en travail, de conversion des valeurs d’échange en quantité de travail, indépendamment de toute référence à une théorie de la valeur en général, et en particulier indépendamment de celle de Marx. C’est donc surtout de la possibilité de se passer de la théorie de la valeur de Marx pour fonder une théorie de l’exploitation dont il est véritablement question.
Lojkine comprend la théorie de la valeur de Marx essentiellement comme une théorie des prix, si l’on entend par là une théorie qui cherche à déterminer pourquoi les prix sont ce qu’ils sont. Or, l’auteur du Fil invisible juge que la théorie de la valeur de Marx est marquée par un vice logique interne et qu’il faut par conséquent l’abandonner. Le débat est ancien, et, sans revenir sur les termes d’un débat qui a déjà fait couler plus d’un siècle d’encre, on peut noter que Lojkine s’appuie sur un certain nombre de jugements d’économistes qui ont vu une contradiction entre le contenu des livres I et III du Capital (Böhm-Bawerk, Samuelson, Steedman…).
« L’idée substantielle de la valeur comme travail aboutit donc à une impasse, comme Paul Samuelson, le père fondateur de l’économie néoclassique d’après-guerre, n’a pas manqué de le remarquer avec ironie : « Considérez deux systèmes alternatifs, mutuellement incompatibles. Notez le premier sur le papier. Maintenant, transformez-le en l’effaçant à l’aide d’une gomme. Substituez le second système. Voilà ! Vous avez appliqué avec succès votre algorithme de transformation. » Ian Steedman, un économiste britannique qui manifestait une sympathie bien plus grande pour le marxisme, en tire d’ailleurs la même conclusion : « Cela n’apporte rien d’utile de calculer les valeurs au sens de Marx », puisqu’ « elles sont simplement déduites des données physiques et celles-ci suffisent à calculer le taux de profit et tous les prix de production. » » (p. 32)
Le fond de l’argument est le suivant. Non seulement le livre I (et II) du Capital d’un côté et le livre III de l’autre seraient contradictoires (Marx raisonne dans le premier cas selon l’échange selon les valeurs dans le premier cas, et selon les prix de production dans le second cas, qui sont deux principes différents de détermination des valeurs d’échange), mais en plus le mode de construction des prix de production à partir des valeurs (exposé principalement par Marx au chapitre 9 du livre III) contiendrait une erreur majeure. L’objection est bien connue et a été popularisée par la « correction » que fait subir Bortkiewicz aux schémas de transformation : les schémas marxiens de transformation seraient logiquement incohérents puisque l’auteur du Capital aurait « oublié » de transformer la valeur des intrants dans le tableau en prix de production. À partir de là, Bortkiewicz s’est cru autorisé à changer l’algorithme de transformation de Marx en système d’équations simultanées, aboutissant à des conclusions théoriques sur la détermination du taux de profit qui contredisent directement les résultats de Marx et restaurent à l’inverse certaines thèses de Ricardo.
Pour le dire vite, c’est ce système d’équations simultanées qui a été repris et perfectionné par Sraffa, qui montre dans Production de marchandises par des marchandises qu’il est possible de calculer des prix de production et un taux de profit moyen à partir de conditions physiques de production et indépendamment des références aux valeurs, contrairement à ce que pensait Marx (et même Bortkiewicz). Pour ce qui est de la critique de l’interprétation de Bortkiewicz-Sraffa, nous renvoyons à la critique détaillée de Michel Husson, auteur d’un important pamphlet « Contre Sraffa » initialement publié sous pseudonyme et qui montre à l’inverse que le détour par les valeurs est bien nécessaire au calcul des prix de production dès lors que l’on restaure la signification initiale des schémas marxiens[2]. Par conséquent, Lojkine peut bien présenter Steedman comme ayant de la « sympathie » pour Marx : le fait demeure que Steedman se rallie en réalité intégralement aux positions néo-ricardiennes de Sraffa dans son ouvrage Marx après Sraffa (Marx After Sraffa) qui constitue en tant que tel une attaque frontale contre l’ensemble des positions théoriques du marxisme en économie. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le jugement d’incohérence logique des schémas de transformation a été vu d’un œil si bienveillant par Samuelson, le père de la théorie néoclassique moderne.
C’est à ce même jugement que Lojkine se rallie en réalité, bien qu’il y consacre peu de développements : son point de départ est donc la faillite de la fonction explicative de la théorie de la valeur de Marx. Lojkine assume d’ailleurs tout au long de son ouvrage le caractère limité de son projet, qui n’est pas de construire une théorie des prix, ni d’expliquer la raison de l’existence de différents revenus, mais de s’en tenir à un projet purement comptable, qui nécessite simplement de partir des prix et des revenus effectifs :
« Pour notre part, de tels verdicts ne devraient pas nous impressionner, car nous n’avons pas introduit la notion de temps de travail incorporé comme auxiliaire pour calculer des prix d’équilibre, mais pour retracer les flux de travail entre les agents et les classes. » (p. 32)
Mesure du travail approprié et mesure du travail participé
On remarque immédiatement une première difficulté relativement à cette conversion : comme nous l’avons dit et comme Lojkine l’a également reconnu, les prix des différentes marchandises (et qu’est-ce qu’un revenu sinon, en puissance, une somme de prix de plusieurs marchandises ?) ne reflètent presque jamais les quantités de travail qu’elles incorporent, de telle sorte qu’on ne peut jamais passer d’un prix en général à une quantité de travail incorporée en général représentée par ce prix.
Lojkine propose une solution visant à déterminer la quantité de travail nécessaire ou incorporée dans une marchandise, qu’il rapproche des méthodes quantitatives visant à mesurer la quantité de dioxyde de carbone « incorporée » dans la production de telle ou telle marchandise, ou de celles des « multiplicateurs d’emplois » qui visent à déterminer « combien d’emplois directs et indirects seraient engendrés par la hausse de la production d’une branche » (p. 38). L’idée est donc de partir de certaines données disponibles indiquant le nombre d’emplois totaux engagés dans la production d’une branche « en ajoutant une information correspondant au temps de travail par emploi dans les différentes branches, ou même en appliquant à ce sujet une convention uniforme » afin d’obtenir le « temps de travail incorporé » dans l’ensemble de la production de la branche, et donc, au final, dans chaque exemplaire singulier de telle ou telle marchandise. C’est en effet tout à fait réalisable : mais on voit bien qu’il s’agit ici de passer d’une valeur d’usage à une quantité de travail, et non d’une valeur d’échange, d’un prix, à une quantité de travail, contrairement à ce qui était annoncé.
Or, le véritable problème est bien ici de parvenir à convertir une masse d’argent déterminée, un revenu, en une quantité de travail approprié, et non des valeurs d’usage individuelles en quantités de travail. Donc, non seulement deux marchandises ayant le même prix peuvent avoir nécessité des quantités de travail tout à fait différentes (de telle sorte que l’on ne peut passer d’un prix en général à une quantité de travail de façon univoque), mais en plus un même revenu peut évidemment servir à acheter des quantités de biens extrêmement divers et renfermant des quantités de travail tout à fait variables.
L’idée de Lojkine, qui cherche à mesurer non pas la quantité de travail incorporée dans les achats d’un individu particulier, mais ce que représente, en quantités de travail approprié, tel niveau de revenu en général, est de proposer ce qu’il considère lui-même comme une « simplification radicale », « une convention » (p. 39). L’idée, tirée du courant marxiste de la « Nouvelle Interprétation », est de dire « qu’un agent dont le revenu monétaire représente un millième du revenu national s’approprie un millième du travail social [de sorte que] la conversion proportionnelle des grandeurs monétaires en temps de travail par un simple changement d’unité est rétablie » (p. 39-40). Du point de vue de la théorie marxiste, le raisonnement nous semble tout à fait valide, à condition toutefois de se placer au niveau d’une économie considérée dans sa totalité (de telle sorte que le résultat ne peut valoir qu’à un niveau mondial) : la valeur d’échange exprimant chez Marx la quantité de travail social que le producteur s’approprie, alors, 1/1000 du revenu total (ou de la valeur d’échange totale) représente bien 1/1000 du travail social global réalisé.
Mais passons désormais à la deuxième partie du problème, non moins essentielle, puisqu’il s’agit désormais de déterminer la quantité de travail participé par chacun, qu’il s’agira de mettre en balance avec la quantité de travail approprié représentée dans le revenu.
La question devient d’autant plus délicate que Lojkine fait intervenir la distinction bien connue entre travail simple et travail complexe, Marx ayant émis l’hypothèse dans le Capital, à la suite d’Adam Smith, qu’il se pourrait que certains types de travaux dits « complexes » forment, durant un temps donné, davantage de valeur que d’autres, dits « simples ». Marx proposait de mettre en rapport ces deux types en affirmant que le travail complexe n’était que du travail simple « élevé à une certaine puissance » ou « multiplié » et passait assez vite sur cette question qui, il est vrai, semblait lui poser quelques difficultés.
Sans prétendre trancher ici ce débat, il nous semble que le problème est assez bien circonscrit dans la théorie de la valeur de Marx. La théorie de Marx cherche à montrer comment se représente sous la forme de la valeur les produits du travail socialement utile de l’ensemble de la société, et comment ces valeurs s’expriment aux yeux des acteurs sous la forme spécifique des rapports d’échange (valeurs d’échange ou prix). Pour le dire simplement, s’il faut x heures de travail pour produire telle marchandise, les x heures de travail incorporent de fait un mélange indissociable de travail simple et de travail complexe, qui ne se présentent pas autrement que sous la forme de cette unité déterminée de temps, sans qu’il soit besoin de chercher à trouver comment convertir l’un dans l’autre. Du reste, les perspectives de Marx et de Lojkine sont très différentes : le problème de Lojkine est de proposer un critère permettant de déterminer si chacun pris individuellement est un exploiteur ou un exploité, indépendamment de sa position de classe ; le problème de Marx était, pour le dire vite, davantage structurel (comment se représente le travail social dans la société marchande et comment il se répartit de façon forcément inégalitaire en fonction des places occupées par les agents dans les rapports de production.).
Dans le cas précis du projet théorique de Lojkine, par contre, il est clair que le problème est redoutable, puisqu’il s’agit de déterminer avec une relative précision la quantité de travail participé de chacun pour la mettre en rapport avec la quantité de travail qu’il s’approprie via son revenu : la moindre erreur dans la détermination de la quantité de travail participé pouvant faire passer tel agent dans le camp des exploiteurs en lieu et place de celui des exploités, et inversement.
Comment résoudre alors la question de savoir si tel individu qui travaille, qui fait partie du salariat, par exemple un cadre, touche un salaire proportionnel à la quantité de travail qu’il a fourni ? Lojkine propose alors de faire un choix entre deux grands types de convention comptable : le premier grand type comprend la « réduction par la qualification » et la « réduction par le salaire », et qui reconnaissent toutes deux que le travail complexe existe (« la réduction par le salaire » considérant que tout haut salaire, quel que soit son niveau, correspond aux quantités de travail abattues : de telle sorte que, si on est un salarié, on n’est jamais un exploiteur) ; le deuxième grand type (l’« approche homogène ») considérant au contraire que « tout écart de rémunération pour un même temps de travail est le signe d’un transfert net de travail », d’un accaparement de travail (p. 43).
Selon nous l’auteur a tout à fait raison de refuser d’accepter de façon a-critique l’idée qu’un salaire élevé (par exemple de cadres, ou de travailleurs mieux payés dans les pays impérialistes les plus développés) signifie nécessairement que le travail dépensé pendant une certaine période de temps qu’il rémunère produit nécessairement plus de valeur que le travail dépensé pendant la même période d’un travailleur moins bien payé. Autrement dit, un salaire élevé n’est pas la preuve que le travail qu’il rétribue est un travail complexe, mais probablement davantage l’indication que les capitalistes acceptent de céder, pour une raison ou pour une autre, davantage de salaire à cette catégorie, soit en raison de la présence d’un rapport de force réel, soit pour acheter la paix sociale lorsqu’ils en ont les moyens, une survaleur importante réalisée ailleurs (par exemple, par la surexploitation de la main d’œuvre délocalisée) permettant des transfert de cette survaleur vers une aristocratie ouvrière ou salariale qu’il s’agit de domestiquer. Remarquons en passant que l’auteur ne parle jamais explicitement de transfert de survaleur ni même de survaleur, mais uniquement de « transfert net de travail » ou « d’appropriation du travail d’autrui » et de « surtravail ». Ce qui peut sembler un détail terminologique n’en est pas un et découle logiquement du refus de l’auteur d’adopter la théorie de la valeur de Marx, laquelle fait du travail vivant exploité la seule source de la valeur. Nous reviendrons sur ce point en temps voulu.
Toujours est-il que la question est réglée par le recours à un choix, laissé à la discrétion de l’économiste comptable, entre deux types de convention. Il nous semble certain que ce problème ne pouvait de toute manière pas recevoir d’autre solution que conventionnelle : mais, du coup, la portée politique de cette distinction, et partant, d’une théorie de l’exploitation qui se présente sous la forme d’une comptabilité en travail, est nécessairement impactée. Car ceux que l’on classera dans le camp des exploiteurs, ceux à propos desquels le calcul aura montré qu’ils s’approprient plus de travail par leurs hauts salaires qu’ils n’y participent, auront alors tout le loisir de protester, en affirmant que la convention choisie n’est pas la bonne, qu’elle est, de l’aveu même de l’auteur, complètement arbitraire, qu’elle ne correspond pas à la réalité de ce qu’ils apportent véritablement à la société, des responsabilités qu’ils prennent, des sacrifices qu’ils ont fait pour en arriver là, du temps qu’ils ont passé assis sur les bancs des grandes écoles et qui est censé donner à leur travail une importance particulière : en bref, tout ce que ces gens revendiquent déjà les 3/4 du temps. Et ils auront raison de défendre ainsi leurs intérêts de classe, leurs intérêts bourgeois, avec toute la mauvaise foi du monde, car quelle solidité peut avoir un acte politique qui admet qu’il repose sur une simple convention ? Et l’économiste comptable ne pourra d’ailleurs pas répliquer autre chose que quelque chose comme : « c’est vrai, tout cela est une convention, puisque le propre de la comptabilité publique est précisément de reposer sur des conventions et que les jugements univoques ne l’intéresse pas ». C’est ce que reconnaît Lojkine lui-même, qui a véritablement conscience de cette limite :
« … la réponse apportée […] dépend de la convention comptable utilisée pour la réduction du travail complexe au travail simple. C’est en un sens décevant : en exprimant toutes les grandeurs en termes de temps de travail, on pouvait espérer en faire la dimension la plus nette, la plus indubitable des flux économiques, et le moyen d’en tirer la démonstration de l’anatomie sociale dichotomique du capitalisme entre employeurs et travailleurs. Ce n’est pas ce que nous avons trouvé. […] Cela n’a rien d’étonnant pour qui connaît la comptabilité publique. Son but n’est pas de produire des affirmations univoques mais d’expliciter les conventions sur lesquelles elle s’appuie et de les appliquer de manière cohérente. Le débat sur les différentes mesures peut alors devenir philosophique et politique. Dans la mesure où il ne prétend pas avoir le dernier mot, le comptable peut rendre des réponses plurielles. » (p. 51)
Bref bilan sur la « comptabilité en travail »
En proposant un tel projet de comptabilité en travail, Lojkine a montré qu’il était dans une certaine mesure possible de proposer une théorie de l’exploitation qui ne s’appuie pas sur une théorie de la valeur, et en particulier sur celle de Marx. Mais nous avons vu ce que ce résultat comportait de paradoxal, de l’avis même de son auteur. Car la comptabilité en travail est incapable d’apporter une réponse véritablement univoque sur la façon dont il faut mesurer le travail approprié représenté dans les différents revenus individuels (on a recours, comme dit Lojkine, à la « simplification radicale » qui veut que le revenu individuel rapporté à l’ensemble du revenu national désigne la portion du travail social approprié). Du point de vue de la mesure du travail réellement participé par chaque agent, la solution est encore plus ambiguë puisqu’il faut désormais choisir entre différentes conventions auxquelles il revient de statuer sur l’existence ou non du travail complexe, mais qui s’avèrent de fait incapable de déterminer exactement qui produit quelle quantité de valeur d’échange par son travail.
Notons que lorsque Lojkine pose la question de la présence d’exploiteurs parmi les salariés, la question reste relativement circonscrite dans une perspective marxiste, ou, du moins, elle peut être totalement retranscrite en des termes marxistes. La théorie de la valeur Marx considère que le travail salarié produit en général de la valeur d’échange, qu’il est un travail productif au sens de travail producteur de valeur. La question des hauts salaires est, pour ainsi dire, un débat interne à cette théorie marxiste de la valeur : au sein du travail productif, on peut distinguer des travaux qui relèvent du travail simple et certains relevant du travail complexe, ce dernier produisant plus de valeur d’échange sur une même période de temps que le travail simple ; peut-on alors dire que les hauts salaires sont nécessairement la rémunération d’un travail hautement producteur de valeur ?
Mais une difficulté redoutable se présente lorsqu’il s’agit d’examiner d’autres formes de travail qui, dans la perspective marxiste, n’étaient pas créateur de valeur d’échange : notamment les occupations ou les tâches remplies par les différentes classes de la propriété, capitalistes, rentiers, financiers, capitalistes commerciaux, etc. Car si la théorie de la valeur est rejetée, alors est nécessairement rejetée avec elle toute distinction entre travail producteur de valeur et travail qui n’en produit pas, entre ce que Marx appelle le « travail productif » et « improductif » : tout travail, toute occupation devient donc, dans le système de Lojkine, en puissance du travail producteur de valeur d’échange. S’ouvre alors la possibilité, discrète à première vue, mais que nous pensons néanmoins réelle, de réintroduire dans un tel système théorique une conception que la théorie marxiste de la valeur avait jugé inacceptable, et qu’elle avait précisément cherché à réfuter : à savoir l’idée que le capitaliste, et à travers lui, le capital, puisse être considérés comme producteurs de valeur… de façon conjointe au travail salarié.
Nous avons pourtant cité au début de notre article un extrait du début de l’ouvrage où Lojkine semblait tout à fait clair sur le statut des capitalistes : en tant que le capitaliste est un capitaliste « idéal », « il ne travaille pas lui-même », et parce qu’il touchait un revenu indépendamment de tout travail, il était automatiquement qualifié d’exploiteur (p. 23-24). Mais parce que Lojkine s’est proposé de construire sa théorie de l’exploitation indépendamment de la théorie de la valeur de Marx, il s’est nécessairement coupé de la possibilité de distinguer entre le travail producteur de valeur et celui qui n’est pas producteur de valeur. Cette question ne peut pas être résolue par l’observation, pas plus qu’elle ne peut être résolue par la comptabilité, et elle a selon nous des conséquences bien plus lourdes que celle qui consistait à distinguer entre travail simple et complexe à l’intérieur du travail productif.
Une théorie de l’exploitation sans théorie de la valeur ?
La théorie de la valeur de Marx a entre autres pour fonction de démontrer que seul le travail vivant est capable de créer de la valeur, et en particulier le travail salarié, de telle sorte que la survaleur ne peut, pour Marx, provenir que de l’exploitation du travail salarié. L’articulation entre le niveau d’abstraction du livre I et celui du livre III devait permettre de montrer que, dans une économie purement capitaliste, la somme des différents revenus de la propriété (profit, rente, intérêt) est égale au montant de la survaleur totale produite et extorquée au travail exploité, et que le taux de profit moyen est la forme métamorphosée prise par la masse totale de la survaleur dès lors qu’elle est perçue par les capitalistes et redistribuée entre eux de façon à ce que les profits individuels se réalisent au prorata des différents capitaux investis.
Après avoir rappelé un principe de John Roemer qu’il adopte (« les agents salariés fournissent plus de travail qu’ils ne peuvent s’en approprier, quels que soient leurs choix de consommation, et sont en ce sens exploité ; les agents qui en emploient d’autres fournissent moins de travail qu’ils ne s’en approprie, et sont en ce sens exploiteurs », p. 33), Lojkine fait remarquer que son idée, selon laquelle il peut exister un rapport d’exploitation entre salariés et employeurs, ne doit pas être comprise au sens marxiste originel selon lequel tout revenu de la propriété, profit compris, proviendrait du travail exploité :
« Bien sûr, si l’on s’avisait de donner une interprétation trop forte à ces résultats, en croyant par exemple y trouver la preuve que l’exploitation [du travail] est la cause, la source ou l’essence du profit, Steedman reviendrait vite nous corriger. Il noterait que le théorème marxien fondamental établit une équivalence logique dans les deux sens entre profits et surtravail, et que l’un n’est donc pas plus la cause de l’autre que réciproquement […]. On commence donc à percevoir la délimitation adéquate entre le domaine de validité de l’analyse de Marx et celui de la critique de ses adversaires : le surtravail peut valoir comme concept descriptif ou interprétatif, mais pas causal ou prédictif ; comme mise en évidence d’une dimension de la réalité économique, mais pas comme la dimension la plus réelle qui rend compte des autres. » (p. 32, nous soulignons)
Refusant la pertinence de la distinction entre les niveaux d’abstraction du livre I et du livre III, l’idée de retrouver les valeurs derrières les prix n’a pas de sens pour Lojkine, de même, par conséquent, que l’idée selon laquelle les différents revenus de la propriété, profit compris, représenterait l’ensemble de la survaleur. Parce que Lojkine juge que la théorie de Marx est irrecevable dans sa version « forte » (lorsqu’elle affirme que le travail est la seule source ou la « substance » de la valeur), il décide de s’en tenir à une version qu’il qualifie de « faible » ou de « modeste » mais il sacrifie du même coup le concept de survaleur, comme produit de valeur du seul travail vivant, et donc, en régime capitaliste, majoritairement issu du travail salarié exploité :
« Mais si la théorie prise en bloc [la théorie de l’exploitation de Marx, reposant sur sa théorie de la valeur] est condamnée, cela ne signifie pas qu’il soit impossible d’en redessiner les contours. Pour notre part, si nous avons certes placé nos pas dans ceux de Marx depuis le début de ce chapitre, c’est avec un but relativement circonscrit : non pas expliquer les salaires, les prix et les profits, mais mesurer, à titre descriptif les flux de travail entre les participants d’une économie capitaliste. Peu nous importe alors qui est premier du temps de travail incorporé ou des prix, ou qu’il y ait une disproportion entre les deux structures, tant que chacune des deux peut être mesurée. Or il existe bien une tradition dans le marxisme, ou du moins à sa marge, qui a cherché à approfondir cette interprétation modeste, faible pourrait-on dire au sens mathématique, du surtravail […]. » (p. 29-30, nous soulignons.)
Pour cette raison, on remarque que la notion de survaleur n’est jamais employée par Lojkine autrement que lorsqu’il se trouve citer Marx, puisqu’elle ne peut pas avoir le moindre sens dans sa théorie de l’exploitation à lui : à la place, Lojkine utilise toujours celui de « surtravail », cette notion désignant le fait qu’il y ait appropriation nette (la différence entre la quantité de travail approprié et participé est supérieure à 0).
Est-ce qu’un tel renoncement à la théorie marxiste de la valeur, à la notion de survaleur, à la conception selon laquelle le travail constitue le seul fondement ou la « substance » de la valeur, doit gêner sa théorie de l’exploitation ? Pour Lojkine absolument pas : comme il l’a rappelé, son objectif n’est pas d’expliquer les prix mais de décrire les répartitions potentiellement inéquitables des quantités de travail : la théorie de la valeur n’a plus chez lui de valeur explicative, elle ne cherche plus le facteur responsable de la création de la valeur, la raison de l’origine du profit, de la rente, de l’intérêt, etc., mais se contente de décrire la façon dont les différents agents s’approprient du travail, en mettant en rapport les quantités de travail qu’ils reçoivent et celles qu’ils ont « participé ». Évoquant Amartya Sen et Gerald Cohen comme représentant de cette version « faible » à laquelle il adhère, Lojkine écrit :
« … on peut tout aussi bien s’intéresser « à la théorie de la valeur travail comme une description, qui considère les activités de production en termes d’implication humaine, [de] participation personnelle » [la citation est de Sen]. Gerald Cohen, figure de proue du courant du « marxisme analytique », a renchéri : « Peu importe ce qui explique la différence entre la valeur que le travailleur produit et celle qu’il reçoit. Ce qui importe ici, c’est simplement qu’il y ait une différence. » » (p. 34-35, c’est Lojkine qui souligne.)
La théorie de la valeur de Marx est donc bien réduite à une théorie purement descriptive : les agents « participent » individuellement à la production, sans que l’on sache très bien ce que ce terme recouvre par ailleurs, et nous devons mettre en rapport cette « participation » avec ce qu’ils reçoivent en échange : s’ils perdent au change, ils sont exploités, sinon, ils sont exploiteurs.
« Déjà dans les années 1940, Oskar Lange, économiste communiste et grande figure de l’école néoclassique, défendait l’étude du temps de travail incorporé comme une « théorie sociologique de l’imputation ». Certes, on peut attribuer une part de la production à d’autres facteurs que le travail, comme la terre ou le capital, comme le faisait l’école marginaliste ; « mais pour la sociologie économique, qui s’intéresse aux relations entre les hommes, l’imputation aux agents non humains n’a pas de sens. » » (p. 35)
On pourrait opposer à Lojkine le fait que la question n’est pas de savoir si « la terre ou le capital » sont des facteurs de production au sens où ils contribuent à produire des valeurs d’usage, ce que personne ne nie, pas même les marxistes, mais de savoir s’ils sont capable de créer de la valeur d’échange, ce qui est tout à fait différent (pour les marxistes, il est clair que non, de même qu’il était tout à fait clair par exemple pour Ricardo que la terre ne créait aucune valeur d’échange). L’imputation est un terme utilisé en économie néoclassique pour désigner la productivité d’un facteur de production (la terre, le capital, le travail) : on imagine donc que l’idée d’une « théorie sociologique de l’imputation » signifie le fait que, indépendamment de la considération des facteurs de production non-humains, il s’agit de répartir le produit du travail entre les hommes, qui restent les véritables agents de l’économie, et que cette répartition doit se faire relativement à leurs productivités personnelles ou à leur niveau de « participation », pour parler comme Sen. C’est donc à cette tâche d’imputation sociologique que devrait servir la théorie de la valeur « héritée » de Marx, et transformée en outil simplement descriptif : mesurer quantitativement le travail fourni et approprié en retour par les agents.
Or, la théorie de la valeur de Marx cherchait également à répondre à un problème dont il pensait par ailleurs que Ricardo avait pressenti la solution. Si le capital n’est pas autre chose que la valeur se valorisant, quelle est la cause de cette formation d’une valeur nouvelle ? Quel est le facteur de production, parmi ceux employés par le capitaliste dans la production de sa marchandise, qui est responsable de la création nette de valeur, création nette qui se manifeste dans la valeur d’échange qui reste entre les mains du capitaliste au terme de la vente et après défalcation des avances (remboursement du capital constant employé et détruit et paiement des salaires), en bref, dans la survaleur ?
Pour nous débarrasser de la « brume fantomatique » que fait prendre aux produits du travail la forme marchande de la valeur d’échange, Marx nous conseille parfois de tourner notre regard « vers d’autres formes de production » (K. Marx, Le Capital, Livre I, Éditions Sociales, Paris, 2016, p. 78), ou du moins, vers une présentation du problème qui ne fasse pas intervenir les catégories de l’économie marchande. C’est d’ailleurs également comme ça que procède Ricardo dès l’Essai sur les bas prix du blé, afin de montrer que le profit exprimé en quantité de blé du capitaliste agricole (les intrants, les sortants ainsi que tous les revenus sont exprimées en nature, en quantité de blé, dans le Tableau de l’Essai de 1815) n’était pas autre chose que le produit du surtravail des ouvriers, de la même manière que la rente foncière, que certains prenaient pour une création de valeur nette de la terre, n’était pas autre chose que le prélèvement, par les propriétaires fonciers, d’une partie de cette quantité du surproduit constituant le surprofit des capitalistes. Et c’est également de cette façon que procède Lojkine dans son analyse de la corvée.
Et c’est en effet une chose absolument évidente, qui ne nous semble pouvoir être niée par personne : la quantité de produit qui reste entre les mains du propriétaire des moyens de production, et entre les mains des autres classes de la propriété en général, ne peut être que le produit du surtravail, c’est-à-dire le produit réalisé durant la période de temps qui excède la période de temps servant à reconstituer non seulement les avances de capital constant, mais aussi la force de travail employée (sous la forme des salaires). Qu’est-ce donc alors que la rente foncière sinon le transfert d’une partie du produit créé par le surtravail, d’abord accaparé par le capitaliste mais que le capitaliste est contraint de transférer dans les mains du propriétaire foncier ? Qu’est-ce donc que les intérêts sinon une autre partie de ce produit du surtravail que le capitaliste transfère au détenteur d’intérêt ? La rente et l’intérêt sont des revenus que le propriétaire foncier et le détenteur d’intérêt prélèvent sur le surproduit initial du capitaliste, car il est clair que l’on ne peut s’approprier une partie de quelque chose que s’il y a d’abord quelque chose à s’approprier. Ce que le propriétaire foncier et le détenteur d’intérêt s’approprient, c’est donc une partie du surproduit du capitaliste, surproduit issu lui-même du surtravail des ouvriers que ce capitaliste exploite.
Et si, désormais, comme le dit Marx, les valeurs sont les quantités de travail social incorporées dans les produits échangés et que les valeurs d’échange, c’est-à-dire les rapports d’échange dans lesquels se trouvent s’échanger ces produits, ne sont que la manière dont se répartit effectivement ce travail social, pourquoi ne pas reconnaître, si par exemple on suppose que les capitalistes n’échangent entre eux que les quantités de produit issus du surtravail (c’est ce qu’il se passerait s’ils échangeaient uniquement la production excédentaire, après avoir consacré le reste à l’amortissement et au paiement des salaires), que ces rapports d’échange ne sont que la répartition du surtravail, le surtravail issu de l’exploitation de toute la classe des prolétaires salariés, et qui se fait au moyen des prix dans la société capitaliste ? Dans ce cas il faudrait dire que la survaleur est la base sur laquelle se prélèvent l’intégralité des revenus des différents capitalistes : que l’extraction de la survaleur est la condition de possibilité de l’ensemble de ces revenus de la propriété (profit capitaliste, rente foncière, intérêt).
Mais puisque Lojkine rejette la théorie de la valeur de Marx dans sa version « forte » ou « explicative », de même que la question de l’origine de la survaleur, c’est quelque chose qu’il ne peut pas dire : son analyse de l’exploitation consiste à partir de la constatation des prix, des différents revenus, du fait qu’il existe du profit industriel et commercial, de la rente, de l’intérêt, etc., sans chercher à les expliquer. Par conséquent, le rejet de la notion même de survaleur (l’idée que toute valeur nouvelle ne peut être créée que par l’exploitation du travail non payé, principalement, dans le capitalisme, le travail salarié) ne peut conduire Lojkine qu’à refuser la distinction marxiste entre sphère de la production, comme « lieu » de production de la valeur, et sphère de la circulation, comme « lieu » où les valeurs se contentent de circuler, sans que la circulation elle-même soit capable d’en créer. On lit en effet, au chapitre 3
« … Marx va plus loin [concernant la spécificité du rapport salarial] : il affirme un primat de l’exploitation salariale au sens où toutes les autres formes d’exploitation capitaliste ne pourraient être comprises qu’à partir de celles-ci, par rapport à laquelle elles seraient dérivées ou secondaires. » (p. 161)
Et dans le chapitre 4 :
« … une thèse qui structure l’ensemble du Capital : le primat de la sphère de la production immédiate – celle du salariat donc – sur la sphère de la circulation – celle des échanges. […] Mais ce sont précisément cette dichotomie et ce primat que le chapitre précédent nous a conduit à écarter, en montrant au contraire que l’exploitation se nichait aussi bien dans les rapports commerciaux que salariaux, et que ceux-ci entretenaient entre eux des rapports d’interaction et d’interdépendance réciproque sans qu’il soit possible d’établir une hiérarchie. L’exploitation capitaliste ne peut donc pas être reconduite à la sphère de la production immédiate. Elle se déploie irrémédiablement à plusieurs échelles. » (p. 191-192)
Ou encore :
« Telle est donc l’inflexion que nous proposons par rapport à la théorie marxiste du capitalisme : mettre de côté le primat de la production immédiate sur la circulation dans la détermination des rapports d’exploitation […]. » (p. 193-194)
Marx affirme le primat de la production sur la circulation parce que la production est, par définition, le moment où sont produites les différentes valeurs d’usage socialement utiles, où les quantités de travail, qui deviendront du fait de l’échange du travail socialement utile, sont dépensées. La sphère de la circulation est le moment où les valeurs d’usage s’échangent entre elles selon certaines proportions et où, partant, les quantités de travail qu’elles représentent, c’est-à-dire leurs valeurs, sont réparties entre les différents échangistes de manière forcément inéquitable (puisque les marchandises ne s’échangent pas, dans la réalité, en proportion de leurs valeurs, selon les quantités de travail que leur production a socialement nécessité, mais toujours en-dessous ou au-dessus). Il en ressort que la valeur globale, ou somme des valeurs d’échange, ne peut être créée que dans la sphère de la production : ce fait constitue la pierre angulaire de la théorie marxiste de l’exploitation, qui fait de la force de travail la seule valeur d’usage capable de créer de la valeur. Le problème de Marx, ici, est donc de déterminer l’origine de la survaleur, qui ne peut logiquement naître que dans la production, à partir de l’exploitation capitaliste de la force de travail : c’est pourquoi le rapport d’exploitation privilégié de la force de travail (le rapport salarial en régime capitaliste) peut être qualifié de rapport d’exploitation fondamental, duquel découle logiquement l’ensemble des revenus de la propriété.
Le problème de Lojkine est, par contre, tout à fait différent. Lojkine cherche à distinguer entre exploiteurs et exploités et on a vu qu’il définissait, au début de l’ouvrage, l’exploitation comme l’appropriation, via un revenu, d’une quantité de travail incorporée supérieure à la quantité de travail participé, dépensé par l’individu, ce qui sous-entendait qu’un individu qui ne travaillait pas – par exemple un capitaliste – et qui s’appropriait pourtant un revenu ne pouvait être qu’un exploiteur. C’est ce que Lojkine disait textuellement : « En particulier, un capitaliste « idéal » – détenteur des moyens de production qui ne travaille pas lui-même – touche un profit monétaire qui lui confère un pouvoir d’achat et donc d’appropriation du travail d’autrui. C’est un exploiteur. » (p. 23-24, nous soulignons).
Mais dans sa volonté de prouver que l’exploitation peut avoir lieu à l’intérieur de la sphère de la circulation, Lojkine est amené à introduire une autre définition de l’exploitation. Pour Lojkine, il semble qu’il pourrait désormais y avoir exploitation, non lorsque la quantité de travail fourni, participé en propre directement, est inférieure à celle reçu via le revenu mais lorsque la quantité de travail incorporé cédée dans l’échange (qu’elle soit représentée par une masse de marchandise ou par un transfert net de valeur d’échange, d’argent) est inférieure à celle qui est reçue, ce qui est une chose tout à fait différente. En bref, il y aurait désormais « exploitation » dans tous les cas d’échange inégal, ou même dans sa version la plus radicale : lorsqu’il n’y a pas échange direct de marchandises mais simple transfert (de valeurs d’usage ou de valeurs d’échange, peu importe). Il ne lui reste alors plus qu’à montrer qu’il y a de l’échange inégal ailleurs que dans le rapport salarial où la force de travail s’échange contre un salaire pour qualifier tout échange inégal de « rapport d’exploitation », et donc, pour montrer qu’il y aurait « exploitation » même dans la sphère de la circulation.
Mais il est clair que les deux cas n’ont rien à voir entre eux. Auparavant, on comparait la quantité de travail participé, la quantité de travail fourni, avec la quantité de travail incorporé reçue ; désormais, on compare les quantités de travail échangées, de sorte que l’on peut dire qu’il y a « exploitation » dès lors qu’il y a échange inégal, et en particulier lorsqu’il y a transfert de valeur d’échange, transfert de quantité de travail, d’une entreprise à l’autre, d’un capitaliste à l’autre. Auparavant, les capitalistes, qui, en tant que capitalistes, ne travaillent pas directement, étaient considérés comme des exploiteurs en vertu de la première définition de l’exploitation (est exploité celui qui travaille plus qu’il ne reçoit et inversement), désormais, les capitalistes peuvent eux-même être exploités dès lors qu’ils sont contraints de transférer, vers d’autres capitalistes, une partie du produit qu’ils ont eux-même accaparé à leurs travailleurs.
« Les différentes firmes d’un même secteur ou de secteurs différents sont en fait souvent en relation les unes avec les autres par des transactions commerciales, voire des formes mixtes d’intégration, comme la franchise. Dès lors, la réallocation de la valeur entre firmes constatée par ces études peut aussi s’expliquer par la prise de pouvoir croissante de certaines entreprises sur les autres entreprises, et par le transfert de valeur de l’une à l’autre » (p. 136, nous soulignons.)
« … on peut reconstituer, à titre d’hypothèse plausible, le mécanisme suivant : de plus en plus de firmes de grande taille et à profits importants ont externalisé de manière croissante certaines activités et tâche à des firmes sous-traitantes en position dominée, où les salaires mais aussi les profits sont faibles. Cela expliquerait le fait, observé un peu partout, de la concentration croissante des profits dans certaines firmes, mais aurait aussi une incidence cruciale sur la théorie de l’exploitation : de manière croissante, l’exploitation n’aurait plus lieu dans les entreprises, mais entre entreprises. » (p. 137, nous soulignons.)
Les « entreprises », les « firmes » désignent ici nécessairement les capitalistes : qu’il y ait transfert de valeur d’une entreprise à une autre ne signifient ici rien d’autre que certains capitalistes sont contraints de céder l’ensemble des valeurs d’usage produites par leurs ouvriers à l’entreprise donneuse d’ordre, en échange d’une très faible participation au profit de cette dernière (dans le cas des sous-traitants industriels), ou même de reverser une partie de leurs profits réalisées à d’autres (dans le cas des entreprises franchisées). Dans ce dernier cas :
« … l’exploitation rentière et l’exploitation commerciale sont souvent indistinguables dans ces cas. Ainsi, le rapport de franchise qui nous a déjà occupés à propos du capital commercial implique très souvent une propriété intellectuelle : le franchisé paye pour le droit d’utiliser la marque, l’identité visuelle en particulier, du franchiseur. » (p. 152, nous soulignons.)
Mais Lojkine avait reconnu auparavant que les capitalistes étaient nécessairement des exploiteurs. Que peut donc signifier le fait qu’il y ait exploitation d’un exploiteur ? Peut-il seulement y avoir « exploitation » d’un exploiteur par un autre exploiteur ? Si tout ce que le capitaliste reçoit provient de l’exploitation, est-ce que le fait qu’il soit contraint signifie que cet exploiteur soit à son tour exploité ?
Dans un passage du chapitre 3, Lojkine examine la question des rapports commerciaux et du profit commercial : puisqu’il existe des profits commerciaux, il existerait selon lui de l’appropriation de surtravail, de l’« exploitation », même dans la sphère de la circulation, contrairement à ce que soutient Marx.
« Dans un premier temps, dans le livre I du Capital, ce primat [de la production sur la circulation] est défendu de la manière suivante. La prémisse du raisonnement est l’idée défendue dans la première section, selon laquelle le rapport d’échange entre deux marchandises correspond au rapport entre les temps de travail qu’elles incorporent. Dès lors, comment expliquer le surtravail – l’appropriation par certain du travail d’autrui ? Pas par l’échange commercial, car, dans un tel échange, « la même valeur, c’est-à-dire le même quantum de travail social objectivé, reste entre les mains du même possesseur de marchandises sous la figure concrète de sa marchandise d’abord, puis de la monnaie en laquelle elle se convertit, et finalement de la marchandise dans laquelle cette monnaie se convertit. » Par conséquent, quel qu’ait été leur rôle historique, ni l’accumulation commerciale ni l’accumulation financière ne peuvent être considérées comme des formes pures d’exploitation capitaliste, elles ne peuvent être comprises que comme des « formes dérivées ». […] Or le point de départ de cette déduction pose problème. Les échanges commerciaux ne sont pas, pas même en moyenne, et à long terme, des échanges de temps de travail équivalents, comme nous l’avons vu dans notre premier chapitre et comme Marx le reconnaît lui-même dans le livre III et déjà par allusion dans le livre I, sans en tirer justement toutes les conséquences pour la théorie de l’exploitation. » (p. 161)
Notons qu’au sens strict, dans le livre I, Marx ne cherche pas à expliquer l’existence du surtravail au sens que lui donne Lojkine, à savoir « appropriation du travail d’autrui », échange inégal. Marx cherche à y expliquer l’origine de la survaleur, production d’une valeur nouvelle. Dans l’hypothèse du livre I, où Marx suppose que les marchandises s’échangent en fonction des quantités de travail qu’elles incorporent, il en découle par définition que l’échange commercial ne peut donner lieu à aucune « appropriation du travail d’autrui », à aucun « surtravail » si on lui donne l’acception choisie par Lojkine.
Mais ça ne veut pas dire évidemment qu’il ne puisse pas y avoir, du fait de l’échange, de profit commercial, d’appropriation par l’échange d’une quantité de travail social plus grande que celle qui est incorporée dans la marchandise cédée, en somme, d’échange inégal, dès lors que l’hypothèse des rapports d’échange selon les quantités de travail du livre I se trouve levée. Il y a alors bien échange inégal, appropriation de quantités de travail plus importantes par un capital commercial au détriment d’un autre sans qu’il y ait exploitation de l’un par l’autre, parce que cette simple répartition des valeurs ne fait intervenir aucune production de valeur nouvelle, aucune production de survaleur par exploitation du travail vivant. De toute façon, et comme nous l’avons dit, dans le mode production capitaliste, l’échange se fait nécessairement de manière inégalitaire : on échange des marchandises entre elles alors que les quantités de travail qu’elles incorporent ne sont pas égales, ce fait s’expliquant par la manière particulière qu’a le travail social de se représenter et de se répartir en régime marchand.
Mais puisque, selon la conception de Lojkine, le rapport d’exploitation « se nich[e] aussi bien dans les rapports commerciaux que salariaux », de telle sorte qu’il n’est « [pas] possible d’établir une hiérarchie » entre « sphère de la production immédiate » (de l’exploitation du travail) et « sphère de la circulation » (p. 192), cela signifie très concrètement mettre sur le même plan l’exploitation du travail par le capital et la prétendue « exploitation » des capitalistes entre eux par l’échange inégal. Parce que la question de l’origine de la survaleur est mise entre parenthèses, chaque agent est susceptible d’être également exploité par tout autre : les capitalistes commerciaux peuvent s’exploiter entre eux, le capital commercial peut « exploiter » le capital industriel, le propriétaire foncier peut « exploiter » le capitaliste agricole, etc. À notre connaissance, Ricardo, qui considérait la classe des propriétaires fonciers comme une classe intrinsèquement parasitaire parce qu’elle tirait son revenu d’une ponction sur le profit des capitalistes ne va jamais jusqu’à considérer que les propriétaires fonciers « exploitent » les capitalistes, sous le prétexte qu’ils se « servent » sur leurs profits.
Une telle conception, qui considère que l’« exploitation » se produit même dans la circulation et qui qualifie les rapports entre capitalistes (c’est-à-dire entre exploiteurs) de rapports d’« exploitation » ne peut, à notre avis, que conduire à brouiller l’antagonisme de classe entre travail exploité (le prolétariat) et les classes de la propriété qui ne font jamais que vivre du produit de ce surtravail, de la survaleur, et qui ne font que se partager cette survaleur entre eux. Certaines fractions s’accaparent évidemment la part du lion au détriment des autres (c’est la loi même la concurrence capitaliste), mais les exploiteurs ne sauraient s’exploiter entre eux : pour les marxistes, il n’y a, au sens strict, d’exploitation économique que celle de la force de travail par extraction de survaleur[3].
Le statut des petits capitalistes
L’affirmation selon laquelle le rapport d’exploitation salarial n’a pas de prééminence ou de primauté logique sur les autres rapports d’exploitation dans la circulation (« exploitation » des firmes entre elles, « exploitation rentière », « exploitation commerciale », etc.), de même que l’idée selon laquelle la sphère de la production ne serait pas le lieu de production d’une « survaleur » que la sphère de la circulation aurait ensuite à redistribuer conduit à notre avis Lojkine à entretenir une certaine ambiguïté sur le statut des capitalistes et sur la nature des revenus de la propriété en général. Au début de son texte, Lojkine affirme bien que les capitalistes, de même que les rentiers, ne peuvent être que des exploiteurs. Nous allons voir comment cette conception est pourtant remise en question à la fin du chapitre 1, dès lors qu’il s’agit de traiter des petits capitalistes.
« Supposons une économie purement capitaliste (on fait abstraction de toute institution de redistribution ou de socialisation) dont les participant travaillent tous le même nombre d’heures chaque année. Supposons un revenu par tête, ou productivité monétaire par tête, de 100 000 euros par an, réparti entre deux tiers de rémunération salariale et un tiers de revenus tirés de la propriété (profits, intérêts, loyers). Ces revenus sont répartis de manière hétérogène entre les agents individuels. » (p. 47)
Rappelons que dans la théorie de la valeur de Marx, les revenus de la propriété sont essentiellement prélevés sur la survaleur totale produite, qui ne peut être créée qu’à partir de l’exploitation du travail non payé des prolétaires. Nous faisons ici abstraction des revenus de la propriété qui ne seraient pas prélevés sur la survaleur : ce serait par exemple le cas d’un prolétaire qui toucherait une partie de son revenu sous forme de rente locative, en faisant payer un loyer à un autre prolétaire (dans ce cas là, la partie de la valeur d’échange qui revient au prolétaire-propriétaire comme rente est prélevée sur le salaire de l’autre prolétaire, et nullement sur une quelconque survaleur produite). Pour simplifier, nous supposerons donc ici que les revenus de la propriété dont il est question consistent uniquement en profits, ce qui n’est nullement une déformation de l’exposé de Lojkine puisqu’il reconnaît lui-même que les profits font partie des « revenus tirés de la propriété » dont il parle (« profits, intérêts, loyers », p. 46). Dans la conception marxiste, on peut donc dire que celui qui possède une portion, même infime, de son revenu sous forme de profit est un exploiteur, le profit étant lui-même une forme prise par la survaleur, qui est la représentation en valeur d’échange du travail non payé et exploité.
Revenons donc à la représentation simplifiée de l’économie que propose Lojkine. Nous sommes dans une économie où – c’est la supposition – tous « les participant travaillent tous le même nombre d’heures chaque année ». Chaque individu produit donc de la valeur d’échange à la hauteur de 100 000 euros par an (c’est la « productivité monétaire par tête »), il est donc possible de dire que le revenu par tête, comme simple moyenne, est de 100 000 euros par an. Le revenu national total est composé, nous dit l’auteur, pour les 2/3 de rémunérations salariales et, pour le 1/3 restant, des « revenus tirés de la propriété », ici donc de profits dans notre simplification. Lojkine nous indique également que ces revenus sont répartis de « manière hétérogènes entre les agents individuels », ce qui veut dire que, le revenu par tête étant simplement une moyenne (à la différence de la productivité monétaire, qui est une réalité supposée par le modèle), certains agents peuvent toucher plus ou moins de 100 000 euros par an (quoique, nous l’avons dit, et c’est l’hypothèse, tous « travaillent » et participent à la production de valeur d’échange à hauteur de 100 000 euros par an).
Par ailleurs, il se peut également que la portion de la répartition de la part du revenu national composé de 2/3 de salaire et de 1/3 de profit varie d’un individu à l’autre: on peut donc trouver des individus qui touchent un revenu par an inférieur ou supérieur à 100 000 euros, et dont le revenu est composé, pour certain, de 1/3 de salaires et de 2/3 de profits (ce qui serait le cas pour des petits capitalistes qui travailleraient partiellement comme « salariés » aux côtés des salariés qu’ils emploient, voire même dans une autre entreprise), des prolétaires « purs » dont le revenu consiste intégralement en salaires, des capitalistes « purs » dont le revenu consiste intégralement en profit, etc.
Notons au demeurant que la présence des revenus de la propriété – du profit – à la hauteur de 1/3 du revenu national n’est pas expliquée mais simplement supposée, de la même façon que la productivité monétaire par tête est fixée à 100 000 euros. Pour cette raison, et de façon encore plus surprenante encore pour des marxistes, la présence de tels revenus de la propriété, de profits, dans cette économie n’est pas non plus, selon Lojkine, un indice particulier du fait que nous serions dans une économie nécessairement composée d’exploiteurs. Pour la conception marxiste, nous l’avons dit, le fait qu’il existe une portion, même infime, du revenu national consistant en profit est la marque évidente que nous sommes nécessairement dans une économie où sont présents des exploiteurs, le profit étant la forme prise par le produit du surtravail lorsqu’il est exprimée comme la valeur d’échange qui reste au capitaliste.
Dans ce passage, Lojkine cherche à répondre à la question, relativement secondaire par rapport au sujet de notre critique, de la distinction entre exploiteurs et exploités selon que l’on utilise la convention de « réduction selon la qualification/réduction selon le salaire » (on admet qu’il existe du travail complexe, que le travail complexe doit être davantage rémunéré que le travail simple) ou la convention selon « l’approche homogène » (il n’existe que du travail simple, tout écart de salaire est du travail approprié excédentaire, accaparement de surtravail).
Le premier moment examiné est l’analyse qui accepte la justification concernant l’existence du travail complexe méritant de hautes rémunérations : s’il y a des hauts salaires, supérieurs à 100 000 euros par mois, c’est parce que ces hauts salaires viennent rémunérer un travail particulièrement complexe, qui produit, sur la même période travaillée que tous les autres agents, en réalité davantage que 100 000 euros par mois. De cette façon, personne parmi ceux qui ont une rémunération uniquement composée de salaires ne peut être taxé d’exploiteur, chaque salarié étant rémunéré à la hauteur de ce qu’il contribue (à l’inverse, si l’on adopte la convention selon l’« approche homogène », il y a des exploiteurs, des bénéficiaires nets de surtravail, même parmi les salariés). Compte tenu des prémisses, cela est tout à fait logique et l’on comprend que, dans ce cas, les exploiteurs, les appropriateurs nets de surtravail, ne peuvent par conséquent se retrouver que du côté de ceux qui vivent des revenus de la propriété. Doit-on alors considérer que tous ceux qui touchent des revenus de la propriété (ici : du profit) sont des exploiteurs ? Lojkine écrit :
« Un agent s’appropriera alors du surtravail si la part des revenus tirés de la propriété dans son revenu est supérieur à un tiers, leur part dans l’ensemble de l’économie. Au contraire, il sera en déficit de travail, et donc exploité, si ses revenus de la propriété représentent dans son revenu une proportion inférieure à un tiers. » (p. 47)
Ainsi donc, parmi les classes dont le revenu est composé pour une part de revenus de la propriété (dans notre hypothèse, exclusivement de profits) ne sont des exploiteurs qu’à condition que cette part de profit excède 1/3 de leur revenu, soit la part du revenu national consistant en profits. Un petit patron qui travaillerait aux côtés de ses salariés dans son entreprise ou même dans une autre et qui toucherait, en tant qu’il est travailleur, 2/3 de son revenu en salaire et le 1/3 restant en profit ne serait donc pas un exploiteur, son profit ne lui viendrait pas du produit de valeur du surtravail de ses ouvriers, c’est-à-dire de la survaleur extraite sur le dos du travail non payé et exploité de ses propres ouvriers.
On pourrait dire par ailleurs la même chose de celui qui vit d’intérêts et de dividendes : quand bien même, pour les marxistes, les intérêts de ce genre sont puisés dans la masse de la survaleur totale, comme prélèvement sur les profits d’un ou de plusieurs capitalistes, et représentent bien un revenu nécessairement tiré de l’exploitation, dans la conception de Lojkine, si ce revenu financier prélevé sur les profits ne dépasse pas 1/3 du revenu de celui qui le perçoit alors celui-ci n’est pas un exploiteur, indépendamment de la question de savoir d’où provient l’intérêt, en tant que revenu considéré en lui-même. Cela entre par ailleurs en contradiction avec ce que dit Lojkine plus loin, dans le chapitre 3 à propos du crédit ou de l’intérêt, lorsqu’il déclare que « le versement d’intérêts ou de dividendes constitue un flux de valeur et donc de travail vers des agents qui ont fourni des fonds mais pas de travail » (p. 141, nous soulignons). Comment est-il possible ici d’avoir l’existence d’un crédit perçu sans qu’il y ait pour autant exploitation, l’intérêt ne venant, par définition, et comme le reconnaît justement Lojkine, rémunérer aucun travail productif mais une simple avance de fonds ?
L’approche comptable place hors de ses prérogatives la question de savoir d’où provient le profit, par contre, elle considère totalement comme l’une de ses prérogatives de montrer que les petits capitalistes ne sauraient être considérés comme des exploiteurs dès lors que la part de leurs revenus en profit n’excède pas un certain seuil. La conception marxiste considère l’exploitation comme une relation sociale globale : il y a exploitation s’il y a appropriation de surtravail, sous la forme de revenus de la propriété et de profit notamment, indépendamment de la question de savoir quelle est la proportion de cette appropriation ; l’approche comptable proposée par Lojkine, parce qu’elle rejette la notion même de survaleur comme source de l’essentiel des revenus de la propriété, considère qu’il n’y a exploitation qu’à partir d’une considération statistique regardant la part relative des différents revenus de la propriété (profit compris) dans les revenus individuels et rapporté à la part relative qu’ils occupent dans le revenu national.
Voyons maintenant ce qu’il en est de la distinction entre exploitation et non-exploitation selon l’« approche homogène » (nous avons vu que c’était cette approche qui avait de fait la préférence de l’auteur), qui considère que des appropriateurs nets de surtravail, des exploiteurs, peuvent se trouver parmi les salariés :
« Supposons maintenant que nous adoptions l’approche homogène, qui compte toutes les heures de travail également. Le diagnostic de surtravail est alors différent. Tous les agents contribuent également au travail social ; les exploiteurs sont ceux qui s’approprient plus que la moyenne, c’est-à-dire dont le revenu individuel, quelle que soit sa composition entre salaire et revenu de la propriété, est supérieur au revenu moyen – 100 000 euros par an selon nos hypothèses. Le critère de la délimitation ne s’exprime plus en termes de poids des revenus de la propriété dans la rémunération, mais en termes de revenu total. » (p. 47, nous soulignons.)
Ici encore, en ce qui concerne la différence avec l’approche précédente, la conclusion est tout à fait rigoureuse : « tous les agents contribuent également au travail social », ils travaillent durant un même nombre d’heure et il n’existe pas de travail complexe, par conséquent, tous les salariés purs qui reçoivent en salaire davantage de 100 000 euros s’approprient du surtravail puisque « tous contribuant également au travail social », on sait que la « productivité monétaire par tête » est de 100 000 euros. Mais là n’est pas l’essentiel pour nous, et tournons donc notre regard vers la seule véritable question qui nous importe vraiment : comment distinguer entre exploiteurs et exploités selon cette nouvelle hypothèse ?
La réponse est dans la première définition qu’avait donné Lojkine de l’exploitation : est un exploiteur celui qui s’approprie, par son revenu, une quantité de travail supérieure à celle qu’il a fourni lui-même en propre à la société. Or, non seulement Lojkine a présupposé que «tous les agents contribuent également au travail social », que « les participants travaillent tous le même nombre d’heures chaque année », mais encore que la « productivité monétaire par tête [est] de 100 000 euros par an ». Or, que veut dire « productivité monétaire par tête » sinon le fait que tous les participants, indépendamment de la classe à laquelle ils appartiennent, indépendamment de leur place dans le procès de production et de circulation, etc., produisent tous de la valeur d’échange, à hauteur de 100 000 euros par an ? Dès lors, celui qui a « contribué également au travail social », côte à côte avec les autres, celui qui a par conséquent produit 100 000 euros de valeur d’échange mérite bien de recevoir en retour ses 100 000 euros de valeur d’échange et ce « quelle que soit sa composition entre salaire et revenu de la propriété », comme le dit Lojkine, pourvu que son revenu ne dépasse pas les 100 000 euros de valeur d’échange qu’il a fourni.
Pour citer encore une fois Lojkine, désormais, « le critère de la délimitation ne s’exprime plus en termes de poids des revenus de la propriété dans la rémunération, mais en termes de revenu total »: celui qui a contribué à l’ensemble du travail social à la hauteur de 100 000 euros de valeur d’échange (et par hypothèse, ils y ont tous contribué) doit recevoir 100 000 euros en revenu, il est un exploiteur s’il reçoit plus et il est un exploité s’il reçoit moins, « quelle que soit sa composition entre salaire et revenu de la propriété »,c’est-à-dire quelle que soit la nature de son revenu et de sa provenance.
Ainsi donc, un individu qui serait un capitaliste à cent pour cent, un capitaliste « pur » et qui tirerait l’intégralité de son revenu de ses profits serait, selon Lojkine, un exploité si son revenu (consistant en profits !) était inférieur à 100 000 euros par an, et il mériterait par contre bien son profit, et ne devrait par conséquent pas être considéré injustement par ses prolétaires comme un exploiteur, si ses profits valaient 100 000 euros, soit l’équivalent de ce que ce capitaliste « participe » au « travail social » !
Mais que tous les agents de cette économie produisent de la valeur, c’est ce qu’il faudrait précisément démontrer. Le capitaliste qui « travaille » toutes ses heures par an produit-il de la valeur pour Lojkine ? Visiblement oui… puisqu’il travaille ! Ce capitaliste a travaillé pendant tant d’heures, soit une durée identique aux heures travaillées des ouvriers qu’il emploie – ou plutôt, il nous dit qu’il a travaillé, puisque c’est ce qu’il est écrit sur son emploi du temps, c’est même ce que dit la statistique officielle. Et que pouvait donc faire notre brave homme durant tout ce temps, sinon produire de la valeur d’échange, en somme, participer au travail social, comme n’importe quel travailleur ? Car il est clair que l’approche comptable, en tant que telle, ne peut pas suffire pour déterminer quel travail déclaré fait partie ou ne fait pas partie du travail social, ou, ce qui est la même chose, pour définir ce qui est ou n’est pas du travail productif ou improductif. Marx raillait déjà en son temps les économistes qui prenaient les justifications des capitalistes pour la réalité :
« Notre ami, si puant à l’instant de prétention capitaliste, prend soudain l’attitude modeste de son propre travailleur : ne travaille-t-il pas lui-même [le capitaliste] ? Est-ce que la direction, la surveillance du fileur, ça n’est pas aussi du travail ? Ce travail qu’il accomplit ne crée-t-il pas lui aussi de la valeur ? En attendant le capitaliste parler ainsi, son surveillant et son manager haussent les épaules. Mais déjà le capitaliste, avec un large sourire, a repris sa physionomie antérieure. Toute cette litanie n’était qu’une mauvaise plaisanterie. Il n’y a pas cru lui-même une seconde. Il abandonne tous les faux-fuyant véreux et toutes les formules creuses de ce genre aux professeurs d’économie politique payés pour ça. Il est, lui, un homme pratique : en dehors des affaires il ne réfléchit sans doute pas toujours à ce qu’il dit, mais en affaires il sait toujours ce qu’il fait. » (Karl Marx, Le Capital, I, op. cit., p. 189)
Les questions auxquelles la théorie de la valeur a précisément pour objectif de répondre (entre autres : « quel travail est du travail « productif », au sens de travail producteur de valeur d’échange, comment marquer la différence entre travail productif et improductif ? ») sont résolues discrètement au moyen de simples hypothèses qui ne sont pas interrogées par Lojkine : « supposons [une] productivité monétaire par tête […] de 100 000 euros », « tous les agents contribuent également au travail social ». Mais que veut dire produire de la valeur d’échange ? Que veut dire participer au travail social ? Qu’est-ce que le travail social ? Peut-on seulement le définir indépendamment de toute référence à une théorie de la valeur ?
Encore une fois : dire que tous les participants d’une telle économie, même les capitalistes « purs », même les rentiers « purs », même ceux qui vivent « purement » de dividendes produisent de la valeur d’échange lorsqu’ils « travaillent », c’est ce qu’il conviendrait précisément de démontrer. Tous les capitalistes diront que gérer une affaire, réfléchir à la gestion des différents processus de travail, à l’acheminement des marchandises, trouver des débouchés, des clients, des nouveaux marchés, etc., c’est bien évidemment du « travail », mais là n’est pas la question, la question étant de savoir si ce type de travail est du travail producteur de valeur. C’est cela qu’il faut interroger, c’est à ce problème qu’il faut répondre. Cela est aussi du travail d’être propriétaire, par exemple propriétaire de logements locatifs, de devoir gérer des appartements, de devoir contacter des artisans, de devoir gérer le contact et les éventuels conflits avec le locataire, etc., mais tous ces gens ne font-il pas autre chose que de capter la valeur d’échange reçue par d’autres sous la forme de salaires (si les locataires sont des prolétaires purs), ou de la survaleur qui s’était d’abord présentée sous forme de profits ou d’intérêt (si les locataires sont des capitalistes purs) ?
Il est clair que pour les marxistes, les capitalistes, en tant qu’ils font du travail de capitalistes, ne peuvent pas créer de valeur, ne produisent pas de valeur d’échange : le capitaliste participe-t-il autrement au procès de travail qu’en investissant un certain nombre de machines qui contribuent à faire baisser le temps de travail socialement nécessaire mais qui, dans tous les cas, doivent à la fin être amorties et remboursées, et qui ne produisent par conséquent aucune valeur nouvelle ? Évidemment non, alors pourquoi dire qu’un capitaliste « pur », dont le revenu serait composé uniquement de profit, produit personnellement de la valeur d’échange à hauteur de 100 000 euros, qu’il n’est pas un exploiteur dans certaines conditions et qu’il pourrait même être un exploité (exploité par qui, d’ailleurs ?) si son affaire ne lui ramène pas au moins 100 000 euros par an ?
Et il est clair que cette hypothèse a des conséquences pratiques et politiques directes, puisqu’elle contribue à faire admettre dans le camp des exploités des gens qui n’ont vraisemblablement rien à y faire. Si la révolution communiste veut dire quelque chose, si la notion même de dictature du prolétariat a un sens, il est clair qu’elles ne signifient pas autre chose qu’exercice de l’oppression contre la classe des exploiteurs dans son ensemble, par le fait de priver les capitalistes, petits ou gros, de tous leurs droits politiques et civiques, par exemple, pour la seule et unique raison qu’ils sont des exploiteurs et que, vivant de l’exploitation des autres, ils ont comme intérêt objectif la restauration des rapports capitalistes[4]. Que devra-t-il arriver à ce moment-là ? Faudra-t-il épargner toute la masse des petits patrons, qui sont du reste souvent les pires des exploiteurs, et les accueillir parmi la nouvelle classe dirigeante prolétarienne sous prétexte que leur profit est inférieur ou égal au revenu moyen ? Échapperont-ils à la privation de leurs droits à exploiter sous prétexte qu’ils parviendront à brandir leurs emplois du temps qui indiqueront qu’ils ont bien travaillé l’équivalent en temps de 100 000 euros par an et que leurs 100 000 euros par an de profits sont par conséquent convenablement gagnés et mérités ?
Mais comme nous n’avons ici aucune théorie de la valeur, ce à quoi cette théorie devait précisément répondre (qu’est-ce que le travail productif, le capital produit-il, comme capital, de la valeur d’échange ?) se trouve implicitement réintroduit au moyen d’une simple hypothèse : oui le capitaliste produit de la valeur d’échange, puisque le capitaliste travaille et qu’il peut donc y avoir profit sans exploitation. Et c’est ainsi qu’au moyen de cette simple hypothèse, toute une flopée de petits exploiteurs, qui ne vivent qu’au moyen de l’exploitation du travail des autres, de la vente et de la redistribution du surproduit produit par d’autres, se retrouvent mis du côté des exploités, du côté du prolétariat exploité. À quoi aboutit donc nécessairement une comptabilité qui ne se pose pas la question de la nature et de la provenance des revenus de la propriété sinon à l’effacement de l’antagonisme de classe, au profit d’une distinction ne se faisant qu’à partir de simples différences de revenus ?
Petits patrons et exploiteurs en chefs
L’indulgence à laquelle Lojkine parvient en ce qui concerne les petits capitalistes, son idée qu’ils pourraient être des exploités indépendamment du simple fait qu’ils touchent un profit, se retrouve notamment selon nous dans un passage du chapitre 3, consacré aux « Échelles de l’exploitation ». Lojkine y décrit la situation d’un petit capitaliste marocain du textile, un certain Boullaili, qui assure la sous-traitance industrielle pour une autre usine marocaine du textile, Larinor, qui produit elle-même pour des grands groupes capitalistes européens donneurs d’ordre, et en particulier Zara.
« Le 8 février 2021, vingt-huit ouvriers, majoritairement des ouvrières, mouraient dans un atelier de confection textile à Tanger, au Maroc. L’atelier était installé dans un sous-sol, et quand des pluies torrentielles s’abattirent sur la ville, elles se retrouvèrent englouties, sans autre issue qu’un unique étroit escalier. Ni l’aménagement d’un sous-sol à cet endroit inondable, ni son usage comme atelier n’avaient été administrativement autorisés. Le propriétaire de l’atelier, Adil Boullaili, fût arrêté. Il semble donc clair que c’est lui, le capitaliste, qui était responsable de la mort des ouvrières. Mais les choses se compliquent si l’on se demande dans quels rapports économiques était pris à son tour ce capitaliste. Adil Boullaili avait d’abord été ouvrier, puis contremaître, dans une usine textile du groupe Larinor […]. L’usine de Larinor sous-traite à son tour la production de marques européennes, et en particulier de Zara. Les usines sont soumises à des audits de la part des marques européennes pour vérifier les conditions de travail des ouvrières. Mais en même temps, la multinationale continue à les mettre en concurrence entre elles et avec des usines dans d’autres pays. Pour faire face à cette pression, les usines de la zone industrielle encouragent leurs contremaîtres à installer des ateliers clandestins dans des caves afin de sous-traiter les commandes, les moins bonnes conditions de travail permettant d’abaisser les coûts. » (p. 128-129)
« Les ouvrières étaient bien sous la domination du petit patron Boullaili. Mais la position de classe de celui-ci n’était pas claire. Simplement parce qu’il s’était installé dans une cave en ville, avait-il cessé d’être contremaître pour devenir capitaliste ? Il travaillait toujours pour Larinor, faisant exécuter les commandes telles qu’elles lui étaient adressées au moment où elles lui étaient adressées, sans accès direct à Zara et encore moins aux clients du monde entier. » (p. 129)
Les ouvrières ne sont pas que « sous la domination » de Boullaili (sinon il suffit de dire que Boullaili est « sous la domination » de Zara ou de Larinor pour faire de Boullaili et de ses ouvrières des personnes qui auraient les mêmes intérêts de classe, ce qui est évidemment faux), ces ouvrières sont exploitées par Boullaili, et partant, par Larinor et par Zara.
Boullaili est pressurisé, mis en concurrence avec d’autres sous-traitants potentiels par Larinor et par Zara, soumis à leurs conditions et tout ce que l’on voudra, mais il n’est jamais exploité par eux. Par contre, il exploite bien, lui, de la force de travail de prolétaires qu’il fait trimer dans des conditions abominables et jusqu’à provoquer leur mort, comme nous le montre cet exemple. Le petit patron Boullaili extrait de ce surtravail l’ensemble du surproduit pour le transférer à des plus gros que lui, qui ont accès à des marchés auxquels lui n’a pas accès. Ces grosses entreprises réalisent leur profit grâce aux marchandises achetées à bas coût à Boullaili et se taillent la part du lion en se dégageant les plus grosses marges. Qu’elles en profitent le plus n’empêche évidemment pas Boullaili de récupérer sa part de butin, même si c’est une part ridiculement petite par rapport à la masse des profits que dégage Zara.
De la même manière, l’ancien ouvrier puis contremaître Boullaili ne s’est pas « simplement » contenté de « s’installer dans une cave en ville » comme le dit pudiquement Lojkine : il y a mis là ses ouvrières et ses machines, tandis qu’il assurait, lui, les fonctions de petit capitaliste pour Larinor et pour Zara. Aussi pressurisé soit-il, Boullaili lui, ne travaille gratuitement pour personne : par contre, il touche une partie de la survaleur issue du travail des autres qu’il exploite, et qui lui est reversée en retour par Larinor ou par Zara.
Encore une fois, quand bien même ce taux de profit serait ridiculement petit[5] par rapport à ceux enregistrés par les groupes auxquels il est subordonné, il est à parier qu’il est plus important que celui auquel il aurait accès s’il ne travaillait pas pour Zara, auquel cas notre capitaliste Boullaili ne manquerait pas d’aller investir son capital ailleurs. En quoi le fait que Boullaili soit un ancien ouvrier, en quoi la concurrence que se livrent entre eux les différents capitalistes, et la distinction nécessaire compte tenu de cette concurrence entre petits et gros capitalistes, devraient-ils remettre en cause son statut actuel de capitaliste, d’exploiteur, et par conséquent les intérêts de classe qui y correspondent à sa classe, à sa situation ? Lojkine écrit juste après :
« Il [Boullaili] était donc subordonné à un capital à un niveau supérieur, celui de Larinor. Mais on a vu que les capitalistes de Larinor n’ont en réalité pas le plein contrôle sur le procès de production. Les modèles qui doivent être produits sont définis dans leurs moindres détails par Zara, filiale du groupe Inditex, lui-même possédé par son fondateur, le milliardaire espagnol Armancio Ortega […]. Il y a donc trois niveaux de capital, et il est difficile de dire qui est l’exploiteur – ou, en l’occurrence, le responsable de la mort – des ouvrières marocaines. » (p. 129)
« La position de classe de [Boullaili] n’était pas claire », « […] il est difficile de dire qui est l’exploiteur – ou, en l’occurrence, le responsable de la mort – des ouvrières marocaines » : il nous semble, bien au contraire, qu’il n’y a là rien de plus clair et de moins difficile à déterminer. Le petit capitaliste Boullaili est responsable, les capitalistes de Larinor sont responsables, ceux de Zara sont responsables. Comme le reconnaît lui-même Lojkine, l’histoire récente du travail regorge d’exemples sordides mettant en scène des petits patrons semi-esclavagistes du même genre qui, assumant une production délocalisée à bas prix qui se fait sur le dos des travailleurs surexploités de leurs pays, assurent aux grands groupes impérialistes des pays du Nord des taux de profit colossaux, dans le seul et unique but d’en grappiller une partie. Dans un ouvrage consacré à une étude de l’impérialisme au XXIème siècle, l’auteur, un certain John Smith, évoque l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, et la mort de plus d’un millier d’ouvrier du textile provoquée par la décision d’un petit capitaliste sous-traitant du même genre que Boullaili.
« L’effondrement du Rana Plaza, un bâtiment de huit étages hébergeant plusieurs ateliers de confection, une banque et quelques magasins, situé dans un quartier industriel du nord de Dacca, la capitale du Bangladesh, a tué 1 133 ouvriers du textile et en a blessé 2 500 le 24 avril 2013. C’est l’une des pires catastrophe de toute l’histoire du travail. Ce désastre, ainsi que le chagrin, la rage et l’exigence de justice manifestés par les ouvriers du textile, ont déclenché des mouvements de sympathie et de solidarité chez les travailleurs du monde entier. […] En plus de l’indignation ressentie par un grand nombre, est venu s’ajouter le fait que le jour précédant la catastrophe, des fissures étaient apparues dans la structure du bâtiment, et une consigne d’évacuation et de fermeture avait été donnée. Le lendemain matin, une banque et des magasins situés au rez-de-chaussée ont respecté cette consigne, mais des milliers d’ouvriers du textile ont reçu l’ordre de retourner travailler, sous peine d’être licenciés. Quand les générateurs, installés illégalement au dernier étage, ont démarré, le bâtiment s’est effondré. Jyrki Raina, secrétaire général d’IndustriALL, un syndicat international, a qualifié cet évènement de « massacre industriel de masse ». » (John Smith, L’Impérialisme au XXIe siècle, Éditions critiques, Paris, 2019, p. 13-14)
Ce genre d’évènement est loin d’être rare et on apprend au début du même ouvrage que :
« … cinq mois plus tôt [l’effondrement du Rana Plaza], un incendie dans l’usine de textile voisine de Tazreen Fashions avait tué 112 ouvriers, pris au piège derrière des fenêtres grillagées et des portes cadenassées alors qu’ils travaillaient tard la nuit. Par ailleurs, la suppression violente des droits syndicaux – les syndicalistes sont fichés, passés à tabac et sujets à des arrestations arbitraires – et les relations incestueuses entre les propriétaires d’usines, les politiciens et les chefs de police bangladais, font qu’aucun patron de l’industrie du textile au Bangladesh n’avait jamais été inculpé pour violations des lois sur la santé et la sécurité au travail. » (ibid., p. 14)
L’auteur de ce même ouvrage fait part du « témoignage éloquent » d’un autre propriétaire d’usine, un certain Ali Ahmad, « faisant état des pressions exercées sur les fournisseurs par les multinationales, après que 289 ouvriers textiles ont été brûlés vifs par un feu déclenché dans une usine de Karachi en septembre 2021 » (ibid., p. 22) :
[C’est le capitaliste Ali Ahmad qui parle.] « Vous avez des grèves, des coupures de courant, les mafias locales qui vous font payer pour la protection de votre secteur, pour n’en nommer que quelques-uns. […] De plus, vous avez les acheteurs aux États-Unis, sans pitié, qui se fichent de savoir ce que vous faites, tant que vous le faites à temps. […] On se prend des pénalités chaque fois qu’on a du retard. Ce qui signifie des marges en moins. Nous mettons donc en œuvre ce qui est nécessaire (sic!) pour réaliser nos commandes, rapidement. Ce propriétaire d’usine a peut-être imposé des heures supplémentaires dans ce seul but. » (ibid., p. 22-23)
Il va sans dire que ces petits capitalistes sont tenus à la gorge par les conditions que leur imposent les grands groupes impérialistes du Nord, dont leurs profits dépendent directement : désireux de survivre dans cette ambiance ultraconcurrentielle comme capitalistes, c’est-à-dire de continuer à vivre par l’exploitation du travail des autres, ces petits capitalistes sont « contraints » d’agir comme les pires des capitalistes, d’abaisser les conditions de travail jusqu’à provoquer la mort de centaines ou de milliers de vies de travailleurs surexploités.
Comme le dit le capitaliste Ali Ahmad, « les acheteurs aux États-Unis », Zara, les donneurs d’ordres en général, ne se soucient pas de ce qu’ils font pourvu qu’ils le fassent, mais ce sont bien, aux dernières nouvelles, ces mêmes petits patrons qui font ce qu’ils font. Qui « met en œuvre ce qui est nécessaire pour réaliser [les] commandes », comme le dit cyniquement le propriétaire Ali Ahmad, à savoir tailler dans les conditions de travail, mâter les grèves, faire tabasser et assassiner les syndicalistes et les meneurs[6], etc. ? Qui a donné l’ordre à des milliers de prolétaires d’aller travailler dans un immeuble de huit étages sur le point de s’écrouler et a installé des générateurs illégaux au sommet d’une infrastructure tombant en ruine ? Qui a fait installer des grilles aux fenêtres, qui a cadenassé les portes des ateliers de confection ayant pris feu ? Qui a installé de façon illégale un sous-sol dans une zone inondable avec « sans autre issue qu’un unique, étroit escalier », si ce n’est Boullaili lui-même, si ce n’est exactement ce type de petits patrons du même genre que celui de Boullaili, c’est-à-dire, en fait, des capitalistes authentiques, des capitalistes intégraux ? Ce ne sont pas ces grands groupes qui font régner directement la pire terreur, le pire despotisme, dans les usines et dans les ateliers : ça, c’est bien le « travail » des petits patrons comme Boullaili. Ne sont-ce par conséquent pas là des pratiques de capitalistes et d’exploiteurs authentiques, qu’une théorie critique et émancipatrice ne devrait jamais admettre dans ses rangs ?
Notes
[1]Comme nous le verrons plus loin, Lojkine affirme avec justesse dans son livre que la rémunération salariale de certains agents peut être supérieure à la valeur d’échange qu’ils créent effectivement, de telle sorte qu’ils sont, dans sa terminologie, des « exploiteurs » (nous préférons pour notre part dire qu’ils bénéficient de la retombée de la survaleur capitaliste, extorqué sur le travail gratuit d’autres prolétaires et nous réservons le terme d’« exploiteurs » aux capitalistes à proprement parler). Mais, de la sorte, on voit précisément mal en quoi une hausse générale de tous les salaires (qui s’appliquerait donc également aux salaires de ces « exploiteurs ») permettrait de limiter en quoi que ce soit l’exploitation en elle-même, comme le propose pourtant Lojkine dans son chapitre programmatique. On lit en effet page 221 que l’« … on pourrait envisager d’étendre ce système d’indexation [sur l’inflation] à l’ensemble des salaires, créant ainsi un droit général à la sécurité du niveau de vie pour les titulaires d’un emploi. » (nous soulignons). Lojkine considère d’ailleurs que la popularité de cette mesure est un bon argument en faveur de son adoption : « notons au passage la grande popularité de ces proposition dans l’opinion publique – en France, les sondages montrent que près de neuf personnes sur dix seraient favorables à une garantie d’emploi pour les chômeurs de longue durée, et la même proportion à une indexation de tous les salaires sur l’inflation –, ce qui confirme l’idée selon laquelle le langage universel des droits sociaux est susceptible de susciter un large soutien politique au-delà des personnes qui en bénéficient directement. » (p. 222-223, nous soulignons). Protéger la « sécurité du niveau de vie » de « tous les salariés », indépendamment de leur position de classe (bénéficiaires ou non de l’exploitation capitaliste) est assurément une mesure très « populaire », même et surtout chez les couches salariales les plus favorisées qui bénéficient concrètement des retombées de l’exploitation de leur propre bourgeoisie nationale. La popularité d’une telle mesure n’est donc ici que la marque du fait qu’elle conserve absolument le statu quo et qu’elle ne constitue pas une réelle menace pour les exploiteurs, d’autant plus que Lojkine reconnaît lui-même qu’une telle mesure devra être compensée par des mesures favorables à l’accumulation et aux exigences de compétitivité des entreprises capitalistes. Dans son article de juin 2024 pour le Grand Continent intitulé « Indexation des salaires sur l’inflation : structurer un débat » (https://legrandcontinent.eu/fr/2024/06/19/indexation-des-salaires-sur-linflation-structurer-un-debat/), Lojkine affirme en effet que : « l’indexation intégrale pourrait apporter un complément cohérent au droit du travail en protégeant efficacement le revenu des travailleurs contre les chocs inflationnistes, à condition de s’inscrire dans le cadre d’une stratégie macroéconomique plus générale de contrôle de l’inflation et de maintien de la compétitivité […] » (nous soulignons). Très concrètement, il ne s’agit rien de moins que d’une sorte de compromis de classe entre une bourgeoisie nationale et sa propre classe ouvrière : faire en sorte que la hausse générale des salaires n’affecte pas les profits des entreprises nationales, ne soient pas dommageable aux exploiteurs, bref, faire en sorte que la férocité de l’exploitation soit simplement déplacée ou rattrapée… ailleurs.
[2]Michel Husson, « Contre Sraffa. La transformation des valeurs en prix », 1982. Disponible en ligne ici : http://hussonet.free.fr/perez1982.pdf.
[3]Un des arguments mobilisés par Lojkine pour montrer que le rapport d’exploitation salarial ne saurait être compris comme le rapport fondamental consiste à dire qu’il est tout à fait possible d’imaginer une société où des revenus de la propriété existeraient (crédits, loyers) sans qu’il existe pourtant le moindre salarié. Ainsi : « il n’y a pas de contradiction logique à penser une société marchande moderne qui ne connaîtrait pas de rapport salarial – on peut penser à des travailleurs indépendants vendant directement leurs services, ou à des coopératives – mais connaîtrait bien une propriété privée foncière, immobilière et un système de crédit, concentrée entre les mains d’une classe qui tirerait revenu et pouvoir. Cette société serait bien différente de la nôtre, et il est probable en particulier qu’elle n’évoluerait pas de la même manière au cours du temps, puisque dans un système marchand, ce sont bien les capitalistes industriels qui sont les acteurs premiers de l’investissement productif destiné à accroître l’échelle de production. Notre capitalisme de rente et de crédit ne serait donc peut-être pas un capitalisme en expansion, mais il serait bien caractérisé par des rapports d’appropriation et de pouvoir, donc d’exploitation. » (p. 167) S’il s’agit de dire qu’il peut exister des prélèvements de rente ou d’intérêt par une classe parasitaire sur une masse de travailleurs indépendants (dont les revenus sont composés virtuellement de « salaires » et de « profits », quoiqu’en un sens nécessairement particulier), personne ne le niera. Mais comme le remarque Lojkine, cette « société serait bien différente de la nôtre » et elle ne pourra pas être « un capitalisme en expansion » (chaque travailleur demeure indépendant et travaille sans salariés, la concurrence ne joue pas à tel point que chacun d’entre eux est menacé de tomber à tout moment dans le prolétariat, la classe rentière parasitaire thésaurise elle-même à partir de ses ponctions sans chercher à développer une activité capitaliste, etc.). Autrement dit, une économie marchande tout à fait improbable, qui n’est en fait pas une économie capitaliste du tout. Lojkine peut bien qualifier ce modèle de « capitalisme de rente et de crédit », mais qu’est-ce qu’une économie capitaliste qui ne serait pas une économie dont le but est la valorisation du capital ? La seule société marchande entièrement développée est le capitalisme, et la manière privilégiée pour une telle société d’accumuler de la survaleur est bien le rapport salarial, qui est aussi du même coup le rapport d’exploitation fondamental. L’exemple construit par Lojkine d’une économie toute fictive « de rente et de crédit » ne change rien au fait que dans la société capitalise réelle les rapports de prélèvement rentiers et de crédit entre les capitaux se prélève bien sur la survaleur, laquelle est issue dans son immense majorité du travail exploité salarié, et, pour le reste, du travail exploité tout court (l’esclavage). C’est d’ailleurs ce que reconnaît Lojkine lui-même quelques lignes plus loin : « à mesure que le capitalisme s’est développé, le salariat a sans cesse progressé. Les employeurs sont une petite minorité, alors que la condition salariale a dans la population une extension immense, plus que celle de débiteur ou de locataire. » (p. 167-168, nous soulignons).
[4]Dans La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky (disponible en ligne ici : https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1918/11/renegat.pdf), Lénine défend par exemple, contre les protestations de Kautsky, la déchéance des droits électoraux des capitalistes, même et surtout lorsqu’ils sont « petits » : « Kautsky n’est pas moins indigné que la Constitution soviétique prive des droits électoraux ceux qui « emploient des ouvriers salariés pour en tirer du profit ». « Un travailleur à domicile ou un petit patron qui emploie un aide compagnon, écrit Kautsky, peuvent avoir les conditions d’existence et les sentiments de vrais prolétaires, et ils n’ont pas de droits électoraux » (p. 36 [de la brochure de Kautksy]). Quelle dérogation à la « démocratie pure » ! Quelle injustice ! Il est vrai que jusqu’ici tous les marxistes estimaient, et des milliers de faits le confirment, que les petits patrons sont les plus dénués de scrupules, les pires exploiteurs des ouvriers salariés […] » (p. 31) Cette déchéance des droits civiques de la classe exploiteuse vaincue n’a pas valeur de principe chez Lénine, mais ce dernier insiste toujours sur le fait que la dictature prolétarienne, non seulement peut, mais doit recourir à cette mesure lorsque la lutte pratique l’exige : « comme je l’ai déjà indiqué, le fait de priver la bourgeoisie des droits électoraux n’est pas un indice obligatoire et indispensable de la dictature du prolétariat. Même en Russie les bolcheviks qui, longtemps avant octobre, avaient proclamé le mot d’ordre de cette dictature, n’avaient pas parlé d’avance de priver les exploiteurs des droits électoraux. Cet élément intégrant de la dictature s’est fait jour non « d’après le plan » d’un parti ; il a surgi de lui-même au cours de la lutte. » (p. 29)
[5]Pour ce qui est des marges des petits patrons au Bangladesh : « Une […] analyste estime qu’un polo KP MacLane fabriqué au Bangladesh, vendu au détail aux États-Unis pour 175 $, génère une marge confortable de 718 % sur les coûts de production, et qu’un polo Hermès revendu génère une marge dépassant rien de moins que 1800 %. Les montants colossaux de ces marges contrastent avec les marges négligeables laissées aux fabriquant bangladais. Le Wall Street Journal rapporte que Rubana Huq, propriétaire d’une usine de confection, affirme gagner 12,5 centimes sur chaque tee-shirt, dont le prix de production est de 6,62 $, soit une marge de 2 %. » (John Smith, L’Impérialisme au XXIe siècle, Éditions critiques, Paris, 2019, p. 22).
[6]« Récemment, pour avoir protesté contre le non-paiement des salaires un recruteur syndical de la Fédération des travailleurs de l’industrie et de la confection du Bangladesh (BGIWF) a été battu à mort à Gazipur par des hommes de main embauchés par l’usine. Un autre recruteur, de la Fédération nationale de la confection (NGWF), a été assassiné, manifestement pour avoir tenté de syndiquer des travailleurs et travailleuses à Ashulia. » (« La syndicalisation au Bangladesh reste un défi », 19 septembre 2023, IndustriALL Global Union : https://www.industriall-union.org/fr/la-syndicalisation-au-bangladesh-reste-un-defi)
°°°
Source: https://www.contretemps.eu/critique-exploitation-capitaliste-theorie-marxiste-valeur/
URL de cet article: https://lherminerouge.fr/le-fil-invisible-du-capital-un-livre-dulysse-lojkine-editions-la-decouverte-contretemps-25-09-25/
