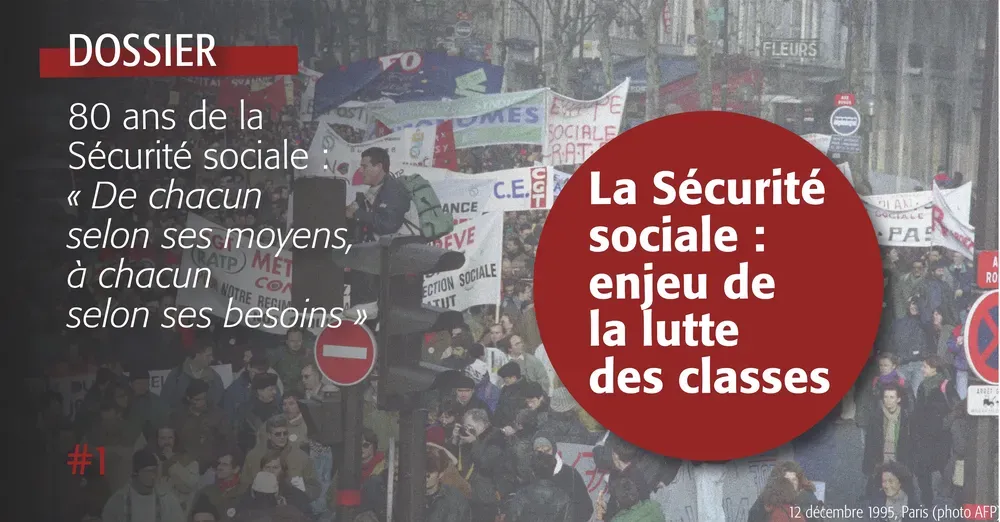
À l’occasion des 80 ans de la Sécurité sociale, Informations ouvrières reviendra sur les enjeux pour la classe de cette conquête majeure arrachée en 1945 par les travailleurs. Première partie : La question du financement.
Par Soriane Frid
C’est le Medef qui doit être heureux…
En 2007, dans une chronique qu’il avait rédigée pour la revue Challenges du 4 octobre 2007 intitulée « Adieu 1945, raccrochons notre pays au monde ! » Kessler (alors n° 2 du Medef) écrivait : « La liste des réformes ? C’est simple, prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s’agit aujourd’hui de sortir de 1945, et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance. »
Ce que Denis Kessler a appelé de ses vœux, la macronie l’exauce.
Et ce 80e anniversaire de la Sécurité sociale est marqué par une accélération visant à réaliser les vœux du patronat et donc la liquidation de cet acquis majeur.
L’offensive passe en premier lieu par la remise en cause du financement de la Sécu.
C’est dans ce contexte que le gouvernement ne cesse de développer une propagande pour répondre aux vœux du Medef d’en finir avec le financement de la Sécu par les cotisations.
À commencer par Emmanuel Macron qui lors d’un show sur TF1 le 13 mai 2025 a indiqué que « le financement du modèle social repose trop sur le travail », en ajoutant qu’il fallait que le gouvernement organise une conférence sociale pour retravailler ce dossier.
Ça « repose trop sur le travail » ? Les cotisations sociales, ce ne sont pas un « prélèvement obligatoire » (dont on nous rebat les oreilles sous prétexte que la France en serait la championne du monde), mais une partie du salaire due par le patron. Le salaire, dont sa partie socialisée que sont les cotisations, ça n’a absolument rien à voir avec un impôt ou une taxe, c’est le paiement par le patron de la force de travail. Les cotisations, c’est du salaire, point barre ! Y toucher, c’est toucher à notre salaire. La politique d’exonérations suivie depuis plus de trente ans est une politique de baisse des salaires.
Ce que Jupiter veut, son/ses gouvernement(s) l’organise(nt). Mais comme ils sont ultra-minoritaires, il leur faut l’appui des organisations syndicales pour avancer sur ce projet.
C’est pourquoi, le 19 juin dernier, Catherine Vautrin (ministre de la Santé) a annoncé être prête à réunir une conférence sur le modèle social « dès le mois de juillet ».
Selon la ministre devenue démissionnaire, cette conférence devra répondre à la question : « Combien chacun d’entre nous veut-il que la société mette ou consacre au modèle social et comment chacun est prêt à y participer. » Avec, pour « exigence collective » , « de rendre à la Sécurité sociale sa clarté, sa pérennité, sa promesse, c’est-à-dire un système qui protège sans s’épuiser, qui soigne sans exclure ». Idée reprise par François Bayrou le 15 juillet et proposée aux organisations syndicales nationales le 24 septembre dernier par Sébastien Lecornu. En effet, il leur a clairement demandé de se pencher sur le financement de la protection sociale.
Pourquoi tant d’acharnement ?
Parce que la Sécurité sociale est le produit de la classe ouvrière victorieuse ! La cotisation matérialise le droit de propriété de la classe ouvrière sur la Sécu.
C’est pour cette raison que la question du financement est une question centrale. Nous allons essayer d’expliquer à travers ces pages l’origine et l’actualité de ce sujet !
En ce 80e anniversaire de la Sécurité sociale, il est urgent de se mobiliser afin que celui-ci ne soit pas son dernier !
| Charité contre solidarité : la question du contrôle ouvrier L’histoire de la Sécurité sociale est indissociable de l’histoire du mouvement ouvrier.Avec le développement du capitalisme, s’est développé le salariat. L’ouvrier pour survivre doit vendre sa force de travail au capital qui l’achète, bien entendu, le moins cher possible.Aussi, lorsque l’ouvrier ou l’ouvrière était dans l’incapacité de vendre sa force de travail parce que malade, accidenté, trop vieux ou pour cause de maternité… celui-ci n’avait plus rien pour survivre, hormis dépendre de la charité des puissants.C’est dans ce contexte que très vite, l’exigence de l’entraide entre travailleurs s’est fait sentir de plus en plus intensément. Pour y satisfaire, dès le début du XIXe siècle, alors que la loi Le Chapelier interdisait toute forme de regroupements, que des sociétés de secours mutuels sont constituées par les ouvriers, pour faire face à la maladie, aux accidents, à la vieillesse, et aussi au chômage.À la lecture du texte rédigé par un ouvrier gantier de Grenoble, en 1820, qui caractérise la Société de secours mutuels des ouvriers gantiers de Grenoble (lire ci-dessous) comment ne pas penser à la Sécurité sociale ? Il s’agit là de la première expression connue de la solidarité ouvrière.Ce texte situe toute la différence entre solidarité et charité.Ainsi à l’inverse de la charité, la solidarité c’est la garantie d’avoir des droits via une législation et un contrôle ouvrier grâce au financement basé sur la cotisation.Ce combat va être pris en charge par les syndicats qui depuis 1884 sont autorisés et principalement par la CGT constituée en 1895.Sur la cotisation ouvrière, le débat va être tranché en sa faveur au moment des discussions autour de la loi sur les assurances sociales « parce que la cotisation ouvrière marque la frontière qui sépare l’assistance de l’assurance sociale. Parce que la cotisation ouvrière ouvre un droit gestionnaire dans les caisses et les offices que la loi institue. Mais aussi parce que depuis 1910 la tradition de la cotisation ouvrière est sans cesse confirmée : les mineurs, les cheminots, les fonctionnaires, certains ouvriers de l’État ont eu l’occasion à diverses reprises de voir discuter à nouveau la question de leurs retraites : jamais on n’a remis en question le principe de la cotisation ouvrière ».La question du contrôle étant au cœur du débat, il faudra près de dix ans pour que la loi sur les assurances sociales soit votée (projet de loi déposé le 22 mars 1921, voté en 1930).Et pour cause, deux orientations s’affrontaient :D’un côté avec Georges Buisson mandaté par la CGT pour défendre cette loi. Il fera de nombreuses conférences, il était animateur des caisses d’assurances sociales « le travail » sous le contrôle exclusif des salariés,de l’autre le patronat, la mutualité (FNMF constituée en 1902) et l’Église, contre la loi pour différentes raisons mais surtout au nom de la « liberté ».Derrière la notion de liberté il y avait en fait la peur pour la Mutualité de perdre ses prérogatives, pour le patronat, la peur de la cotisation (déjà) et de l’unification des droits pour les travailleurs, et pour l’Église la crainte de la perte d’influence des regroupements mutualistes qu’elle contrôlait.L’État bourgeois, tenant compte de ces oppositions, fera en sorte que la loi sur les assurances sociales reste insuffisante car celles-ci sont confiées à des caisses privées qui se font concurrence :– d’un côté les caisses patronales, les caisses impulsées par l’Église et les caisses mutualistes qui opposent au régime de la cotisation obligatoire, celui de l’adhésion volontaire ;– de l’autre les caisses de travail mises en place par les militants CGT, partisans de la cotisation obligatoire, et de la couverture de tous les risques. Texte écrit par un ouvrier gantier de Grenoble en 1820 « On n’a jamais bien compris le but de cette institution, que l’on a trop souvent assimilée aux bureaux de charité ; pourtant, quelle différence ! Ceux-ci sont composés, il est vrai, de personnes bienfaisantes et par conséquent vertueuses, mais réunies dans le seul but de déverser l’aumône dans les mains de l’indigence : les membres qui les composent sont tous bienfaiteurs, la pitié est le sentiment qui les fait agir ; chez nous, au contraire, les secours que la société accorde sont des droits acquis, tous les sociétaires peuvent être à la fois obligeants et obligés ; c’est une famille qui réunit en commun le fruit de ses labeurs pour pouvoir s’entraider mutuellement, ce sont des frères qui tendent les bras à leurs frères.Pas de pitié dans leur empressement, pas de honte pour celui qui reçoit, quelle que soit la différence des positions ; tous sentent que la fortune est inconstante ; celui qui ne reçoit pas aujourd’hui peut recevoir demain. Les droits sont tous égaux, nulle autre différence que celle des malheurs ; celui qui se trouve favorisé par la fortune peut s’en voir abandonné ; alors, ses droits sont indiscutables et ce qu’il a fait pour ses frères doit être fait pour lui.N’est-ce pas là plutôt une société de prévoyance, et n’est-ce pas injuste en ne voulant la considérer que comme une œuvre de charité, toujours humiliante pour celui qui est obligé de recevoir les secours qui lui sont nécessaires ? Chez nous, le reproche est un crime, la divulgation une faute sévèrement punie ; pourquoi ? Parce que celui qui reçoit ne reçoit rien de personne, c’est sa propriété qu’on lui remet, c’est son bien qu’il dépense, il ne doit aucun remerciement, le contrat est réciproque. » |

| .Quelques premiers repères historiques1943-1944 : le programme du CNR ? Plutôt le programme de la CGT ! Avec la multiplication des conférences sur le thème des 80 ans de la Sécu, il est souvent fait mention du rôle joué par le CNR dans l’élaboration du programme de la Sécurité sociale.Malheureusement, il est rarement fait mention du combat de la classe ouvrière et du rôle de la CGT dans l’édification de la Sécu. Il est pourtant majeur !Le CNR est constitué de toutes les forces politiques et syndicales combattant le régime de Vichy.Il faut ici rappeler que le programme des jours heureux est un programme d’union nationale.Le programme débute ainsi : « Unis quant au but à atteindre, unis quant aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre ce but qui est la libération rapide du territoire, les représentants des mouvements, groupements, partis ou tendances politiques groupés au sein du CNR proclament qu’ils sont décidés à rester unis après la libération. »Dans ce contexte d’union sacrée, la seule référence à la Sécu est la suivante : « Un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État. »Un système qui protège les citoyens, géré par l’État (comprendre ici l’impôt à la place de la cotisation).Pourtant, ce n’est pas le modèle promu par les jours heureux qui inspirera les ordonnances de 1945 mais celui de la CGT.Le 6 décembre 1944, Georges Buisson, mandaté par la CGT, présente à l’Assemblée consultative le programme de la CGT en matière de Sécurité sociale.Il inscrit la Sécurité sociale dans la continuité des assurances sociales qui fondent la protection sociale sur le financement par le salaire différé et l’organisation nationale unifiée.La mobilisation révolutionnaire de la fin de la guerre va permettre à ce programme d’être repris dans ses grandes lignes car malgré le dispositif d’union nationale, les possédants craignaient de voir la libération du pays opérée par la classe ouvrière déboucher sur une révolution.1945 : la création de la Sécurité socialeL’article 1er des ordonnances du 4 octobre 1945 prévoit : « Il est institué une organisation, de la sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu’ils supportent. L’organisation de la sécurité sociale assure dès à présent le service des prestations prévues par les législations concernant les assurances sociales, l’allocation aux vieux travailleurs salariés, les accidents du travail et maladies professionnelles et les allocations familiales et de salaire unique aux catégories de travailleurs protégés par chacune de ces législations dans le cadre des prescriptions fixées par celles-ci et sous réserve des dispositions de la présente ordonnance. »Cet article concentre tout ce qui est combattu aujourd’hui : la caisse unique de la Sécurité sociale qui organise l’unité de la classe ouvrière. Dans l’esprit de l’ouvrier gantier, c’est la classe ouvrière qui garantit les droits de chacun au travers la cotisation.C’est parce que la classe ouvrière refusait l’assistanat et d’être sous une quelconque tutelle étatique que le financement de la Sécurité sociale a été basé sur la cotisation sociale. Ce principe a donné le fameux : on cotise selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins.Très vite, le budget de la Sécurité sociale atteignit puis dépassa le budget de l’État.Cela était insupportable pour le patronat et l’État qui ne peut pas mettre la main sur le magot car les cotisations sont fléchées et redistribuées sous forme de prestations, pensions…Dès sa mise en œuvre, la Sécu est menacée et les offensives sur son financement vont se multiplier.À propos des cotisations « salariales et patronales »Il faut signaler que, pour justifier la présence des employeurs dans les conseils d’administration et aussi pour mieux baisser le coût du travail, a été créée la distinction fallacieuse entre cotisation patronale et cotisation salariale.Distinction fallacieuse, car cotisation salariale et cotisation patronale ne font qu’un dans les livres de comptes du patronat. Les prétendues charges salariales sont inscrites dans le « compte 64. – Charges de personnel » au même titre que le salaire lui-même.Le mouvement ouvrier a toujours considéré que les cotisations, tant les « patronales » que les « salariales », constituaient un salaire différé, mis en commun par tous les salariés afin de subvenir à leurs besoins.C’est ce qui fait de la Sécu la propriété des travailleurs salariés. Comme le disait l’ouvrier gantier de Grenoble, c’est « sa propriété qu’on lui remet, c’est son bien qu’il dépense ». |
| La Ve République contre la Sécurité socialePlus que jamais, la Sécurité sociale est un enjeu majeur et permanent de la lutte des classes.Le gouvernement s’est attelé à remettre en cause la Sécurité sociale à travers deux leviers : le paritarisme et la fiscalisation de la Sécurité sociale.Le paritarisme au compte du capitalAlors que les conseils d’administration étaient pour 75 % composés de représentants des organisations ouvrières (représentants des confédérations syndicales des travailleurs) et pour 25 % des représentants des organisations patronales (concession faite du fait de l’arnaque de la notion de cotisation patronale, les ordonnances Jeanneney de 1967 imposent que les organisations patronales obtiennent 50 % des sièges dans les conseils d’administration.Ces ordonnances remettent aussi en cause l’unité de la Sécurité sociale que nous aborderons dans le prochain numéro d’Informations ouvrières et l’unité de la cotisation du fait de la scission de la Sécu en trois branches. La grève générale de 1968 empêchera l’application complète des ordonnances Jeanne ney sans toutefois obtenir leur abrogation.L’étatisation et la fiscalisation contre la Sécu : Les principales attaques– 1990 : la CSGAvec la création de la contribution sociale généralisée (CSG) passée à coup de 49.3 (déjà) par le gouvernement Mitterrand-Rocard, la « gauche responsable » va initier le mouvement vers la fiscalisation. Cela pour lutter contre le prétendu trou de la Sécu !Cette CSG ne va faire que croître et permettre la diminution de la part des cotisations dans le financement de la Sécu (les cotisations ne représentent aujourd’hui que 49 % des recettes de la Sécurité sociale).À l’inverse de la cotisation, la CSG est un impôt et ne donne aucun droit. L’impôt peut être affecté par le gouvernement où bon lui semble (pour l’armement par exemple).– 1995 : les ordonnances JuppéCes ordonnances ont porté un coup majeur dans la gestion de la Sécu avec la mise en place de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) et l’objectif national de dépense d’assurance maladie (Ondam). Le budget de la Sécurité sociale est donc voté par le Parlement. C’est la mise sous tutelle de la Sécu par l’État qui impose aux orga de Sécurité sociale le carcan des contrats d’objectif et de gestion (Cog). Le gouvernement Chirac-Juppé en profite aussi pour fiscaliser encore plus la Sécurité sociale via la création de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;– 2018 : la cotisation maladie « salarié » est supprimée par le gouvernement Macron-Philippe avec augmentation simultanée de la CSG à 9,2 % des revenus. Le motif invoqué est l’augmentation des salaires !– 2025 : Macron annonce vouloir mettre en place une TVA sociale car la Sécu pèse trop sur le travail et en parallèle le gouvernement souhaite organiser une conférence sociale avec les confédérations syndicales sur le financement de la Sécurité sociale. |
°°°°
Source: https://infos-ouvrieres.fr/
URL de cet article: https://lherminerouge.fr/oui-la-secu-est-elle-a-nous-cest-notre-salaire-io-fr-5-10-25/
















Il manque la période chrétienne depuis au moins 1840
Petit coup de patte à la Russie, a-t-il enquêté pour savoir si cela pouvait être vrai? Pas de rappel de…
Bon , ce n'st pas lui qui va nous expliquer comment décroitre!
il n'a pas lu le livre de Zucman!!
Très intéressant !