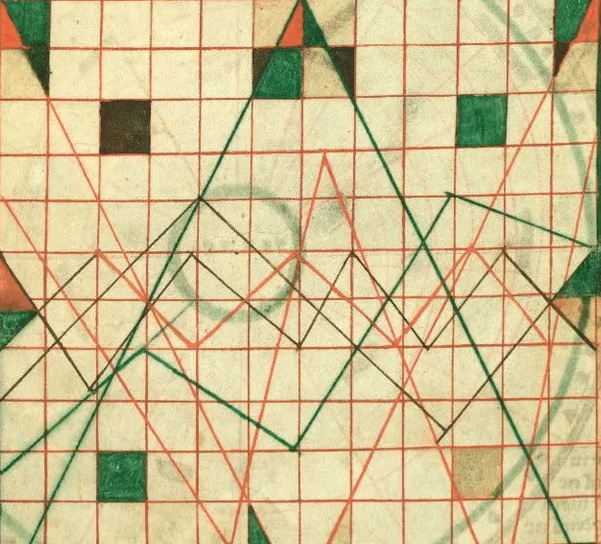
Ces quinze dernières années, l’extrême droite 2.0 est devenue presque partout un phénomène de masse, un moteur électoral, tant parmi ceux qui votent pour elle que parmi ceux qui la craignent, mais aussi un sujet éditorial attrayant. Des dizaines d’essais ont traité, avec plus ou moins de succès, de la montée d’une série de tendances qui semblaient avoir disparu à l’époque de la prétendue « mondialisation heureuse » et qui sont revenues en force après l’effondrement de Lehman Brothers et le réveil de l’austérité militarisée.
Dans cet entretien, le philosophe Alberto Toscano revient sur l’histoire du fascisme et défend l’usage actuel de cette catégorie, en particulier dans un monde bouleversé par le génocide en cours à Gaza. Son ouvrage Fascisme tardif : Généalogies de l’extrême-droite contemporaine (éditions de la Tempête, 2025) figure parmi les plus suggestifs de la production consacrée à la nouvelle jeunesse — ou seconde réincarnation — du fascisme, notamment parce qu’il refuse de limiter le sens du mot « fascisme » aux seules expériences italienne et allemande des années 1930-1940 et déplace l’enquête vers les expressions fascistes du monde libéral antérieures à ces expériences — plus précisément vers le crime des incursions coloniales.
Toscano relie en outre l’histoire du fascisme au présent, et plus précisément au génocide en cours à Gaza, soutenu et financé par des dirigeants qui n’ont pas été, et ne seront pas, fascistes, mais qui n’en partagent pas moins des désirs et des horizons communs avec les leaders d’extrême droite.
Entretien réalisé par Pablo ELORDUY.
Pablo Elorduy – Que représente Israël aujourd’hui pour l’idée du fascisme tardif ?
Alberto Toscano – On peut commencer par rappeler brièvement le débat sur le fascisme en Israël même, débat assez ancien qui, comme beaucoup de questions abordées dans le livre, démarre dans les années 1970. La toute petite gauche antisioniste en Israël s’est alors mise à discuter — surtout après l’ascension de Menachem Begin, de la possibilité de qualifier Israël de forme sui generis de fascisme. C’est intéressant et symptomatique, parce que le cas israélien montre très bien comment la catégorie de fascisme peut servir non seulement à nommer et analyser, mais aussi à occulter certains phénomènes. Ainsi, au sein d’un sionisme libéral — si le terme a encore un sens, sans doute moins aujourd’hui qu’hier —, l’idée d’une fascisation d’Israël a aussi servi à justifier ou légitimer le sionisme dans sa forme classique. On véhiculait l’idée que le fascisme pouvait n’être qu’une dérive, un moment de crise.
Pablo Elorduy – D’où vient cette idée d’assimilation entre sionisme classique et fascisme ?
Alberto Toscano – L’un des courants les plus intéressants de cette dissidence antisioniste de gauche — microscopique mais très productif intellectuellement — fut un groupe trotskiste des années 1970. Il critiquait vigoureusement le fait que certains communistes israéliens qualifient la période Begin de fasciste, car cela normalisait, selon eux, ce qui avait précédé. On observe également cette tendance quand de nombreux centristes, progressistes et libéraux, présentent le fascisme non comme un produit potentiel ou dialectique du statu quo, mais comme une violation, une exception. Ce discours perdure. Dans Haaretz, on lit quantité d’articles, publiés à divers moments critiques de la politique israélienne, parlant de fascisme. Le dernier épisode, très révélateur, fut la crise autour de la Cour suprême, avant le 7 octobre 2023.
Pablo Elorduy – Dans quel sens ?
Alberto Toscano – Dans des entretiens avec des intellectuels sionistes libéraux et progressistes, on entendait : « si la réforme autoritaire de la Cour suprême voulue par le gouvernement Netanyahou est adoptée, nous entrerons dans une logique de fascisation où, par exemple, la police viendra chez les gens les sortir de leur lit ; l’armée aura licence de faire ce qu’elle veut… ». Sans s’en rendre compte, ils décrivaient exactement ce que vivent les Palestiniens dans les territoires occupés — et nombre de Palestiniens qui sont officiellement citoyens d’Israël depuis 1948. Aujourd’hui, le discours sur le fascisme offre aussi cette possibilité d’auto-exonération d’un libéralisme, d’un centrisme, qui considère comme des exceptions des phénomènes qu’il a produits — ou dont il est complice.
Pablo Elorduy – Nous voyons aujourd’hui l’extrême droite internationale tomber dans les bras d’Israël.
Alberto Toscano – La question est bien de savoir comment et pourquoi l’extrême droite internationale, cette internationale fasciste–tardif en train de se recomposer partout, s’identifie autant à Israël au moment où celui-ci déploie sa violence coloniale la plus extrême : génocidaire, exterminatrice. On peut l’interpréter de multiples façons selon les contextes, mais ce qu’on observe ici, c’est la façon dont l’histoire profonde et la préhistoire du fascisme — sa relation constitutive avec le colonialisme et le capitalisme racial — font qu’Israël apparaît, aux yeux d’une droite raciste, occidentalisée, suprémaciste, comme l’affirmation, presque utopique, de ses idées : la possibilité d’être libre de dominer l’autre — l’autre racialisé, l’indigène — en toute impunité, au sein d’une société néolibérale, capitaliste et technologiquement avancée.
Pablo Elorduy – Il y a une identification absolue.
Alberto Toscano – C’est comme si l’inconscient colonial de la droite pouvait désormais s’exprimer librement. Bien sûr, la situation diffère en Inde ou en Amérique latine, mais, dans le cas européen, c’est « parfait » : cette identification à un État ethnocratique qui mène une guerre d’extermination permet en même temps à l’Europe de s’immuniser — ou de se blanchir — de l’accusation d’antisémitisme et de racisme, et d’être identifiée à l’Holocauste. C’est pourquoi j’ai trouvé grotesque, mais symptomatique, la tenue, fin mars 2025, à Jérusalem d’une rencontre « pour la défense du monde juif » avec des fascistes au passé et au présent antisémites.
Pablo Elorduy – La référence fondamentale est les États-Unis, où il n’y a pratiquement aucune différence dans le traitement réservé à Israël entre l’establishment du Parti Démocrate, les Républicains et Trump. Comment fonctionne cette adhésion dans ce cas ?
Alberto Toscano – Dans la version spécifiquement étatsunienne, tout l’imaginaire du sionisme chrétien nationaliste extrême joue aussi : une identification ouverte, quasi irréfléchie, au colonialisme racial. C’est une logique différente, peut-être plus significative et plus nocive. On peut y rattacher la déclaration du chancelier allemand selon laquelle les Israéliens font « notre sale boulot ». Elle part de l’idée que tout acte de guerre ou de violence israélien relève par définition de la légitime défense. Israël serait le fer de lance de l’Occident, et la violence qu’il déchaîne serait toujours une contre-violence. D’où, symptôme parlant, ce message du ministère allemand des Affaires étrangères condamnant l’« agression iranienne » avant même le tir de missiles iraniens, mais après le bombardement de Téhéran par Israël.
Pablo Elorduy – Vous avez déjà rappelé que des pratiques fascistes, intolérables à l’intérieur des sociétés européennes, étaient tolérées et applaudies lorsqu’elles visaient des nations colonisées. Avons-nous oublié cet héritage ?
Alberto Toscano – Dans sa forme classique, c’est l’analyse qui se trouve dans le Discours sur le colonialisme, d’Aimé Césaire, et c’est la logique de ce qu’on appelle désormais assez couramment le « boomerang » colonial. On peut comprendre le fascisme comme le moment où ces méthodes et violences coloniales — et les idéologies raciales qui vont avec — franchissent la frontière sacrée de l’Europe. Mais elles n’ont jamais été exceptionnelles pour leurs victimes coloniales ou indigènes. C’était tout l’argument de la pensée noire radicale anticolonialiste dès les années 1920-1930. Le milieu des années 1930 est une conjoncture cruciale : l’invasion italienne de l’Éthiopie en 1935 et, bien sûr, la guerre d’Espagne en 1936.
Pablo Elorduy – Que se passe-t-il alors ?
Alberto Toscano – Le Komintern et l’Union soviétique changent de stratégie : on passe de l’idée « classe contre classe », de l’antagonisme total contre le fascisme et contre la social-démocratie, à une logique de Front Populaire. Et dans cette logique, en 1935 — ainsi que dans les débats sur la Société des Nations —, s’installe l’idée qu’il faut distinguer entre un impérialisme raciste/fasciste et un impérialisme « démocratique », qui fonctionnerait comme un moindre mal.
Face à cela, toute une série d’intellectuels radicaux, communistes, marxistes venus du monde colonial, mais en diaspora à Paris et à Londres, élaborent une autre tendance de la pensée critique du fascisme, qui met sur la table la relation fondamentale entre fascisme et colonialisme. Ils disent : ce que vous tenez pour abomination ou exception, c’est notre expérience du colonialisme — y compris du colonialisme français, britannique, « démocratique » et libéral. On pense aux textes de George Padmore (1903-1959), d’Aimé Césaire (1913-2008), de C. L. R. James (1901-1989) et d’autres.
C’est à ce moment et pour cette raison que ces dissidents quittent le Komintern et la Troisième Internationale, puis développent diverses dissidences marxistes et socialistes. Dans le cas de l’invasion de l’Éthiopie, ils tentent de construire un discours de solidarité internationale autour de l’idée de sanctions ouvrières, de boycott ouvrier. C’est intéressant, car c’est la même tradition qui sera explicitement invoquée contre l’apartheid et contre la dictature au Chili. Elle se diffuse surtout parmi les travailleurs des ports, les marins.
Pablo Elorduy – Un héritage dont la gauche continentale se souvient peu.
Alberto Toscano – Il importe non seulement de voir comment se développe, au sein d’une pensée anticapitaliste et anticoloniale, une perspective politique très différente, mais aussi de se rappeler qu’elle résulte d’une série de débats stratégiques et pratiques. Ces autres théories du fascisme émergent au moment même où l’antifascisme « officiel » — libéral, ou, pour les années 1930, celui de la Troisième Internationale — traite le colonialisme occidental libéral comme un moindre mal. C’est un rappel très important aujourd’hui.
Pablo Elorduy – Le débat se joue aussi aux États-Unis, sur fond de ségrégation raciale, avant le mouvement des droits civiques.
Alberto Toscano – Oui, avec d’autres inflexions, dont cette idée — l’une des citations qui ouvrent mon livre — formulée par le poète Langston Hughes (1901-1967) : ce que les Européens découvrent comme nouveau avec le fascisme est très familier à celles et ceux qui ont connu l’esclavage, mais aussi tout le régime d’apartheid de Jim Crow qui a régi une large part des États-Unis.
Pablo Elorduy – À gauche, on a toujours revendiqué des utopies. Or l’expérience montre que l’utopie traverse les idéologies et, très souvent, est par définition exclusive. L’Utopie de Thomas More (1478-1535) l’était déjà ; aujourd’hui, on voit qu’Israël, à sa manière, propose sa propre utopie, avec l’aide de Trump et de ses vidéos pleines d’apparat et de casinos. La gauche doit-elle problématiser sa revendication de l’utopie ?
Alberto Toscano – Les mouvements radicaux européens ont entretenu des relations très complexes — et assez problématiques — avec le colonialisme, y compris dans les utopies concrètes qu’ils ont proposées.
Il y a quelques années, je travaillais sur les écrits du géographe anarchiste Élisée Reclus (1830-1905). À certains moments, nombre de révolutionnaires exilés au XIXe siècle — anarchistes, mais aussi communistes —, surtout après les défaites de 1848 et de la Commune de Paris, ont tenté de construire des îles, des enclaves utopiques, mais dans des situations de colonialisme de peuplement. Et il y a un débat, chez les anarchistes français, sur la possibilité de « coloniser », non pas au sens de dominer, mais au sens de trouver des terres libres, inoccupées.
La question de la décolonisation de l’utopie est complexe. Si l’on regarde la science-fiction, notamment étatsunienne, avec tous ses fantômes historiques, on voit à quel point l’idée du colonialisme de peuplement est sédimentée dans ses récits.
Pablo Elorduy – L’utopie de droite se développe sans ces problématiques.
Alberto Toscano – Je pense qu’il existe une ambivalence, et aussi de fortes contradictions, au sein des droites, y compris la droite radicale ou extrême contemporaine, quant à ce qu’est l’utopie. L’une des raisons pour lesquelles j’ai commencé à parler de « fascisme tardif », c’est qu’en 2016-2017, en pensant à des phénomènes comme Trump ou l’extrême droite européenne, il me semblait que la charge utopique y était assez faible.
Pablo Elorduy – Quelle est la différence avec le fascisme classique à cet égard ?
Alberto Toscano – Dans les analyses des années 1930 de figures hétérodoxes du marxisme et de la théorie critique comme Ernst Bloch (1885-1977) et Georges Bataille (1897-1962) —, on soulignait que l’élément utopique du fascisme était sous-estimé. On reconnaissait que c’était bien une perversion, mais aussi une utopie, et qu’à ce titre elle avait la capacité de canaliser certaines forces, certains désirs, certains fantasmes débordants de la société. Ils critiquaient l’erreur d’un marxisme trop rationaliste qui ne saurait s’y opposer — voire, chez Bataille, l’absence de tentative pour en capter aussi les énergies.
Pablo Elorduy – Pourtant, vous dites que le désir utopique de l’extrême droite actuelle est faible. Pourquoi ?
Alberto Toscano – Beaucoup de figures de l’extrême droite se tournent vers des fascismes plus ésotériques, mais la plupart de ces mouvements sont très conservateurs dans leurs formes, leurs modes de vie et leurs imaginaires. Toute l’idée — mimésis inversée du communisme et des utopies de gauche des années 1920-1930 — d’un « homme nouveau » ou d’un avenir radicalement différent, d’une révolution nationale avec son esthétique et sa culture, n’est pas centrale pour les droites actuelles.
Pablo Elorduy – Pourquoi ?
Alberto Toscano – D’une certaine manière, ces extrêmes droites ont le succès électoral et culturel qu’elles ont parce qu’elles n’exigent pas grand-chose de leurs followers — et j’emploie sciemment ce mot lié aux réseaux sociaux. On ne te demande pas de changer de vie, à peine d’imaginer faire des sacrifices.
Un épisode curieux, au moment des droits de douane : après un discours de Trump, des gens furent choqués parce qu’il avait dit — de façon étrange et misogyne — que les petites Américaines devaient se contenter de trois poupées et non de trente. Même cette modeste réduction de consommation fut perçue comme une rupture d’un contrat symbolique. C’est symptomatique de ce conservatisme subjectif, existentiel.
S’il y a des éléments utopiques, ils sont plus banals : petites utopies de domination domestique, de domination sur les migrant.es ; pas l’idée d’une rupture ou d’une transformation de la vie quotidienne.
Pablo Elorduy – Là encore, Israël représente une utopie totalisante, avec l’idée du « Grand Israël » portée par l’extrême droite sioniste.
Alberto Toscano – C’est peut-être la raison pour laquelle certaines extrêmes droites s’identifient fortement à Israël et en sont attirées : parce qu’il semble y avoir, dans son extrême violence et sa capacité à briser toute une série de cadres géopolitiques, à piétiner le droit international, une idée utopique de nouveaux espaces jadis inimaginables, de nouvelles implantations. Tout cela ne fait pas partie de l’imaginaire concret de la droite européenne tardive ou post-fasciste, qui n’a plus vraiment d’imaginaires expansionnistes, pas même au plan territorial.
C’est la différence — je ne sais pas si cela fonctionne bien en espagnol [la langue dans laquelle a été menée cet entretien] — entre la « frontière » (frontier) et la « frontière » (border). La frontière peut s’étendre à l’infini — jusqu’à Mars chez Elon Musk —, mais la border, la frontière politique…[1]
Pablo Elorduy – La frontière politique.
Alberto Toscano – Oui. C’est quelque chose qui doit rester fixe et sert à tenir l’Autre dehors, non à conquérir. Un imaginaire conservateur, traversé de tensions. Même faible, un élément utopique demeure nécessaire — d’où sa projection ailleurs.
Pablo Elorduy – Aux États-Unis, Trump garde les évangélistes à ses côtés grâce à la promesse d’un nouvel âge d’or, qui résonne avec la pensée religieuse radicale.
Alberto Toscano – En effet, l’ambassadeur des États-Unis en Israël a décrit Trump comme une figure presque messianique.
Pablo Elorduy –Cette vision transcendante, qui flirte avec l’Apocalypse ou l’Antéchrist, n’est pas présente dans les extrêmes droites européennes comme Fratelli d’Italia, Alternative pour l’Allemagne, le Rassemblement National ou Vox. Pourquoi ?
Alberto Toscano – Je pense qu’il y a beaucoup de calcul réaliste dans les extrêmes droites contemporaines. Un discours, une raison cynique, affirme : « il n’y a pas d’horizon de croissance ». Même si cela est parfois nié violemment, la question de l’urgence climatique et de la finitude du monde fait partie de l’imaginaire qui donne sa force à la droite. L’idée, c’est que les choses vont empirer ; que l’avenir n’offre pas un horizon très positif ; et que, par conséquent, le rôle de la politique est une redistribution antagoniste, exclusive, dominatrice, de ressources qui se raréfient.
Cela fait partie du contrat symbolique et psychique établi avec des formations comme Fratelli d’Italia. Il y a des éléments de jouissance symbolique, psychologique, mais une part de leur force vient de ce cynisme : « Nous savons toutes et tous qu’il faut rester dans le monde thatchérien du “There Is No Alternative”, que le capitalisme est ce qu’il est ; mais nous allons limiter la capacité des Autres, internes ou mondiaux, à s’approprier les ressources, et nous vous promettons aussi un élément de jouissance : un permis psychologique pour briser toutes les règles du politiquement correct, du “wokisme” ; nous vous autoriserons vos discours identitaires raciaux, nationaux, de genre ; nous vous permettrons d’insulter et d’humilier. »
Pour une grande partie de la droite contemporaine, ce cynisme — ce fatalisme de base — est presque explicite. Pour reprendre W. E. B. Du Bois (1868-1963), il y a beaucoup de salaire psychologique, mais bien peu de salaire matériel — et c’est presque explicite dans le contrat qui se signe.
Pablo Elorduy – Il n’y a pas d’alternative — et il y en a encore moins pour l’Autre étranger.
Alberto Toscano – Un phénomène significatif de cette droitisation et de cette nationalisation de la politique fut le Brexit, en Angleterre, où j’ai vécu. Des sondages curieux montraient alors une différence notable entre celles et ceux qui voulaient rester dans l’UE et celles et ceux qui votaient pour le Brexit : la majorité des pro-Brexit pensaient que cela ne changerait rien. 70 % disaient : « Bien sûr que rien ne va changer — les politiciens sont corrompus, vendus —, mais je vais affirmer mon identité. » Alors que, de l’autre côté, la majorité des partisans du maintien pensaient qu’il y aurait des conséquences matérielles. J’y ai vu un signe de ce cynisme ou de ce fatalisme expliquant la montée de la droite.
Aux États-Unis, c’est une autre histoire en raison de la question évangélique : certains sondages indiquent que 40 % des habitant.es pensent que l’Antéchrist va arriver — les charges utopiques sont différentes. Mais, sur le Vieux Continent, le caractère de redistribution plutôt symbolique et de politiques identitaires sans véritable horizon de changement est très fort.
Pablo Elorduy – Une autre « famille » de l’extrême droite étatsunienne est aujourd’hui celle des multimillionnaires de la Silicon Valley. Pourquoi des gens comme Elon Musk, et d’autres comme Peter Thiel (1967), ont-ils embrassé ces idéologies et les ont-ils théorisées ?
Alberto Toscano – L’histoire de la Silicon Valley est depuis longtemps profondément marquée à droite — Malcolm Harris (1988) la retrace très bien dans Palo Alto: A History of California, Capitalism, and the World.
C’est une longue histoire de pensée eugéniste, d’imaginaires de domination ou de suprématie intellectuelle à forte connotation raciale, etc. Et cette histoire commence avant les ordinateurs, dans les années 1920-1930 à Stanford. Ajoutez des niveaux d’inégalités stratosphériques et la formation d’une conscience de classe exorbitante — multimillionnaire. Cela me rappelle une belle phrase du théoricien communiste italien Mario Tronti (1931-2023) :
« Notre histoire est celle d’un capitalisme qui cherche à s’affranchir de la classe ouvrière ; aujourd’hui, nous assistons à une tentative de s’affranchir de la Terre elle-même — jusqu’à Mars. »
Mais cette projection dans les étoiles nous amène aussi à affronter une réalité beaucoup plus concrète.
Pablo Elorduy – Quoi ?
Alberto Toscano – Ce groupe de capitalistes de la Big Tech — Peter Thiel (1967) et Marc Andreessen (1971) mis à part — avait un certain modus vivendi avec le centrisme, avec le néolibéralisme progressiste du Parti Démocrate, qui semblait être l’idéologie organique de la Silicon Valley. Cela a changé surtout à la fin des années 2010, et au moment de la révolte qui a suivi le meurtre de George Floyd par la police. Des mouvements éthico-politiques significatifs ont alors émergé en interne : songeons à No Tech for Apartheid, No Tech for ICE
Toutes celles et ceux qui avaient pris au sérieux le branding libéral et progressiste de ces entreprises en sont venus à exiger que Google, Amazon, etc., ne fonctionnent pas — comme c’est en réalité le cas — comme des piliers de l’infrastructure répressive de l’État, en particulier de l’appareil militaro-industriel et, ce qui est aujourd’hui très significatif, de la répression des migrants et de la militarisation des frontières. Idéologiquement et matériellement, c’est là le fonds de commerce d’Amazon, de Google, de Musk : leur véritable intérêt matériel réside dans les contrats liés aux infrastructures militaires et répressives de l’État, et non dans les applications ludiques destinées au grand public.
Pablo Elorduy – La technologie de la répression.
Alberto Toscano – Il y a aussi une psychologie politique du fondateur (founder), qui se perçoit comme une figure méta- ou para-politique : le génie, l’inventeur, le capitaliste plus ou moins souverain, qui ne tolère pas que ses employé·es — très bien payé·es, mais avec peu de droits — organisent des formes éthico-politiques, syndicales, en interne. C’est intéressant, car ces gens pourraient accepter toutes les exigences de leurs salarié·es et conserver des sommes d’argent avec lesquelles personne ne saurait quoi faire — mais la question de leur pouvoir matériel et symbolique ressurgit là.
Pablo Elorduy – Il y a des contradictions entre ce secteur des millionnaires et le mouvement MAGA.
Alberto Toscano – S’est nouée une alliance curieuse, non sans conflits — Steve Bannon (1953), par exemple, a dénoncé la Silicon Valley comme un État d’apartheid —, mais une convergence s’est produite : une amalgamation autour d’un ennemi commun — le « wokisme », les universités, les élites intellectuelles —, imaginés à la fois comme ceux qui brident la capacité du fondateur à déployer toute son inventivité transformative, et comme ceux qui dominent l’ouvrier blanc nationaliste — plutôt fantasmé. Une étrange alliance de solidarité négative s’est ainsi constituée entre diverses figures de l’extrême droite.
Pablo Elorduy – Peter Thiel, le fondateur de Palantir, est l’un des pôles majeurs de l’extrême droite étatsunienne. Que représente-t-il aujourd’hui ?
Alberto Toscano – Palantir incarne le moment de pleine « autoconscience » de l’idée selon laquelle la Silicon Valley doit se transformer ouvertement en projet civilisationnel et nationaliste, en raison de la « menace » chinoise et d’autres facteurs. On peut lire ce texte soporifique, mais délirant et très étrange, d’Alex Karp (1967), patron de Palantir et ami de Thiel, The Technological Republic (2025). Le discours est le suivant : il faut éliminer ce virus du libéralisme — cette faiblesse —, injecter davantage d’énergie virile dans le monde de la Silicon Valley.
C’est un refrain repris par Mark Zuckerberg. Karp ajoute qu’à l’ère de l’IA, des drones et des algorithmes, il faut recréer la même synthèse entre identité technologique et domination géopolitique qu’aux heures fortes de la guerre froide et du Projet Manhattan. Voilà leur utopie — devenue hyper-étatiste : presque plus néolibérale, mais autre chose, un capitalisme d’État hyper-technologique.
Pablo Elorduy – Avec des accents monarchiques.
Alberto Toscano – Oui, avec des accents monarchiques — à la Curtis Yarvin (1973) — qui promeuvent l’idée du PDG comme figure de souveraineté, d’anti-démocratie.
Pablo Elorduy – Des personnages comme Yarvin posent la question : faut-il vraiment prendre au sérieux ce bric-à-brac théorique autrement que comme justification de pratiques de domination ? Est-ce du folklore ou un programme cohérent ?
Alberto Toscano – Difficile à discerner. Parfois, ces références semblent ornementales. Bannon, Thiel, et d’autres, lisent Julius Evola (1898-1974) ou Oswald Spengler (1880-1936) — mais quelle importance réelle ? C’est une pathologie professionnelle : philosophes et historien·nes des idées s’orientent naturellement vers cela.
En même temps, il est significatif que cette galaxie de la droite extrême organisée autour de Trump soit, curieusement, beaucoup plus europhile que le Parti Républicain d’hier. Certes, il y a une forte composante évangélique, nationaliste, chrétienne, mais il existe aussi ce groupe tourné vers des éléments de la Nouvelle Droite ; toute cette mouvance qui lit Le Camp des Saintsde Jean Raspail (1925-2020), un peu d’Alain de Benoist (1943), etc., et une organisation assez significative comme le National Conservatism[2], qui constitue un autre lien avec Israël et le sionisme.
Pablo Elorduy – Dans quelle mesure la culture de la nouvelle extrême droite est-elle importante pour comprendre l’extension politique du phénomène cette dernière décennie ?
Alberto Toscano – Il y a un désir d’intellectualité à droite qui m’est familier, ayant vu l’extrême droite italienne depuis les années 1970 — jusqu’à CasaPound[3]— pleine de revues, colloques, groupes de lecture ; des murs ornés de Gottfried Benn (1886-1956), Ernst Jünger (1895-1998), Giovanni Gentile (1875-1944), Gabriele D’Annunzio (1863-1938), etc. Difficile d’apercevoir quelque chose d’organique dans toute cette galaxie. On risque de trop se focaliser sur les lectures de Bannon.
Mais, en réalité, une production beaucoup plus ennuyeuse, une intellectualité plus concrète, façonne fortement les politiques trumpistes : tout le travail gris, quasi anonyme, de certains think tanks. Lisez le Project 2025 : surtout au plan juridique et légal — là s’exprime une profonde intellectualité technique, très particulière aux États-Unis, mais avec ses imaginaires politiques — chrétiens, nationalistes, identitaires, homophobes et misogynes. C’est l’épine dorsale qui agrège ces autres éléments.
On peut penser à l’idéologie européenne du « grand remplacement » des années 1990 ; mais, aux États-Unis, cela s’imbrique avec 150 ans de pratique et de pensée anti-immigration — déjà présentes dans les lois contre les travailleurs chinois au XIXᵉ siècle [4] — et qui structurent l’appareil légal et constitutionnel. Sur cette base se synthétisent d’autres éléments, non négligeables, mais opérants parce qu’existe cette infrastructure idéologico-juridique plus profonde.
Pablo Elorduy – Comment l’extrême droite étatsunienne influence-t-elle les partis post-fascistes européens ?
Alberto Toscano – L’influence stylistique est claire — logique dans un continent sub-impérial où l’hégémonie culturelle et géopolitique étatsunienne est forte. L’idée d’avoir des « frères » idéologiques à la Maison-Blanche a été clé pour ouvrir un champ des possibles. La figure de Bannon a compté par sa tentative de nouer des réseaux intellectuels et de mimésis réciproque. Il ne s’agit pas que des guerres culturelles : certaines tactiques et stratégies institutionnelles étatsuniennes ont été importées, tout comme l’idée d’un nouvel illibéralisme institutionnel — Viktor Orbán en est un exemple.
Un nouveau cycle, un autre horizon semblent possibles. Des éléments de contre-révolution juridiques étatsuniens ont été repris sur les questions de genre, de sexualité et de reproduction ; en Italie, même les débats sur le port d’armes. Il y a mimésis, mais dans des traditions juridiques et des formes institutionnelles très différentes. On le voit dans les relations entre Javier Milei et Musk, Meloni et Orbán, Orbán et Ron DeSantis : un monde de possibilités politiques s’est ouvert.
On pourrait dire qu’au plan formel, ce n’est pas si différent des gauches radicales européennes allant observer l’Équateur, le Venezuela ou le Brésil — non pour opérer techniquement, mais comme climat d’époque. Il est significatif de voir comment s’articulent, dans ces droites extrêmes, l’identitarisme et le provincialisme avec l’idée d’appartenir à un mouvement assez global.
Pablo Elorduy – Le post-fascisme puise sa force dans une revendication de la « liberté » qui n’était pas présente de la même façon dans le fascisme classique.
Alberto Toscano – Je ne suis pas d’accord. Dans la préhistoire coloniale du fascisme, il y a une promesse utopique au sens d’être libres de dominer, libres de jouir de sa domination, dans certains espaces. On la retrouve dans des enclaves ou des moments des fascismes historiques d’entre-deux-guerres. C’est l’un des thèmes du livre de l’historien français Johann Chapoutot, (1978) Libres d’obéir : jusque dans l’idéologie managériale et subjective des SS, on trouve l’idée que tu as un objectif, mais que la façon de l’atteindre est ton espace de liberté, d’autonomie.
Un obstacle à la pensée critique du fascisme classique — et surtout du fascisme tardif —, c’est tout ce sens commun hérité de la guerre froide qui fait du fascisme un « totalitarisme » entendu comme système bureaucratique d’obéissance totale et quasi mécanique. Cette image d’un État-Moloch est éloignée de la réalité, des désirs et des formes de subjectivité de l’extrême droite contemporaine. D’où ces relations complexes entre autoritarismes extrêmes et idéologies économiques libertariennes : des figures comme Javier Milei sont symptomatiques.
Je pense aux travaux de l’historien Quinn Slobodian sur les « bâtards de Hayek », et aux tendances raciales et coloniales au cœur de l’histoire du néolibéralisme. Si l’on définit le fascisme par une statolâtrie exorbitante, on s’interdit de penser ses rapports avec l’anarcho-capitalisme. Or, dès les textes et discours de Mussolini autour de la marche sur Rome, on trouve une curieuse identification à l’État minimal libéral : le fascisme comme méthode de violence pour briser l’échine du mouvement ouvrier, l’autonomie paysanne et ouvrière, les organisations de solidarité — afin de rendre possible « moins d’État ».
La généalogie du fascisme entretient des relations compliquées avec l’idée de liberté économique : liberté d’entreprendre, liberté de propriété — donc liberté d’exploiter, de dominer, etc.
Pablo Elorduy – Vous citez cette formule : « Qui n’est pas prêt à parler du capitalisme devrait aussi se taire sur le fascisme ». La question est de savoir si la graine de ce qui se passe aujourd’hui n’était pas là avant 2008, avant Lehman Brothers et l’austérité.
Alberto Toscano – Pour Karl Polanyi (1896-1964), cela existe déjà avec David Ricardo (1772-1823). J’ai trouvé très curieuse l’idée du virus, un virus qui était peut-être en suspens, dormant, mais qui était déjà là. Pourquoi ?
On peut aussi penser qu’il existe un virus fasciste parce que la modernité politico-économique est hautement contradictoire, parce que l’universalisation des droits politiques et l’universalisation de la citoyenneté ont une relation conflictuelle avec le capitalisme. Non seulement celui-ci doit reproduire diverses formations hiérarchiques et parasiter les formations hiérarchiques qui sont son héritage pré-capitaliste, mais il crée aussi continuellement des populations excédentaires, jetables.
Je lisais la belle édition d’Akal de Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, de Karl Marx[5], et dans ce livre, on trouve l’idée que le césarisme bonapartiste qui se manifeste au milieu du XIXe siècle est comme le symptôme de cette contradiction et de cette quasi-impossibilité constitutive.
Pablo Elorduy – Comment cela ?
Alberto Toscano – C’est aussi la thèse du théoricien japonais Kojin Karatani (1941) : le fascisme est une variante de la forme transcendante et contradictoire de la politique sous le capitalisme. L’autoritarisme bonapartiste devient la solution capitaliste au problème de la nécessité d’une politique de masse dans une société fondée sur une exploitation hiérarchique qui génère des populations excédentaires. En ce sens — non pas « le fascisme aux bottes noires » —, comme solution violente nécessitant une politique de masse et des imaginaires, des utopies d’égalité antagoniste (colons contre indigènes, hétérosexuels contre « anormaux », etc.), cette solution est invariante mais se répète sous des formes très différentes.
Pablo Elorduy – Que retenir alors de l’étude du fascisme classique pour affronter la situation actuelle ?
Alberto Toscano – Quand j’ai commencé le livre, un débat faisait rage aux États-Unis sur les analogies et différences avec le fascisme. J’ai trouvé très utile de penser à partir de textes de gens ayant connu directement le fascisme : Hannah Arendt, Primo Levi, Césaire — et d’autres —, toujours lucides sur le fait que la potentialité et la répétition du fascisme demeurent, sans qu’il revienne sous les mêmes formes. Marcuse, par exemple, dit qu’il peut y avoir du fascisme aux États-Unis, mais que ses manifestations ne seront pas reconnaissables comme telles.
Théoriquement, nous sommes donc obligé·es de penser ce que recouvrent exactement ce processus et cette potentialité. Rien de mystérieux pourtant si l’on admet que le fascisme lui-même, que la politologie fige historiquement, n’a jamais été homogène : ses moments sont radicalement différents.
Pablo Elorduy – Le livre propose une petite espérance : devenir ce que l’extrême droite croit que la gauche est – anti-blanche, queer, métisse.
Alberto Toscano – Ma modeste proposition, c’est la version antifasciste de l’idée de Nietzsche : « Deviens ce que tu es ». Être ce qu’ils pensent que tu es. Réaliser l’ennemi imaginaire qu’ils projettent.
Pablo Elorduy – Se « réveiller » vraiment — être woke en pleine conscience.
Alberto Toscano – Mais c’est un idéal régulateur assez utopique. Le moment est extrême, symboliquement, et matériellement marqué par des excès de violence militaire. Ce qui me frappe, en Europe comme en Amérique du Nord, c’est le vide béant au cœur des idéologies de l’ « extrême centre ». Tout ce qui prétend reproduire une normalité occidentale tourne à la caricature creuse. Le mantra — répété comme par des zombies — « Israël a le droit de se défendre » est glaçant.
Non pas matériellement – car, comme le souligne Ilan Pappé (1954), le sionisme traverse une crise terminale, susceptible de durer et de se traduire par des phases particulièrement violentes -, mais symboliquement : le suprémacisme occidental, dans sa version libérale et libérale-progressiste, s’effondre. Et c’est dans cet effondrement que les fascismes trouvent leur humus, leur terrain de croissance.
Combien de temps cela peut-il durer sans contrepoids, sans réactions ? Empiriquement, on observe une désaffiliation massive : le soutien à la guerre contre l’Iran ou à ce qui se passe à Gaza est très faible dans l’opinion publique. Même en Allemagne — où le soutien inconditionnel à Israël frôle le délire —, les critiques au sein de la population ne diffèrent pas tellement de celles qu’on entend en Espagne ou en Italie. Je ne sais donc pas combien de temps cette façade, ce vide politique, peut encore se maintenir tel quel.
Pablo Elorduy – Le programme, ce serait provoquer la fin du suprémacisme occidental ?
Alberto Toscano – Oui, ce serait un bon programme. Comme l’« euthanasie de la rente »[6], l’euthanasie du suprémacisme occidental.
*
Alberto Toscano est enseignant à la School of Communication de l’Université Simon Fraser (Canada) et codirige le Centre for Philosophy and Critical Theory à Goldsmiths, Université de Londres. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages récents : Late Fascism: Race, Capitalism and the Politics of Crisis (Verso, 2023), traduction française : Fascisme tardif. Généalogie des extrêmes droites contemporaines, Éditions La Tempête, 2025 ; Terms of Disorder: Keywords for an Interregnum (Seagull, 2023) ; et Fanaticism: On the Uses of an Idea (Verso, 2010 ; 2ᵉ éd. augmentée, 2017), disponible en français sous le titre Le Fanatisme. Modes d’emploi (La Fabrique, 2011). Toscano a également traduit en anglais des textes d’Antonio Negri, d’Alain Badiou, de Franco Fortini et de Furio Jesi. Il vit à Vancouver.
Pablo Elorduy est né à Madrid en 1978 ; il est diplômé en histoire de l’art et exerce le journalisme depuis 2008. Il a débuté au journal Diagonal (2008–2017), avant de co-fonder en 2017 le quotidien militant en ligne El Salto, où il coordonne la rubrique politique. Il est l’auteur d’El Estado feroz (Verso, 2023), une enquête sur les mécanismes répressifs de l’État espagnol après la crise financière, parmi lesquels le lawfare (instrumentalisation du droit à des fins politiques) et le deep state (réseaux opaques de pouvoir au sein de l’appareil d’État).
Il intervient régulièrement dans des débats radiophoniques comme Hora 25 (Cadena Ser), Carne Cruda ou sur Canal Red.
Cet entretien a été initialement publié dans le journal El Salto et traduit de l’espagnol (castillan) pour Contretemps par Christian Dubucq.
Notes
[1] En anglais, frontier désigne la « frontière » au sens d’un espace mobile, ouvert à l’expansion (par ex. la conquête de l’Ouest, ou l’exploration spatiale). Border renvoie à la limite politico-juridique fixe entre États. Le français ou le castillan ne disposent pas de cette distinction lexicale, ce qui explique la précision d’Alberto Toscano.
[2] Le National Conservatism (ou « conservatisme national ») est un courant idéologique forgé à la fin des années 2010 autour de Yoram Hazony (1964) et de la National Conservatism Conference. Derrière son discours de défense de la « nation » contre le « globalisme », il promeut une vision ethno-nationaliste, patriarcale et autoritaire, qui sert de ciment aux nouvelles droites radicales aux États-Unis comme en Europe. Israël joue ici un rôle stratégique : présenté comme modèle d’« État-nation fort » fondé sur l’identité juive et l’exclusion des Palestiniens, il devient à la fois une source d’inspiration et un point de ralliement idéologique pour cette mouvance.
[3] CasaPound Italia est un mouvement néofasciste fondé à Rome en 2003, qui se revendique du « fascisme du troisième millénaire ». Inspiré par Ezra Pound, poète et propagandiste fasciste, CasaPound a combiné occupations de bâtiments, concerts, librairies, bars et revues pour diffuser et normaliser une culture néofasciste dans l’Italie contemporaine. S’il reste marginal électoralement, son activisme militant et culturel a joué un rôle central dans la banalisation des discours racistes, sexistes et nationalistes au sein de la droite italienne.
[4] La « loi d’exclusion des Chinois »), (Chinese Exclusion Act), adoptée aux États-Unis en 1882, fut la première loi fédérale à interdire l’immigration d’une nationalité entière, sur une base explicitement racialisée. Elle criminalisait l’arrivée de nouveaux travailleurs chinois, refusait la naturalisation à celles et ceux déjà présents, et légitimait une vague de violences racistes enracinées depuis des décennies. Renouvelée par le Geary Act (1892) puis rendue permanente en 1902, elle n’est formellement abrogée qu’en 1943 (Magnuson Act) — non par souci de justice, mais dans le contexte de l’alliance militaire avec la Chine contre le Japon ; l’abrogation ne concédait alors qu’un quota dérisoire (105 entrées annuelles) et la naturalisation, tandis que d’autres barrières demeuraient. Cette loi inaugure un régime d’immigration et de citoyenneté racialisé, ensuite étendu à d’autres populations asiatiques et non européennes, et constitue un jalon majeur du racisme institutionnel aux États-Unis. Voir l’article « Loi d’exclusion des Chinois », Wikipédia.
[5] Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Madrid, Ediciones Akal, coll. « Básica de Bolsillo », 2003 (nombreuses rééd.).
[6] L’expression « euthanasie de la rente » renvoie à John Maynard Keynes (Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, 1936), qui anticipait la disparition des revenus de rente dans le développement du capitalisme.
°°°
Source: https://www.contretemps.eu/contre-fascisme-tardif-entretien-alberto-toscano/
URL de cet article: https://lherminerouge.fr/contre-le-fascisme-tardif-etre-ce-quils-craignent-entretien-avec-alberto-toscano-contretemps-20-10-25/
